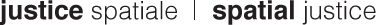Tania Li est une anthropologue de renom, professeure à l’université de Toronto, dont la recherche porte sur le changement agraire en Indonésie. Ses travaux récents étudient l’expansion massive de plantations commerciales de palmiers à huile et leur impact sur les communautés rurales. Dans la première partie de cet entretien mené le 18 juin 2024, Tania Li parle de « l’injustice sans recours », une expression qu’elle utilise pour se référer à des situations dans lesquelles des personnes subissant l’injustice ne se mobilisent pas pour autant pour s’en plaindre. Bien que les chercheurs et les militants mettent souvent en avant les mobilisations, il semble que l’absence de mobilisation soit la norme. Il est donc important de comprendre non seulement les conditions de la mobilisation collective, lorsqu’elle se produit, mais aussi celles de la non-mobilisation. Il est méthodologiquement difficile d’étudier cette dernière, et Li propose d’utiliser l’ethnographie comme outil pour saisir comment les personnes expriment un sentiment d’injustice dans leurs termes vernaculaires et identifier les conditions qui permettent ou empêchent la mobilisation. Dans la seconde partie de l’entretien, Tania Li fait part de son opinion quant au rôle des chercheurs dans l’étude des luttes pour la justice et la diffusion de ces travaux.
Tania Li is a professor of Anthropology at the University of Toronto. She is a renowned anthropologist whose research has focused on agrarian change in Indonesia. Her recent work examines the massive expansion of corporate oil palm concessions and their impact on rural communities. In the first part of this interview conducted on June 18, 2024, Tania Li discusses “injustice without recourse,” a phrase she uses to refer to situations in which people who suffer from injustice do not mobilize collectively to demand remedy. Although scholars and activists often highlight mobilization, non-mobilization is the norm. Hence it is important to understand the conditions that enable collective mobilization when it occurs, and equally important to understand non-mobilization. The latter is challenging methodologically, and Li suggests that ethnography can be a useful tool to explore how people express a sense of injustice in vernacular terms, and identify the conditions that enable or deter mobilization. In the second part, Tania Li exposes her opinion on the role of researchers in studying and communicating about justice struggles.
Celine Allaverdian est doctorante au département de géographie de l’université de Montréal et au département d’agriculture comparée d’AgroParis Tech/Université Paris-Saclay, en partenariat avec le GRET.
Celine Allaverdian is a PhD candidate at the department of geography of the University of Montreal and the department of comparative agriculture of AgroParis Tech–University of Paris-Saclay, on partnership with GRET.
Le texte ci-dessous résume un entretien plus détaillé dont les enregistrements peuvent être écoutés :
The text below is a summarized version of the more detailed interview podcasts that you can listen to:
Injustice sans recours : entretien avec Tania Li, partie 1
Injustice without recourse: Interview with Tania Li Part 1
Le rôle des chercheurs dans les luttes pour la justice : entretien avec Tania Li, partie 2
The role of researchers in justice struggles: Interview with Tania Li Part 2
Partie 1 : Injustice sans recours
Part 1: Injustice without recourse
jssj19_ep02_li_sound_01 : 0 min
jssj19_ep02_li_sound_01: 0 min. 0 sec.
Celine Allaverdian (CA) : Dans ce numéro spécial intitulé « Luttes, territoires et justice spatiale », la revue JSSJ interroge différentes formes de lutte et d’action collective ainsi que leurs dimensions territoriales. L’accent mis sur la lutte contraste avec votre longue expérience de recherche dans les zones rurales indonésiennes, où vous avez constaté que l’action collective est rare et le plus souvent inefficace, ce qui vous a amenée à écrire sur « l’injustice sans recours ».
Celine Allaverdian (CA): In this special issue called “Territories of Struggle and Spatial Justice”, the JSSJ journal examines different forms of struggle and collective action and their territorial dimensions. The emphasis on struggle contrasts with your extensive and long-term research experience in Indonesian rural areas where you find that collective action is very rare and mostly ineffective. This has led you to write a forthcoming article about “injustice without recourse.”
Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par « injustice sans recours » ? Quels sont les ouvrages et les références qui vous ont permis de développer ce concept ?
Could you explain what you mean by “injustice without recourse”? What literature and references have led you to develop this concept?
Tania Li (TL) : La question du recours est une question empirique. Face à l’injustice, que font les gens ? Que peuvent-ils faire ? Quelles sont les voies qui s’offrent à eux ?
Tania Li (TL): The question of recourse is an empirical one. Faced by injustice, what do people do? What can they do? What modes of redress are available to them?
Il existe de nombreuses possibilités – recours au droit, lobbying politique, etc. – mais je me concentrerai ici sur celle que vous mettez en avant dans votre numéro spécial, à savoir l’action collective.
There are many possible courses of action–recourse to law, political lobbying etc.–but I’ll focus here on the one you are highlighting in your special issue, collective action.
Il peut s’agir d’une action collective visant à demander réparation aux autorités, à reconquérir un espace, à s’emparer d’une institution ou d’un processus, ou à prendre le contrôle de l’État dans son ensemble et à le remodeler de manière à incarner, à mettre en œuvre ou à préfigurer le type de justice recherché.
This could be collective action to demand redress from governing authorities, to reclaim space, to capture an institution or process, or to take over the state as a whole and remake it in a way that embodies, enacts or prefigures the kind of justice sought.
Si l’on regarde ce qui se passe dans le monde, on s’aperçoit que l’action collective est exceptionnelle. Dans la plupart des cas, le plus souvent, les personnes qui subissent une injustice ne se mobilisent pas collectivement pour la contester.
When we look across the globe, we find that collective action is exceptional. In most places, most of the time, people who suffer from injustice do not in fact mobilize collectively to contest it.
Il faut donc s’intéresser à l’action collective lorsqu’elle se produit, et nous intéresser tout autant, voire davantage, à l’inverse : à la non-mobilisation, à l’absence d’action héroïque – aux cas où face à l’injustice, les gens ne s’organisent pas et ne se soulèvent pas.
So we should be interested in collective action when it happens and equally or even more interested in the counterfactual–non-mobilization, unheroic decades–places and periods in which people suffer from injustice but do not organize and rise up.
Étudier quelque chose qui ne se produit pas est, bien sûr, plus difficile que d’étudier quelque chose qui se produit. Les chercheurs et les lecteurs aiment l’action, la rédemption et les fins heureuses. C’est pourquoi la recherche se concentre sur l’action collective visible, en particulier l’action que les chercheurs considèrent comme progressiste – au détriment des autres cas. En tant que chercheurs, nous devons réfléchir à cela.
Studying something that is not happening is, of course, more challenging than studying something that is happening. Researchers and readers love action, redemption and happy endings. So there is a bias in scholarship towards one pole–visible, collective action, especially action scholars think of as progressive–at the expense of the other. As scholars, we need to think about this.
jssj19_ep02_li_sound_01 : 4 min 26 s
jssj19_ep02_li_sound_01: 4 min. 26 sec.
CA : Très juste. Cela participe d’une tendance plus large qui conduit les chercheurs à rechercher ce qui est exceptionnel et à ignorer ce qui se passe quotidiennement dans la vie « normale », qui devient alors invisible.
CA: That’s a good point. It seems to be part of a broader bias that leads scholars to look for what’s exceptional and ignore what is happening daily in “normal” life, which then becomes invisible.
En ce qui concerne la justice spatiale et ce numéro sur les « territoires de lutte », avez-vous des exemples d’« injustice sans recours » et plus spécifiquement de dimensions territoriales et spatiales de telles injustices ?
In relation to JSSJ’s core focus on spatial justice and this special issue about “Territories of struggle”, could you give examples from your work about “injustice without recourse” and more specifically about its territorial and spatial dimensions?
TL : Votre numéro met l’accent sur la mobilisation collective pour la défense des territoires ainsi que sur le rôle du territoire et de l’espace, qui rendent possible et orientent la lutte collective. Je suis d’accord qu’il s’agit d’un élément crucial de nombreuses luttes. En contrepoint, il permet d’expliquer pourquoi, dans le cas que j’étudie, la mobilisation collective est rare ou infructueuse.
TL: Your special issue highlights collective mobilization in defense of territories, and the role of territory and space in enabling and orienting collective struggle. I agree this is a crucial element in many struggles. Posed as a counterfactual, it helps to explain why, in the empirical case I’m examining, collective mobilization is rare or unsuccessful.
Les recherches que j’ai menées ces dernières années, avec l’anthropologue indonésien Pujo Semedi, portent sur l’expansion de la présence des grandes entreprises dans les zones rurales. Le gouvernement indonésien leur a accordé des concessions à long terme, renouvelables, couvrant un tiers des terres agricoles du pays pour les plantations de palmiers à huile, auxquelles s’ajoutent d’autres concessions pour le bois, l’exploitation forestière, l’exploitation minière, etc.
My research over the past few years, together with an Indonesian anthropologist Pujo Semedi, concerns the expansion of corporate presence in rural areas. The Indonesian government has granted corporations long term, renewable concessions covering a third of the nation’s agricultural land for oil palm plantations, plus there are other concessions for timber plantations, logging, mining, etc.
Ces concessions empiètent sur les terres agricoles et forestières utilisées par les populations locales, et l’injustice que ces dernières subissent est extrême. Leurs terres, leurs forêts, leurs rivières, leurs moyens de subsistance et leurs espaces de vie leur sont enlevés et, dans certains cas, les locaux sont cantonnés à de minuscules hameaux coincés entre plusieurs plantations. Ces hameaux n’offrent pas de possibilité de mise en valeur agricole, ils sont beaucoup trop petits ; et socialement, culturellement et politiquement, ils ne sont pas du tout autonomes. Les chefs de hameau sont payés par les sociétés de plantation ; les hameaux sont divisés entre les groupes pour et contre ; et pour survivre, les gens doivent travailler pour la plantation ou chercher d’autres petits moyens d’extraire de la valeur, comme le vol.
These concessions overlap farm and forest land used by local communities, and the injustice they experience is extreme. Their lands, forests, rivers, livelihoods are living spaces taken from them, and in some cases they are squeezed into tiny hamlets wedged between multiple plantations. These hamlets do not offer possibilities for autonomous farming, they are much too small; and socially, culturally, and politically, they are not autonomous at all. Hamlet leaders are paid by the plantation corporations; hamlets are fractured into pro and contra groups; and survival needs push people to work for the plantation or seek other small avenues to extract value, such as theft.
Ces espaces manquent donc précisément de la configuration que vous avez identifiée comme essentielle à l’action collective : des espaces autonomes dans lesquels les gens peuvent vivre, agir, penser, discuter, développer un vocabulaire critique et formuler des stratégies pour changer leur situation. Même les souvenirs du lieu et le sentiment d’appartenance peuvent être perdus : les arbres fruitiers, les cimetières, les sentiers, et les histoires qui y étaient inscrites, ont été détruits par les bulldozers des entreprises et remplacés par des rangées monotones de palmiers.
So these spaces lack the configuration precisely you have identified as essential for collective action: autonomous spaces in which people can live, act, think, discuss, develop a critical vocabulary, and formulate strategies to change their situation. Even memories of place and belonging can be lost: the fruit trees, the graveyards, the trails and the stories embedded in them have been destroyed by corporate bulldozers and replaced by monotonous rows of palms.
Dans notre livre Plantation Life (Li et Semedi, 2021), nous avons qualifié cette réorganisation totale de l’espace d’« occupation entrepreneuriale » (corporate occupation). En lisant des récits de la Palestine occupée, nous avons été frappés par certains schémas récurrents : une force d’occupation fragmente le territoire, restreint les mouvements, s’appuie sur des collaborateurs, crée des règles et divise la population en catégories ayant chacune des droits différents.
In our co-authored Plantation Life (Li and Semedi 2021), we called this total reorganization of space “corporate occupation.” Reading accounts of occupied Palestine we were struck by some recurring patterns: an occupying force fragments territory, restricts movement, relies on collaborators, creates rules, and divides the population into categories each with different sets of rights.
Voilà donc l’élément spatial du régime de pouvoir et de contrôle dans la zone de plantation, et il manque précisément, comme je l’ai dit, ces espaces autonomes qui sont si cruciaux pour l’action collective. Il est difficile de savoir par où commencer – sur le plan imaginaire, affectif, pratique, économique, politique – pour reconquérir un tel espace.
So that’s the spatial element of the regime of power and control that’s in place in the plantation zone, and it’s lacking precisely, as I said, those autonomous spaces that are so crucial for collective action. It is hard to see where to start–imaginatively, affectively, practically, economically, politically–to reclaim such a terrain.
Il y a quelques exemples en Indonésie, très discutés par les mouvements sociaux, où les gens se sont mobilisés collectivement pour reprendre des terres aux plantations. Quelles étaient les conditions de possibilité ? Tout d’abord, les plantations récupérées étaient généralement abandonnées ou en ruine, si bien que leurs propriétaires n’ont pas fait appel à l’armée et à la police pour tenter de les défendre. Deuxièmement, les mobilisations se sont produites dans de rares fenêtres d’ouverture politique, où les politiciens ont vu un avantage à soutenir une lutte populaire. Dans la plus grande partie de l’Indonésie et le plus souvent, ces conditions ne sont pas réunies.
There are a few examples in Indonesia, much discussed by social movements, where people mobilized collectively to reclaim plantation land. What were the conditions of possibility? First, the plantations reclaimed were usually abandoned or in ruin, so the concession owners did not call in the army and police to try to defend them. Second, the mobilizations occurred in rare moments of political opening when politicians saw some advantage in supporting a popular struggle. In most of Indonesia, most of the time, these conditions do not exist.
Nous devons donc étudier l’action collective lorsqu’elle se produit, et nous devons étudier son absence ; les deux perspectives aident à éclairer les conditions de possibilité de l’autre.
So we need to study collective action when it occurs, and we need to study its absence; both sides help to clarify the conditions of the possibility for the other.
jssj19_ep02_li_sound_01 : 12 min 3 s
jssj19_ep02_li_sound_01: 12 min. 3 sec.
CA : Ce que vous proposez, d’étudier l’absence d’action collective, c’est une idée très productive. Elle m’amène à vous poser une question sur un numéro que vous préparez avec des coauteurs sur les revendications de justice et les réponses à l’injustice sociale, spatiale et environnementale dans le Sud global. Dans l’introduction de ce numéro (Daré et al., 2024), vous soulignez les défis posés aux chercheurs qui étudient des populations qui n’expriment pas ou ne peuvent pas exprimer ouvertement leurs sentiments d’injustice et ne demandent pas publiquement réparation. Quelle approche suggérez-vous, vous et vos coauteurs ?
CA: Your suggestion to study the absence of collective action is a powerful insight. It leads me to a question about a forthcoming issue you are preparing with other co-authors on demands for justice and responses to social, spatial, environmental injustice in the global South. In the introduction of that issue (Daré et al. 2024), you highlight the challenges posed for researchers studying communities where people do not or cannot openly express their feelings of injustice and do not make public claims for redress. What approach do you and your co-authors suggest?
TL : Ma réponse ne va pas vous surprendre. Je crois que la seule façon de comprendre les sentiments d’injustice dans des contextes où ils ne peuvent pas être exprimés publiquement est de mener une recherche ethnographique qui s’approche des mots et des actes quotidiens des personnes concernées. L’attention portée au langage est un bon point de départ. Lors de nos recherches sur les plantations, les villageois dont les terres avaient été accaparées par les sociétés de plantation nous ont dit qu’ils étaient « devenus un public [de spectateurs] ». Qu’est-ce qu’un public ? Le public ne joue aucun rôle dans le scénario, personne ne le regarde ni ne le remarque. Il regarde ce qui arrive aux autres sur la scène. Dans le cas présent, les villageois regardaient les dirigeants de la plantation, les travailleurs bien payés, les fonctionnaires et les politiciens s’enrichir grâce à la plantation, alors qu’ils n’avaient rien.
TL: My answer to this question won’t surprise you. I believe the only way to understand feelings of injustice in contexts where they cannot be expressed publicly is through ethnographic research that gets close to the everyday words and actions of the people concerned. Paying attention to language is a place to start. In our research on plantations, villagers whose land had been taken over by the plantation corporations told us they had “become the audience”. What is an audience? An audience has no role in the drama, no one looks at them or even notices them. They watch what happens to others on stage. In this case, villagers watched plantation managers, well-paid workers, officials and politicians get rich from the plantation while they had nothing.
« Devenir le public » est l’expression vernaculaire d’un sentiment aigu de marginalité ou d’invisibilité, ou de ce que Jacques Rancière (1999) appelle « la part des sans-part ». Leur situation difficile correspond aussi à la position que Giorgio Agamben (1998) a appelée « homo sacer » : des personnes qui peuvent être tuées, mais pas sacrifiées, car une personne dont le sacrifice est reconnu joue un rôle dans le drame, et est en fait au centre de celui-ci. Ni les entreprises ni le gouvernement ne reconnaissent que les villageois dont les terres ont été prises ont fait un sacrifice ou ont été sacrifiés. Ils les traitent comme s’ils n’étaient tout simplement pas là ou, s’ils sont là, comme si ils ne valent rien et ne peuvent donc avoir subi de perte.
Becoming the audience is a vernacular expression of acute marginality–invisibility–or what Jacques Rancière (1999) calls “the part with no part”. Their predicament also conforms to the position Giorgio Agamben (1998) called “homo sacer”–people who can be killed but not sacrificed, because a person whose sacrifice is recognized has a part in the drama–is actually central to it. Neither the corporations nor the government recognize that villagers whose land has been taken have made a sacrifice or been sacrificed. They treat them as if they simply are not there, or if they are there they have no value, hence they could not have suffered a loss.
Qu’en est-il des actions ? Les gens se livrent à des activités illicites sur les terres de plantation, comme la cueillette de fougères comestibles, le pâturage du bétail et le brûlage de palmiers pour chasser les rats arboricoles. Ces activités peuvent être considérées comme des actions de guérilla ou simplement comme des tactiques de survie et elles impliquent souvent une complicité, par exemple en « graissant la patte » des gardes de la plantation. La principale action que nous avons rencontrée au cours de nos recherches, c’est le vol. Les villageois et les travailleurs volent la société de plantation ; ils se volent aussi les uns les autres. Nous avons dû veiller à ne pas nous lancer trop vite dans une théorisation à la James Scott (1985) du vol comme « armes des faibles ». Le vol peut être prédateur. Nous avons donc essayé de prêter une attention particulière à la manière dont les gens décrivaient et évaluaient le vol – comme arme, comme péché, comme signe de faiblesse ou de force, etc.
How about actions? People engage in illicit activities on plantation land like gathering edible ferns, grazing cattle, and burning palms to hunt tree rats. These can be seen as guerrilla actions or simply as survival tactics and they often involve complicity e.g. paying off the plantation guards. The main action we encountered in our ethnographic research was theft. Villagers and workers steal from the plantation corporation; they also steal from each other. We had to be careful of jumping too fast into a theorization à la James Scott (1985) of theft as “weapons of the weak”. Theft can be predatory. So we tried to pay close attention to how people actually described and evaluated theft–as a weapon, as a sin, as sign of weakness or of strength, and so on.
Il n’est pas possible d’aborder cette question sans prêter une attention particulière aux détails, c’est-à-dire aux mots et aux actions tels qu’ils se déroulent au quotidien.
You really can’t get at this without close attention to the details–words and actions as they unfold in the everyday.
jssj19_ep02_li_sound_01 : 19 min 10 s
jssj19_ep02_li_sound_01: 19 min. 10 sec.
CA : D’après vous, comment aller au-delà de la description ou de l’analyse des sentiments d’injustice ? Et quel rôle les universitaires et les chercheurs peuvent-ils jouer dans l’évaluation de ce qui constitue réellement une injustice en soi ?
CA: How do you suggest we move beyond describing feelings of injustice or analyzing feelings of injustice? And what role can academics and researchers play in assessing what actually constitutes an injustice per se?
TL : Ici aussi, il est important de prêter attention aux détails. C’est un problème si des personnes extérieures – universitaires, activistes, défenseurs des droits de l’homme – se précipitent pour caractériser l’injustice selon leurs propres critères, sans prêter attention à la façon dont l’injustice est ressentie sur le terrain. Il s’agit d’un équilibre délicat. Lorsque nous avons entendu des personnes dire « nous sommes devenus le public », il s’agissait de leurs mots, mais il nous est revenu d’interpréter ces mots comme une expression vernaculaire de l’injustice. Donc on écoute ce que les gens disent et on essaie de le contextualiser. Dans ce cas, il ne s’agissait pas seulement d’une expression – « devenir le public » ; nous avons rencontré de nombreux autres modes d’expression du sentiment d’être invisibles, négligés, écartés, non consultés – des injustices en matière de reconnaissance et de procédure – comme de ne pas recevoir une « part légitime » (Ferguson, 2015) de la richesse de la plantation.
TL: Attention to the details is important here as well. There is a problem when outsiders–scholars, activists, human rights defenders–rush to identify injustice by their own standards, without paying attention to how injustice is felt on the ground. It is a tricky balance. When we heard people say “we have become the audience” it was their words, but our move to interpret those words as a vernacular expression of injustice. So you listen to what people say, and you try to contextualize it. In this case, it was not just one phrase–becoming the audience–we encountered many other ways in which people expressed their sense of being invisible, overlooked, discounted, not consulted–injustices of recognition and procedure–as well as not given a “rightful share” (Ferguson, 2015) of plantation wealth.
Les villageois de la zone de plantation ne revendiquaient pas l’égalité – l’inégalité est une chose à laquelle ils sont habitués et qu’ils acceptent comme normale. En revanche, ils avaient des objections à ne se voir reconnaître la propriété d’aucune part, quelle qu’elle soit. Leur principale revendication était la reconnaissance et un dialogue dans lequel ils seraient traités, sinon comme des égaux, du moins comme des participants ayant le droit d’exprimer des aspirations et des revendications.
Villagers in the plantation zone did not make a claim for equality–inequality is something they are accustomed to and accept as normal. What they objected to was the fact that they were not recognized as rightful owners of any share at all. Their primary demand was for recognition and a dialogue in which they were treated, if not as equals, then at least as participants with the right to express aspirations and demands.
Les chercheurs doivent être attentifs à ces dynamiques et ne pas imposer de jugement. Nous devons comprendre ce que les gens pensent, disent et revendiquent sans leur prêter des paroles qu’ils ne prononcent pas. Par exemple, certains activistes en Indonésie sont déçus que les personnes dont les terres ont été accaparées par de grands groupes ne demandent pas leur éviction. Dans le cas que nous avons étudié, nous avons constaté que les gens cherchaient à faire de l’occupant un partenaire susceptible de s’engager avec respect dans un ensemble d’échanges réciproques, une position conforme à leur sens de la justice. Si les chercheurs et d’autres personnes extérieures ne comprennent pas le point de vue des villageois, ils risquent de trouver leur comportement surprenant ou décevant. Parvenir à une position de partenaires dans un échange n’est peut-être pas une révolution, mais dans ce contexte, ce serait une énorme transformation des relations existantes et, jusqu’à présent, les villageois n’ont trouvé aucun moyen de réaliser cette transformation.
Researchers need to be attentive to these dynamics and not impose judgments. We need to understand what people are thinking, saying, and claiming without putting words into their mouths. For example, some activists in Indonesia are disappointed that people whose land has been taken by corporations do not demand the eviction of the corporations. In the case we studied, we found that people sought to transform the occupier into a partner who would engage respectfully in a set of reciprocal exchanges, a position which aligned with their sense of justice. If researchers and other outsiders fail to understand villagers’ perspectives, they could find their conduct surprising or disappointing. Achieving a position as partners in an exchange may not be revolution, but in this context, it would be a huge transformation in the existing set of relations and thus far villagers have found no means to bring this transformation about.
jssj19_ep02_li_sound_01 : 25 min 35 s
jssj19_ep02_li_sound_01: 25 min. 35 sec.
CA : Pour changer un peu d’échelle : j’ai eu l’occasion de lire votre prochain article sur l’injustice sans recours qui concerne les communautés affectées par l’expansion des plantations de palmiers à huile. La dimension internationale des luttes et de leurs relais semble assez absente de la façon dont vous en rendez compte, malgré le caractère éminemment mondialisé de la filière de l’huile de palme et l’attention des médias internationaux portée sur l’huile de palme. Que pourriez-vous dire sur les multiples échelles de lutte et de recours ?
CA: Now I’m going to change scale a bit. I’ve had the opportunity to read your forthcoming article about injustice without recourse which concerns communities affected by the expansion of corporate oil palm plantations. The international dimension of struggles and their relays seem quite absent in your account, despite the highly global feature of the palm oil value chain and a certain level of international media attention on palm oil. What would you have to say about the multiple scales for struggle and recourse?
TL : Les Indonésiens produisent pour les marchés mondiaux depuis des siècles – pensez au commerce des épices, à la collecte des résines, à l’essor des petites exploitations productrices de café, de clous de girofle, de caoutchouc ou de cacao. La dimension mondiale n’a rien de nouveau. Pour les producteurs, la justice est une question de répartition des bénéfices le long de la chaîne de valeur. L’enthousiasme local pour la production à l’exportation donne une tournure intéressante à la notion de « zones autonomes de contre-pouvoir » de Gibson-Graham. En Indonésie, les petits producteurs ne cherchent généralement pas à s’affranchir des marchés, qu’ils considèrent comme essentiels pour améliorer leur sécurité économique et leur bien-être. Ils cherchent plutôt à conserver une plus grande part de la valeur créée.
TL: Indonesians have been producing commodities for global markets for centuries–think about the spice trade, the collection of resins, smallholder crop booms for coffee, cloves, rubber, cacao. The global element is not new. For the producers, justice is a matter of how the profits are distributed along the value chain. Local enthusiasm for producing global commodities puts an interesting twist on Gibson-Graham’s notion of “autonomous zones of counter-power.” In Indonesia, small-scale producers do not generally seek autonomy from markets, which they regard as essential for improving their economic security and well-being. Rather, they seek to hold on to more of the value created.
Les campagnes mondiales contre l’huile de palme ne tiennent pas compte de cette dimension. Le problème n’est pas le palmier à huile en tant que culture, ou l’huile de palme en tant que produit, mais bien les conditions hautement extractives imposées par les entreprises de plantation. Lorsque les petits exploitants cultivent le palmier à huile, ils conservent une plus grande part de la valeur et paient bien leurs travailleurs pour s’assurer de leur loyauté. Ils contribuent à des économies rurales dynamiques dans lesquelles l’argent circule lorsque les agriculteurs prospères améliorent leur habitat, créent de petites entreprises, etc. Lorsque les sociétés de plantation cultivent des palmiers à huile, elles emploient des travailleurs occasionnels pour des salaires très faibles et privent les petits exploitants de l’accès aux terres agricoles. Elles créent ainsi des zones mortes d’appauvrissement et de désespoir. Une même culture mondialisée pour des résultats très différents (Li, 2023a).
Global campaigns against oil palm miss this dimension. The problem is not with oil palm as a crop, or palm oil as a commodity, but with the highly extractive conditions imposed by plantation corporations. When smallholders grow oil palm, they capture more of the value for themselves and pay their workers well to secure their loyalty. They generate lively rural economies in which money circulates as prosperous farmers fix up their houses, start small businesses, etc. When plantation corporations grow oil palms they employ casual workers for very low pay and they rob smallholders of access to farmland. Hence they create dead zones of impoverishment and despair. Same global crop, vastly different outcomes (Li, 2023a).
La majeure partie de l’huile de palme indonésienne – environ 85 % actuellement – est exportée vers l’Inde, où elle est utilisée comme huile de cuisson à prix abordable. Ce n’est pas un marché sur lequel l’activisme mondial contre l’huile de palme, ou en faveur de l’huile de palme durable, a beaucoup d’influence (Li, 2024).
Most of Indonesia’s palm oil–currently around 85%–is exported to India where it is used as an affordable cooking oil. This is not a market in which global activism against palm oil or for sustainable palm oil has much traction (Li, 2024).
Selon moi, l’échelle de justice cruciale pour le palmier à huile est nationale : le problème n’est pas lié à la culture ou à ses marchés d’exportation, mais à une politique de développement qui a donné un tiers des terres agricoles indonésiennes à des sociétés de plantation et qui a évincé les petits exploitants.
In my view, the crucial scale of justice for oil palm is national: the problem is not with the crop or its export markets. It is with a development policy that has given a third of Indonesia’s farmland to plantation corporations and squeezes smallholders out.
La pertinence de l’échelle nationale devient particulièrement évidente en comparaison : en Thaïlande, troisième producteur mondial d’huile de palme, 80 % de la production est assurée par des petits exploitants dont les parcelles ont une taille moyenne de 4 hectares. Une nation différente, une histoire différente, une législation foncière différente, des politiques différentes de développement rural – et des résultats sans commune mesure.
The relevance of the national scale becomes especially clear through comparison: in Thailand, the world’s third-largest palm oil producer, 80% of the crop is grown by smallholders with an average plot size of 4 hectares. Different nation, different history, different land law, different policies concerning rural development–and vastly different outcomes.
Partie 2 : le rôle des chercheurs dans les luttes pour la justice
Part 2: The role of researchers in justice struggles
jssj19_ep02_li_sound_01 : 0 min
jssj19_ep02_li_sound_02: 0 min. 0 sec.
CA : Alors que les écarts socio-économiques se creusent dans la plupart des régions du monde et que de nouvelles injustices sont créées, comment voyez-vous le rôle des chercheurs dans l’élaboration de ressources pour les luttes contre l’injustice dans les pays du Nord et du Sud ?
CA: While socio-economic gaps are widening in most parts of the world and new injustices are being fabricated, how do you see the role of researchers in crafting resources for struggles against injustice in both the Global North and the Global South?
TL : Tout d’abord, j’inciterais à prendre du recul par rapport aux déclarations à l’emporte-pièce, parfois exagérées, sur les évolutions en cours. Dans un article que j’ai coécrit avec James Ferguson (2018), nous avons montré que l’inégalité et l’injustice augmentent dans certains endroits, mais pas partout, et pas pour tous les secteurs ou groupes sociaux. Les chercheurs doivent être attentifs à ces histoires et expériences variées, et se demander comment différents lieux sont impactés. Par exemple, un petit exploitant prospère cultivant des palmiers à huile en Indonésie peut avoir l’impression que sa vie s’améliore. Il est essentiel de reconnaître cette diversité, plutôt que de postuler une expérience uniforme de déclin.
TL: First, I would step back from general, sometimes apocalyptic statements about the way the world is headed. In a paper I co-wrote with James Ferguson (2018), we argued that inequality and injustice are increasing in some places but not everywhere, and not for all sectors or social groups. Researchers need to be attentive to these varied histories and experiences, considering how different places are impacted. For instance, a prosperous smallholder in Indonesia growing oil palm might feel their life is improving. Recognizing this diversity is crucial, rather than assuming a uniform experience of decline.
Deuxièmement, j’ai tendance à être peu ambitieuse quant au rôle des chercheurs dans l’élaboration des ressources. Ce que j’ai essayé de faire dans mes recherches, c’est de prêter attention aux types de ressources que les gens produisent et utilisent déjà, y compris les types de ressources peu glorieuses que j’ai décrits avant. Si les chercheurs ne s’intéressent qu’aux mobilisations collectives et aux revendications de justice, ils passeront à côté de ce que font la plupart des gens, la plupart du temps, c’est-à-dire essayer de survivre, mais ils passeront également à côté de l’étincelle d’action qui est présente dans la critique.
Second, I am inclined to be modest about the role of researchers in crafting resources. What I have tried to do in my research is to pay attention to the kinds of resources that people are already crafting and putting to use–including the non-heroic kinds of resources I described earlier. If researchers are only looking for collective mobilizations and claims for justice, they will miss most of what most people do, most of the time–i.e., try to survive–but they will also miss the spark of action that is present in critique.
Lorsque quelqu’un dit « nous sommes devenus le public », c’est une approche critique. La personne dit qu’elle n’accepte pas la situation comme juste. La question suivante pour un chercheur est : sous quelles formes cette perspective critique est-elle mise en commun, et quels sont les obstacles qui l’empêchent d’être amplifiée et suivie d’effets ? J’ai écrit un article à ce sujet, intitulé « Politics, Interrupted » (Li, 2019), dans lequel j’ai tenté d’identifier les points de blocage qui immobilisent les gens ou limitent leurs pensées, leurs expressions et leurs actions. Pourquoi une pensée n’est-elle pas exprimée, ou exprimée mais non partagée, ou partagée mais non suivie d’effet ?
When someone says “we have become the audience” they are speaking critically. They are stating that they do not accept the situation as just. The next question for a researcher is: what are the formats in which a critical insight is shared, and what are the barriers that prevent it from being amplified and acted on? I wrote an article about this which I called “Politics, Interrupted” (Li, 2019) in which I tried to identify the blockage points that immobilize people or limit their thoughts, expressions and actions. Why is a thought not expressed, or expressed but not shared, or shared but not acted on?
Même si nous ne savons pas comment lever les blocages, le fait de reconnaître les étincelles de pensée critique et le potentiel d’actions critiques a de la valeur : cela évite le désespoir et signifie qu’il y a du travail à faire. Le postulat de mon travail est que tout le monde a la capacité de penser et d’agir de manière critique. Je m’intéresse donc toujours à ce qu’il advient de cette capacité, à la manière dont elle est canalisée, mobilisée, bloquée, réorientée. Il y a tant de choses à comprendre. Ce qui est encourageant, c’est que ce n’est jamais fini : l’étincelle de la critique est toujours présente. C’est ce qui me fait avancer. Si les gens acceptaient le monde tel qu’il est – comme le meilleur de tous les possibles – alors nous serions vraiment dans le pétrin.
Even when we do not know how to remove the blockages, recognizing the sparks of critical thought and the potential for critical actions has value: it guards against despair, and it means there is work to be done. My working assumption is that everyone has the capacity for critical thought and action hence I’m always interested in what happens to that capacity, how it is channeled, mobilized, blocked, reoriented. There is so much we need to understand. The encouraging part is that it is never over: the spark of critique is always present. That is what keeps me going. If people accepted the world as it is–as the best of all possible–then we would really be in trouble.
jssj19_ep02_li_sound_01 : 6 min
jssj19_ep02_li_sound_02: 06 min. 0 sec.
CA : Je repense à votre cas indonésien d’injustice sans recours. Au-delà du Sud et des contextes autoritaires, j’observe des expressions similaires d’« impuissance » chez les jeunes du Nord lorsqu’ils sont confrontés à l’injustice. Dans son livre In the ruins of neoliberalism: The rise of antidemocratic politics in the West (2019), Wendy Brown explique comment le recul de l’État-nation face à la mondialisation néolibérale et à la montée du capital financier à l’échelle mondiale s’est produit simultanément à la disparition des espaces d’égalité politique et civique et de préoccupation pour les biens publics, et à l’émergence d’une « socialité déterritorialisée et dé-démocratisée ». Qu’en pensez-vous ?
CA: I’m reflecting back again on your Indonesian case of injustice without recourse. Beyond the Global South and authoritarian contexts, I observe similar expressions of “helplessness” among youth of the global North when confronting injustice. In her book “In the ruins of neoliberalism: The rise of antidemocratic politics in the West” (2019), Wendy Brown explains how the erosion of the nation-state in the face of neoliberal globalization and the rise of finance capital worldwide has occurred hand in hand with the disappearance of spaces of political and civic equality and concern for public goods, and the emergence of a “deterritorialized and de-democratized sociality”. What are your thoughts on this?
TL : En Indonésie, la période de démocratie libérale observée dans l’histoire euro-américaine n’a pas eu lieu, et les Indonésiens n’ont jamais connu d’État dédié au bien-être de la population. Malgré cela, nous arrivons au même point. Aujourd’hui, les Indonésiens comme les Européens ont l’impression que personne ne s’occupe vraiment d’eux. Lorsque je lis la description que fait Wendy Brown de cette période de l’histoire américaine, je ressens le besoin de plus d’ethnographie, d’une meilleure compréhension de l’expérience des gens qui en sont venus à se méfier du gouvernement ou de la science.
TL: In Indonesia, the liberal democratic period seen in Euro-American history did not occur, and Indonesians have never known a state dedicated to ensuring people’s welfare. Despite this, we’re arriving at the same point. Both Indonesians and Europeans today feel like no one’s really looking out for them. When I read Wendy Brown’s characterization of this period in American history, I find myself wanting more ethnography–a better understanding of the experience of people who have come to distrust government or science.
Quels termes les jeunes utilisent-ils pour exprimer leur critique, leur aliénation, leur frustration face au statu quo ? Que font-ils de ces idées et de ces sentiments ? S’ils sont attirés par des projets de droite – comme c’est souvent le cas – quels sont les éléments de ces projets qui résonnent avec leur propre compréhension et leurs propres expériences ? Ce ne sont pas seulement les mobilisations progressistes qui devraient nous intéresser, mais toutes sortes de mobilisations (et de non-mobilisations aussi !). Mon inspiration pour ce type de recherche est l’universitaire britannico-jamaïcain Stuart Hall, figure fondatrice des études culturelles, qui a passé la décennie 1980 à essayer de rendre compte de la popularité massive de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne (Hall et al., 2017). Qu’est-ce qu’elle disait et faisait qui trouvait un écho auprès d’une si grande partie de la population, y compris auprès de personnes qui avaient toujours voté pour le parti travailliste par le passé ? Il pensait important d’essayer de comprendre ce moment historique. Pour vraiment comprendre le moment actuel, il faut faire du terrain. Notre rôle devrait être de comprendre les complexités du moment historique actuel sans porter de jugement hâtif.
What terms do young people use to express their sense of critique, their alienation, their frustration with the status quo? What do they do with those insights and feelings? If they are attracted to right wing projects–as is often the case–what are the elements of those projects that resonate with their own understandings and experiences? It is not just progressive mobilizations that should concern us but all kinds of mobilizations (and non-mobilizations too!). My inspiration for this kind of research is the British-Jamaican scholar Stuart Hall, a founding figure in cultural studies, who spent a decade in the 1980s trying to account for the massive popularity of Margaret Thatcher in Britain (Hall et al., 2017). What was it that she was saying and doing that resonated with such a large part of the population, including people who had always voted for the Labour Party in the past? He felt that it was important to try to understand that historical moment. If we really want to understand this moment, we have to do the fieldwork. Our role should be to understand the complexities of the current historical moment without rushing to judgment.
Je pense que nous ne faisons pas notre travail de chercheurs si nous n’étudions que ce que nous voulons voir, ou ce que nous voulons trouver – lorsque cela nous déçoit, nous sommes perdus. La perplexité, voire la déception, devrait être le point de départ de la recherche.
I think we fail as scholars if we only study what we want to see, or what we want to find–then when it disappoints us we’re lost. Being puzzled, or even disappointed, should be the starting point for research.
Dans les études agraires, mon principal domaine de recherche, de nombreux chercheurs négligent les petits agriculteurs qui cultivent avec enthousiasme pour le marché mondial. Ces agriculteurs sont également ignorés par les mouvements sociaux qui cherchent des exemples d’alternatives non capitalistes. Certains lecteurs ont été horrifiés par les conclusions de mon livre Land’s End (Li, 2014) qui explique pourquoi les agriculteurs indigènes de l’île indonésienne de Sulawesi ont abandonné la production vivrière au profit de la culture du cacao. Des activistes m’ont dit que les agriculteurs avaient commis une grossière erreur, mais j’ai supposé qu’ils avaient leurs raisons et que c’était mon travail d’essayer de les comprendre. Pour reprendre les idées fondamentales de Jacques Rancière (1999), faisons le postulat de l’égalité des intelligences.
In agrarian studies, my main field of research, many scholars overlook small-scale farmers who enthusiastically plant global market crops. These farmers are also dismissed by social movements seeking examples of non-capitalist alternatives. Some readers were horrified by the findings of my book Land’s End (Li, 2014) which explores why indigenous farmers on the Indonesian island of Sulawesi abandoned food production in favour of growing cacao. Activists suggested to me that the farmers had made a big mistake, but I assumed that they had their reasons and it was my job to try to make sense of them. Going with Jacques Rancière’s foundational ideas (1999), let’s assume equality of intelligence.
jssj19_ep02_li_sound_02 : 19 min 40 s
jssj19_ep02_li_sound_02: 19 min. 40 sec.
CA : J’aime beaucoup cette remarque sur l’égalité des intelligences. Elle me rappelle ma formation en agriculture comparée et l’hypothèse de base selon laquelle les agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils font. Mais j’aimerais approfondir la question des limites de la recherche, en particulier en ce qui concerne la communication. Que devrions-nous faire pour partager nos connaissances et nous connecter aux différents canaux de diffusion afin de susciter le débat à propos de la justice ?
CA: I really appreciate this comment on the equality of intelligence. It reminds me of my educational background in comparative agriculture and its core assumption that farmers have good reasons to do what they do. But I’d like to pursue the question of failures of research, especially in relation to communication. What should we be doing to share insights and connect with different channels of dissemination to generate debate about justice?
TL : Les recherches conduites pour Plantation Life nous ont convaincus, Pujo et moi, qu’une catastrophe était en train de se produire dans la campagne indonésienne, où un tiers des terres agricoles du pays avaient été placées entre les mains d’entreprises par le biais de concessions renouvelables, privant des millions de familles de l’accès à des terres agricoles, maintenant et pour les générations futures. Nous ressentions le besoin d’intervenir, mais nous avons rapidement pris conscience de nos limites et de notre manque de compétences. Nous avons essayé d’écrire pour des journaux grand public et des magazines d’information indonésiens, et nous avons donné des conférences publiques. Lors d’une de ces conférences à Jakarta, une femme du Conseil national des sciences a exprimé sa gratitude : « Merci d’avoir attiré mon attention sur ce sujet », a-t-elle déclaré, « je n’en avais aucune idée ». Les citadins ignorent souvent totalement ce qui se passe dans les zones rurales de leur propre pays, et encore moins ce qui se passe dans d’autres parties du monde. Ce manque de communication existe à tous les niveaux : de l’urbain au rural, du Nord au Sud, des universitaires au grand public.
TL: The research we undertook for Plantation Life convinced Pujo and me that a catastrophe was unfolding in the Indonesian countryside, where a third of the nation’s farmland had been placed in corporate hands through renewable concessions, robbing millions of families of access to farmland now and in generations to come. We felt a strong need to intervene but quickly realized our limitations and lack of skills. We tried writing for popular Indonesian newspapers and news magazines and gave talks. During one talk in Jakarta, a woman from the National Science Council expressed her gratitude: “thanks for bringing this to my attention”, she said, “I had no idea.” Urban people are often completely unaware of what is happening in rural areas of their own country, and know still less what is happening in other parts of the world. The communication gap exists at every level–from urban to rural, North to South, and academic to popular audiences.
Nous avons été confrontés à de nombreux échecs dans nos efforts de diffusion, même en partageant publiquement des constats provocateurs. Par exemple, un article de presse que j’ai écrit sur l’impunité des entreprises (Li, 2023b), qui demandait pourquoi les entreprises indonésiennes de production d’huile de palme s’affranchissaient de la loi, a immédiatement été vu par 75 000 personnes dans sa version indonésienne. Le thème de l’impunité des entreprises a touché une corde sensible du public indonésien, alors que d’autres articles que nous avions écrits sur les plantations comme forces d’occupation n’ont pas eu le même retentissement. Cette incohérence donne à penser qu’une communication efficace peut dépendre de la capacité à trouver le bon fil conducteur, le bon vocabulaire ou le bon moment.
We faced numerous communication failures despite our efforts to circulate provocative pieces publicly. For example, one news article I wrote on corporate impunity (Li, 2023b) questioning why Indonesian oil palm corporations treat the law as optional, immediately resonated with 75,000 views in its Indonesian version. The theme of corporate impunity struck a chord with an Indonesian public, while other articles we wrote about plantations as an occupying force failed to gain traction. This inconsistency suggests that effective communication might hinge on catching the right thread, vocabulary, or moment.
Un journaliste qualifié m’a aidée à rédiger l’article sur l’impunité. Il m’a guidée sur la façon de simplifier le contenu, de hiérarchiser les points clés et d’éviter les détails excessifs pour maintenir l’intérêt du lecteur. Cette collaboration a permis d’atteindre un lectorat beaucoup plus large que celui que j’aurais pu atteindre par moi-même. J’ai beaucoup appris du journaliste, mais mes compétences restent limitées. Je ne me sens pas obligée de tout faire moi-même. Certains excellent dans la recherche, tandis que d’autres sont plus doués pour la vulgarisation – et la collaboration pourrait être la clé.
A skilled journalist helped me with impunity piece. He coached me on simplifying the content, prioritizing key points, and avoiding excessive detail to maintain reader engagement. This collaboration resulted in a much wider readership than I could have achieved alone. I learned a lot from the journalist, but my skills are still limited. I don’t feel compelled to do everything myself. Some excel in research, while others are better at popular writing–and collaboration could be the key.
Bien que nous vivions dans un environnement saturé de médias, nous ne parvenons souvent pas à communiquer en dehors de nos cercles. En anthropologie, de nombreux auteurs sont profondément investis dans les débats théoriques. Je le suis aussi, mais j’essaie de ne pas laisser la discussion théorique dominer au point d’aliéner les lecteurs non spécialistes. Dans l’introduction de votre numéro spécial, j’ai remarqué que l’écriture est fortement référencée et plus accessible aux universitaires qu’au grand public. Si les espaces universitaires sont nécessaires, nous avons peut-être aussi besoin d’autres formes d’écriture et d’autres formats pour atteindre un public plus large. L’équilibre entre la communication scientifique et l’éducation populaire est une chose sur laquelle nous devons tous travailler de différentes manières.
Despite living in a media-saturated environment, we often fail to communicate outside our circles. In anthropology, many writers are deeply invested in theoretical debates. I am invested too, but I try not to let theoretical discussion dominate to the extent that it alienates non-specialist readers. In the introduction to your special issue, I noticed that the writing is heavily citational and more accessible to scholars than to popular readers. While scholarly spaces are necessary, perhaps we also need other forms of writing and formats to reach a broader audience. A balance between scholarly and popular communication is something we all need to work on in different ways.
Pour citer cet article
To quote this article
Li Tania, Allaverdian Céline, 2025, “Injustice without recourse. Interview with Tania Li” [« Injustice sans recours. Entretien avec Tania Li »], Justice spatiale | Spatial Justice, 19 (http://www.jssj.org/article/injustice-sans-recours-entretien-avec-tania-li/).
Li Tania, Allaverdian Céline, 2025, “Injustice without recourse. Interview with Tania Li” [« Injustice sans recours. Entretien avec Tania Li »], Justice spatiale | Spatial Justice, 19 (http://www.jssj.org/article/injustice-sans-recours-entretien-avec-tania-li/).