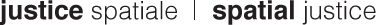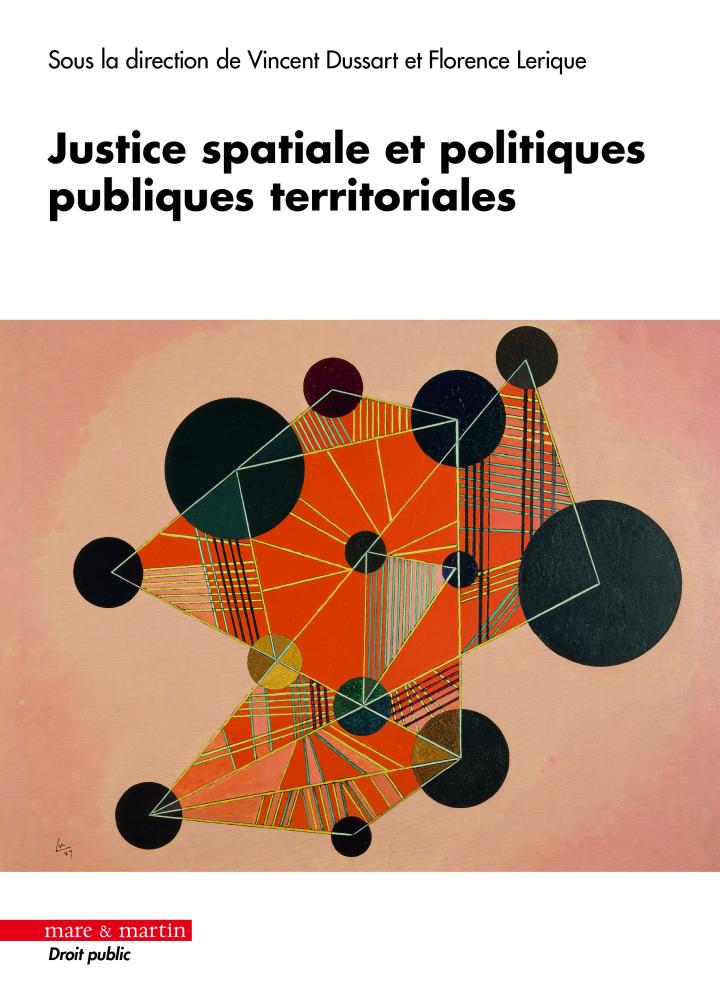
Vincent Dussart, Florence Lerique (dir.)
Justice spatiale et politiques publiques territoriales
Mare et Martin, 2023, 299 p. | commenté par : Estelle Evrard
Si la notion de justice spatiale s’est progressivement établie en géographie depuis les années 1980, elle ne l’est pas, ou peu, en droit. Pourtant, elle est singulièrement familière aux juristes. Le droit n’est-il pas l’art du bon et de l’équitable (Jus est ars boni et aequi) ? D’une part, les principes d’égalité devant la loi et d’égalité des territoires traversent le droit français. D’autre part, le législateur met en place des politiques publiques adaptant ces principes d’égalité afin d’atténuer les inégalités que le contexte social tend à reproduire. Si elle n’est pas explicitement mobilisée en droit, la notion de justice spatiale transpire de la pratique du droit et des politiques publiques. En parallèle, elle permet en géographie et en urbanisme de penser les mécanismes de production des inégalités dans l’espace et entre groupes sociaux. Ce faisant, elle invite à penser l’effectivité des normes juridiques.
Pourtant, l’articulation entre droit et géographie dans la perspective de la justice spatiale reste peu explorée. L’ampleur de la tâche est considérable. Quels outils épistémologiques (en particulier conceptuels et méthodologiques) mobiliser pour penser la justice spatiale en droit ? Sous quelles conditions les fondements ancrés dans d’autres disciplines (philosophie politique, géographie, urbanisme) peuvent-ils constituer des outils mobilisables en droit ? Dans quelle mesure et sous quelles conditions droit et géographie/urbanisme peuvent-ils informer les mécanismes et outils visant à réduire des inégalités ? Au-delà de ces questions de maniement scientifique de la pluridisciplinarité, d’autres, liées à la méthodologie du droit, s’imposent : quel matériau convoquer, comment opérationnaliser l’analyse de la justice spatiale ?
La parution de l’ouvrage Justice spatiale et politiques publiques territoriales contribue à répondre à ces questions. Dirigé par Vincent Dussart et Florence Lerique, ce livre est ancré en droit public, avec un tropisme en droit des collectivités et en aménagement. Il est issu d’une collaboration entre le Centre Maurice Hauriou de l’université Toulouse et le Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe de l’université Panthéon Sorbonne et réunit des contributions de 17 auteurs et autrices spécialistes en droit public, en économie, en géographie et en histoire contemporaine.
L’ouvrage part du constat que la justice spatiale est une notion née de et investie par la géographie sociale, alors que les juristes y participent activement en la « fai[sant] » (p. 11). Pour démontrer comment, ce livre se structure en trois parties, ponctuées de contributions fondées tantôt en droit public, tantôt en géographie/urbanisme. Elles suivent deux chapitres introductifs qui cadrent conceptuellement la notion de justice spatiale.
Dans sa préface, le géographe Jacques Levy rappelle quelques textes fondateurs de la notion de justice spatiale (Rawls, 1971 ; Sen, 2009) et introduit certains enjeux du passage de la justice (normative) à la justice spatiale. Il propose de comprendre la justice comme « une manière cohérente de décrire l’horizon du mouvement vers le mieux que les acteurs politiques dessinent et cherchent à atteindre ». Ainsi, pour lui, la justice n’est effective dans la société contemporaine que depuis que les citoyens sont devenus des « réels acteurs politiques dans le cadre d’une société d’individus » (p. 16-17). Les trois chapitres qui suivent indiquent les fondements historiques et idéaux de principes juridiques ancrés dans la culture sociale française (principes d’égalité devant la loi, d’égalité des territoires). Nathalie Gaussier, Claude Lacour, Florence Lerique, Jean-Marie Pontier et Géraldine Chavrier montrent comment, suivant un principe de réalité, le législateur a progressivement reconnu que ces idéaux constituent des « fictions juridiques ». En mobilisant le principe du maximin de John Rawls, le droit peut adopter des mécanismes visant à faire que les territoires les plus fragiles, du fait de leurs spécificités géographiques, sociales ou spatiales, se voient attribuer certaines possibilités. La société reste « inégale mais d’une inégalité plus juste puisque on aura fait le plus possible pour les plus modestes » (Rivière et Gervay-Lambony, citant Bernard Bret, 2016, p. 218). Au nom d’une plus grande égalité ou d’une lutte contre les disparités injustes, la République met donc progressivement en place des domaines d’exception. Si les auteurs reconnaissent avec nuance les limites des mécanismes étudiés et les risques qui y sont associés (comme le communautarisme), une mobilisation de la notion de capability (Sen, 1999) aurait par exemple permis d’interroger l’effet de ces mesures « par le bas ».
La partie suivante est dédiée à la territorialisation de la justice et se compose de six chapitres. Les implications en matière de justice spatiale de réformes territoriales (partie sur la rationalisation des intercommunalités par Nadine Dantonel-Cor) sont introduites avant l’exploration du rôle structurant pour l’équilibre territorial de politiques sectorielles (mobilité, santé, environnement, Aurore Granero et Gérard-François Dumont) et de la fiscalité (mécanismes des péréquation, Vincent Dussart). Cette analyse de la mise en œuvre de la justice spatiale en droit, depuis l’Union européenne (UE), jusqu’à l’échelle nationale et régionale met en lumière la complexité des transformations dans l’organisation des territoires. Par exemple, Francette Fines et Barbara Thibault mettent en évidence les limites, au niveau EUropéen[1], des instruments des fonds structurels pour contrebalancer effectivement les déséquilibres du marché intérieur. Au-delà de la « nouvelle spatialisation » produite par ces fonds, les conditions d’accès et les mécanismes de gouvernance sont corsetés de sorte qu’ils favorisent les régions ayant des capacités d’administration et de gestion. À l’échelle infranationale, la lecture ancrée en géographie régionale de Gérard-François Dumont s’appuie sur la pensée d’Alexis de Tocqueville et plaide pour un meilleur usage du principe de subsidiarité, contribuant à renforcer la démocratie locale puisqu’il est source d’autonomie et de liberté locale.
La troisième partie de Justice spatiale et politiques publiques territoriales se concentre sur les politiques sectorielles : environnement (Anne Rainaud), action sociale (Robert Lafore), logement (Didier Desponds, Thibault Tellier) et fiscalité locale (Léo Garcia). Tout en rappelant, depuis l’ancrage disciplinaire qui leur est propre, que ces politiques sectorielles ne sont pas explicitement articulées par rapport à la notion de justice spatiale, les auteurs et autrices explorent dans quelle mesure elles y contribuent, par quels mécanismes, et quelles sont leurs limites.
Ce livre met en lumière les dispositifs normatifs – d’équilibre, de répartition, de péréquation, de distribution, de compensation, d’échange, de réciprocité et de solidarité – que certaines politiques publiques en France ou au sein de l’UE conçoivent et appliquent dans un souci de réduire les disparités territoriales et d’accès plus équitable aux chances. Il montre comment, sans explicitement ambitionner de contribuer à une plus grande justice spatiale, certains mécanismes de la force publique normatifs (législatifs, réglementaires, fiscaux) contribuent à la réduction des inégalités territoriales, tout en explorant leurs limites. Les politiques publiques sectorielles (mobilité, santé, environnement) ressortent comme structurantes et complémentaires de l’aménagement du territoire. Ce livre rend explicites les enjeux transversaux de la justice spatiale pour les politiques publiques.
Le socle théorique mobilisé pour analyser les capacités compensatrices de ces mécanismes est essentiellement celui de John Rawls, ce qui conduit une large partie des contributions à se concentrer sur les mécanismes redistributifs des politiques publiques. Une mobilisation plus capacitaire de la justice spatiale informée par Amartya Sen notamment aurait permis d’interroger l’effectivité des outils normatifs en ce qu’ils questionnent les capacités d’action des acteurs publics et des publics visés par les mesures.
Pour le lectorat juriste, ce livre est un précieux outil donnant un éclairage novateur sur les instruments normatifs de politiques publiques qui au niveau national (et en partie au niveau européen) contribuent à soutenir un développement territorial équilibré. L’ancrage empirique sur la norme, son interprétation, les modalités de sa mise en œuvre et l’usage de cas de jurisprudence permet aux auteurs et autrices d’expliciter les effets territoriaux des outils observés.
Si cet ouvrage permet au lectorat géographe/aménageur de se familiariser avec la méthodologie employée en droit pour appréhender des mécanismes normatifs, il lui manque néanmoins une réflexion plus explicite avec la littérature existante dans le champ de la justice spatiale. Par exemple, réaliser la distinction classique entre justice distributive et procédurale (Dufaux et al., 2009) aurait permis de décortiquer la nature des mécanismes normatifs à l’œuvre et de discuter les conditions sous-jacentes limitant leur effectivité. Ce faisant, le livre aurait exploré de manière plus directe comment le droit peut constituer un outil de (re)production des rapports de domination, ou au contraire d’émancipation des groupes sociaux. En comprenant la notion d’espace contenue dans « justice spatiale » essentiellement comme le périmètre institutionnel des acteurs publics à l’origine des mécanismes redistributeurs, ce livre se concentre davantage sur la justice territoriale des politiques publiques. Les pistes proposées pour penser l’effectivité de mesures normatives en faveur d’une plus grande justice spatiale passent donc largement par l’institutionnalisation d’un périmètre, supposant aussi que l’action locale des politiques publiques soit menée et guidée par la proximité avec le terrain.
Il en résulte que l’ouvrage omet en grande partie de problématiser l’espace comme enjeu de luttes où se déploient des stratégies contradictoires entre groupes aux intérêts potentiellement divergents, et de problématiser les mécanismes de domination dans l’espace. Avec son « droit à la ville », Henri Lefebvre (1972) invitait à penser les conditions de rapports sociaux plus équitables dans l’espace. De futurs travaux pourraient interroger dans quelle mesure penser la justice spatiale en droit permettrait d’outiller cette utopie. De manière plus générale, Justice spatiale et politiques publiques territoriales interroge l’effectivité de mécanismes normatifs dans la réduction des disparités (ou injustices territoriales), ce qui pose la question restée sous-exploitée de l’équité de la norme de droit dans l’espace. De futures pistes de recherche pourraient par exemple consister à s’interroger sur les injustices épistémiques (comme les témoignages formulés par des minorités sociales au tribunal ; Fricker, 2007) et les luttes en droit visant à formaliser des mesures correctives. Quels outils épistémologiques mobiliser pour penser, en droit et en géographie, le caractère équitable de la norme dans l’espace ? En s’appuyant sur la géographie du droit (Bony et Mellac, 2020), ce type de réflexion pourrait articuler une pensée critique de la production de la norme de droit et des implications de sa spatialisation.
Bibliographie
Bony Lucie, Mellac Marie, 2020, « Introduction. Le droit : ses espaces et ses échelles », Annales de géographie, 733-734, p. 5-17 (https://doi.org/10.3917/ag.733.0005).
Dufaux Frédéric, Gervais-Lambony Philippe, Lehman-Frisch Sonia, Moreau Sophie, 2009, « No 1. Avis de naissance », Justice spatiale | Spatial Justice (https://www.jssj.org/issue/septembre-2009-edito/, consulté le 04/10/2024).
Fricker Miranda, 2007, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of knowing, Oxford Academic (https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001).
Lefebvre Henri, 1972 [1968], Le Droit à la ville suivi de Espace et politique, Paris, Anthropos.
Rawls John, 1971, A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press.
Rivière Dominique, Gervay-Lambony Philippe 2016, Une rencontre avec Bernard Bret, « Pour une géographie du juste. Lire les territoires à la lumière de la philosophie morale de John Rawls », Annales de géographie, 708(2), p. 213-223.
Sen Amartya, 1999, Commodities and capabilities, New Delhi, Oxford University Press.
Sen Amartya, 2009, The idea of justice, Cambridge, Harvard University Press.
[1] La graphie « EUrope » permet de différencier les initiatives portées par l’Union européenne de celles portées par d’autres organisations européennes sur le continent, comme le Conseil de l’Europe.