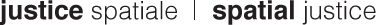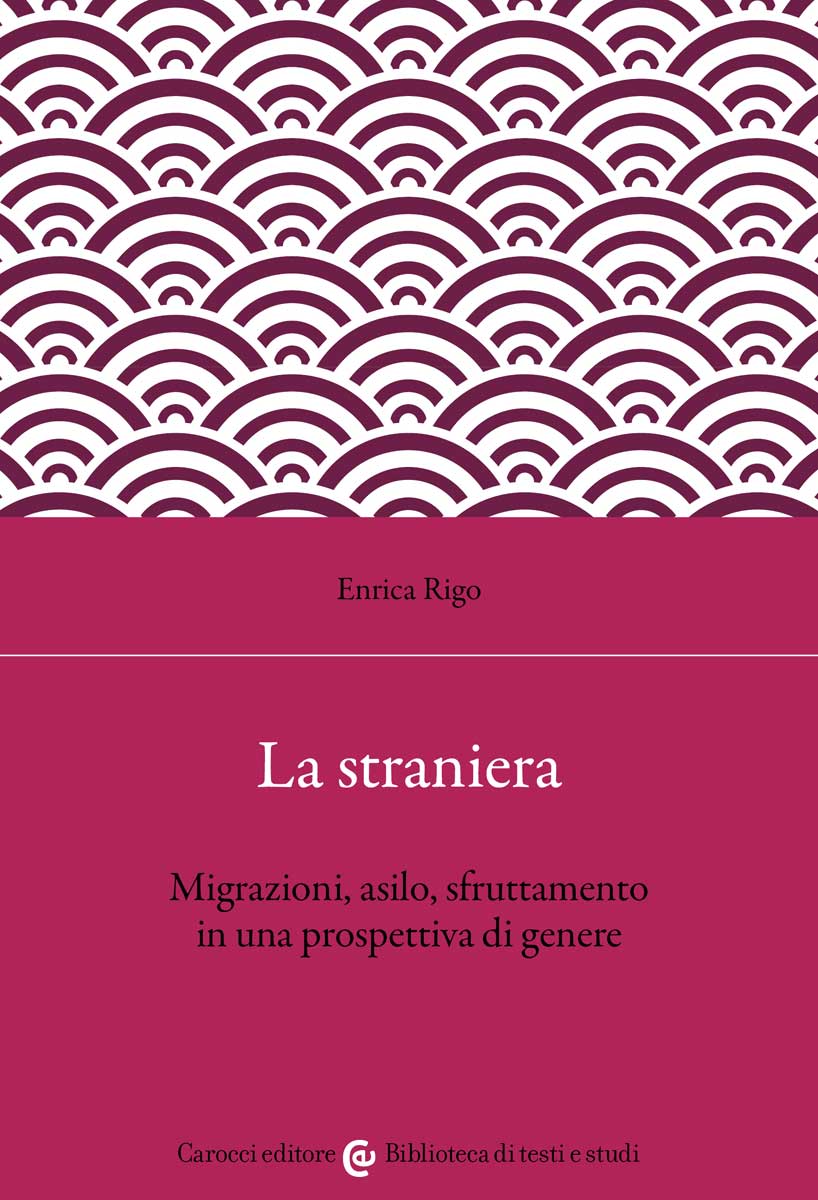
Enrica Rigo
La straniera. Migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere
Carocci editore, 2022, 144 p. | commenté par : Cristina Del Biaggio
Ce livre, écrit par une philosophe du droit, propose une lecture passionnante, y compris pour des chercheureuses en sciences sociales, puisqu’il lie droit, analyse des processus migratoires, de l’exploitation, de la (re)production sociale et du genre. C’est à partir d’un cas concret, celui d’un renvoi forcé, advenu en 2015, de 19 femmes nigérianes demandeuses d’asile depuis le centre de rétention de Ponte Galeria (Italie) vers Lagos qu’Enrica Rigo développe son argumentaire et sa discussion philosophique (voir aussi Rigo, 2019).
Le livre, structuré en quatre chapitres, met en avant le genre dans les questions des migrations et de l’asile (chapitres I et II), pour discuter ensuite les régimes de reproduction sociale – que l’autrice définit comme « l’ensemble des processus et des activités nécessaires à préserver la reproduction de la vie » (p. 7) – et d’exploitation des femmes migrantes (chapitre III), et proposer, enfin, une ouverture sur les concepts d’hospitalité et de liberté de mouvement (chapitre IV).
Enrica Rigo traite clairement de thématiques chères aux chercheureuses qui s’intéressent aux processus à l’intersection des justices spatiale et sociale, notamment dans la dernière partie de son ouvrage, consacrée à la liberté de mouvement, aujourd’hui entravée par des règles fixées par les législations nationales et internationales.
La liberté de mouvement est l’une de ces libertés qui, de nos jours, incarne la double lutte « des classes et des places », théorisée par Michel Lussault (2009). À travers le déplacement des corps, les personnes en migration défient l’une des injustices fondamentales, celle fondée sur le lieu de naissance, comme le rappelle le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) : « La revendication de la liberté de mouvement et d’installation obéit à l’exigence d’appliquer le principe d’égalité et de refuser une discrimination dans l’accès aux droits fondée sur le lieu de naissance et son positionnement dans les rapports de domination économique et politique » (Gisti, 2018, p. 35). La dimension spatiale qui émerge dans la réflexion de Rigo se résume dans cette phrase, contenue dans le dernier chapitre du livre : ce sont les personnes en migration qui « contestent, avec leurs pratiques, les cartes de l’espace politique mondial »[1] (p. 119). En réfléchissant à partir de ces mouvements des corps féminins, l’autrice montre comment « les migrations réécrivent les frontières » (p. 124) et, par son prisme disciplinaire, elle soutient la thèse que c’est à travers cet acte de réécriture des frontières qu’il est possible de « modifier l’un des ordres globaux du droit » (p. 124-125), celui des migrations et des lois et normes qui les régissent.
C’est à partir de cette « revendication sur sa propre vie et sur le droit à la préserver et à la reproduire » que l’autrice défend la thèse selon laquelle « aujourd’hui il est nécessaire de repenser l’étranger en tant qu’étrangère, soit comme un étranger qui, potentiellement, reste » et qui « porte avec soi l’espace de sa propre reproduction sociale » à travers sa « revendication du choix du lieu et de la manière de préserver et reproduire sa propre vie » (p. 124). Elle s’éloigne ainsi de la perception des migrants (et surtout des migrantes) comme victimes, pour défendre au contraire une perspective autonomiste de sujets, dans le sillage de son engagement dans le réseau Frassanito qui, dans les années 2000, avait contribué à faire émerger le concept, aujourd’hui largement adopté dans les Migrations and Border Studies, d’« autonomie des migrations » (Frassanito Network, 2004), parallèlement à la défense de l’ouverture des frontières et de la liberté de mouvement (Rigo, 2020 ; 2023).
L’intérêt d’étudier les migrations à travers la perspective du genre est défendu par l’autrice dans la mesure où, selon elle, le genre est le facteur qui influe le plus sur les choix et les systèmes migratoires, surtout par rapport à l’éventualité (et à la possibilité) que la migration devienne définitive. La philosophe s’appuie ici sur les travaux de Georg Simmel et d’Abdelmalek Sayad. Pour ce dernier, la migration familiale rend les émigrés-immigrés plus semblables à la société d’arrivée, alors que les travailleurs hommes qui émigrent seuls représentent une « altérité radicale » qui rend impossible, aux yeux de la société d’accueil, leur « fixation » (Sayad, 1985). Cet élément permet à Rigo d’affirmer que « l’étranger qui potentiellement reste est, nécessairement, une étrangère » (p. 28).
C’est à partir de ce paradigme que l’autrice construit sa réflexion autour de la (re)production sociale, de la violence et de la protection, dans les chapitres consacrés au « genre des migrations et de l’asile ». Elle « démasque » ainsi la « nature sexuée des frontières » (p. 42) et « met à nu la violence du gouvernement des migrations, au-delà du visage bienveillant derrière lequel les frontières se cachent quand, parallèlement à la fonction de contrôle, elles exercent aussi une fonction de protection » (p. 42). En mettant les migrations féminines au centre de sa réflexion, Rigo interroge la dichotomie entre production et reproduction sociale d’un côté et celle entre migrations économiques et forcées de l’autre, ceci afin de montrer comment se construisent les hiérarchies contemporaines de la ségrégation et de l’exploitation (p. 42). Si, comme elle le suggère, la « distinction entre espace productif et espace reproductif émerge comme une clé d’interprétation fondamentale pour lire les régimes de mobilité » (p. 39), c’est notamment parce que l’espace reproductif, contrairement à l’espace productif, soit à l’espace du travail rémunéré et socialement valorisé, « ne vaut pas comme garantie à l’accès stable au territoire » (p. 39, les italiques sont de Rigo). Et ceci alors même que les migrations forcées, à la différence des représentations victimaires qu’elles véhiculent, produisent aussi de la force de travail (p. 39) et ne devraient donc pas être analysées uniquement à travers le prisme de la reproduction sociale.
C’est parce que les migrations féminines sont emprisonnées dans le paradigme de la reproduction sociale et dans les discours victimaires qu’il y a une sorte d’obsession politique et médiatique à identifier les coupables : soit chez les trafiquants d’êtres humains, soit dans les politiques qui ne sont pas en mesure d’empêcher ces activités criminelles (p. 45). La focalisation sur les trafiquants met en effet l’accent sur la relation entre victime et agresseur, « en masquant le contexte social et économique dans lequel la violence se produit » (p. 74). Or, comme le propose Rigo, interroger le genre de l’asile permet justement de s’interroger sur la façon dont les femmes arrivées en Europe pour demander l’asile contestent et re-signifient le politique (p. 49). Pour ce faire, l’autrice retrace la manière dont les problématiques spécifiques aux femmes ont été incluses (ou pas) dans les textes fondamentaux qui régissent le droit d’asile, et en particulier la Convention de Genève de 1951. Elle discute notamment la jurisprudence sur l’octroi du droit d’asile aux femmes victimes de violence, en reprenant la distinction proposée par Andrea Binder (2001) : la reconnaissance de la traite comme forme de violence dont les femmes sont l’objet en tant que femmes prime sur celle de la reconnaissance de la violence contre les femmes parce que femmes (p. 63). C’est à partir de là que Rigo s’interroge sur la tendance, de la justice italienne, à ne plus considérer le genre dans la définition du « groupe social » (art. 1, al. 2) mais plutôt dans celle des « femmes victimes de traite », effaçant ainsi les éléments structurants de la violence envers les femmes (p. 70-71).
Parmi ces éléments structurants qui créent violence et exploitation, notamment envers les femmes migrantes, Rigo pointe le droit international et le droit pénal. Ce sont les limitations à la liberté de mouvement que le droit impose qui se traduisent en situations de vulnérabilité pour les femmes, et qui rendent possible leur exploitation (p. 97). L’autrice conclut donc sur la nécessité d’intervenir politiquement sur le droit pour pouvoir agir sur les processus d’exploitation (p. 97). Elle construit sa défense de la liberté de mouvement (p. 103-104) en partant du constat que la possibilité de traverser les frontières se fonde sur la distinction entre « celleux qui comptent et celleux qui ne comptent pas », et en s’appuyant sur les écrits d’Achille Mbembe (Mbembe, 2019) et d’Étienne Balibar (Balibar, 2001). Elle développe son raisonnement à partir de la contradiction qui s’est construite entre droit à la protection (et à la vie) d’une part et politique des frontières de l’autre : « Dans un tribunal fuir la violence sexuelle et de genre, la violence de l’exploitation patriarcale, la traite, peut être reconnu [pour l’obtention d’une protection] ; dans la politique des frontières et du confinement des migrations “forcées”, cela justifie, au contraire, le blocage des frontières au nom de la lutte contre les trafiquants et de la défense des intérêts nationaux » (p. 106). Rigo analyse cette contradiction au prisme du concept, développé par Patricia Tuitt (2016), d’« a-légalité » : « Le fait que migrer […] ne corresponde pas à un droit d’accès au territoire n’est pas la conséquence d’un “vide” réglementaire, mais au contraire d’un plein qui actualise la possibilité d’exclure les migrants avant l’accès aux frontières nationales. […] Dans les paroles de Tuitt, les violences et les mort·es aux frontières montrent comment les politiques migratoires globales ont actualisé l’a-légalité du principe de non-refoulement, en la déplaçant de l’ordre du juridiquement relevant à celui du monstrueux, en laissant les réfugié·es sans endroit où aller sur Terre » (p. 106)[2]. Or l’autrice rappelle que tout projet migratoire, y compris celui qui est dicté par la nécessité de la fuite devant des situations de violence, est aussi une pratique qui « revendique une place différente dans le monde », « un lieu où vivre contre ou malgré les politiques institutionnelles de confinement, d’exploitation et de ghettoïsation » (p. 108).
Développant son argumentaire en empruntant les mots de Tendayi Achiume, Rigo soutient l’idée selon laquelle la mobilité, y compris celle qui n’est pas autorisée, doit être comprise comme une « puissante technologie pour créer, consolider et réformer la communauté politique » (Achiume, 2019). C’est donc en s’appuyant sur les approches décoloniales que Rigo nous permet de « boucler la boucle » et de revenir aux propos que j’ai cités en introduction : c’est à travers ces corps qui désobéissent aux règles de l’immobilité que l’injustice fondamentale fondée sur le lieu de naissance peut être défiée, et ce sont ces corps désobéissants qui obligent à « prendre au sérieux ce qui est exclu des ordres juridiques globaux […] en l’ouvrant à la possibilité de diverses mises en œuvre » (p. 109). Car ce sont ces corps, comme l’autrice le rappelle en reprenant Luigi Ferrajoli, qui fondent le « pouvoir constituant d’un nouvel ordre global » (Ferrajoli, 2018).
C’est, en quelque sorte, par la justice spatiale et la géographie dessinée par les corps en mouvement que l’on peut imaginer réformer le droit vers plus de justice sociale.
Bibliographie
Achiume Tendayi, 2019, « Migration As Decolonization », Stanford Law Review, 71, p. 1509-1574.
Balibar Étienne, 2001, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte (https://www.cairn.info/nous-citoyens-d-europe–9782707134608.htm, consulté le 17/09/2024).
Binder Andrea, 2001, « Gender and the “Membership in a Particular Social Group” Category of the 1951 Refugee Convention », Columbia Journal of Gender and Law, 10(2) (https://doi.org/10.7916/cjgl.v10i2.2429).
Del Biaggio Cristina, Noûs Camille, 2020, « Migrer au travers des frontières », in Anne-Laure Amilhat Szary, Grégory Hamez, Frontières, Paris, Armand Colin, p. 238-245.
Ferrajoli Luigi, 2018, « La questione migranti: Italia incivile, Europe incivile », Critica marxista, 5, p. 9-15.
Frassanito Network, 2004, Movements of Migration. The Frassanito Network at the European Social Forum/London 2004 (www.noborder.org/files/movements_of_migration.pdf, consulté le 17/09/2024).
Gisti, 2018, « Finalement, la liberté de circulation », Plein droit, 116(1), p. 35.
Lussault Michel, 2009, De la lutte des classes à la lutte des places, Paris, Grasset.
Mbembe Achille, 2019, « Bodies as Borders », From the European South, 4, p. 5-18 (https://www.fesjournal.eu/wp-content/uploads/2021/08/2.Mbembe.pdf, consulté le 17/09/2024).
Rigo Enrica, 2019, « Re-Gendering the Border: Chronicles of Women’s Resistance and Unexpected Alliances from the Mediterranean Border », ACME: An International Journal for Critical Geographies, 18(1), p. 173-186 (https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1436, consulté le 17/09/2024).
Rigo Enrica, 2020, « Struggles for Freedom within and against the Legal Order at the Borders of Europe », South Atlantic Quarterly, 119, p. 182-192 (https://doi.org/10.1215/00382876-8007877).
Rigo Enrica, 2023, « Mobility, Social Reproduction and Exploitation: A Critical Legal Perspective on the Tension between Capitalism and Freedom of Movement », Feminists@law, 12(2) (https://doi.org/10.22024/UniKent/03/fal.1218).
Sayad, Abdelmalek, 1985, « L’immigration algérienne. Une immigration exemplaire », in Jacqueline Costa-Lascoux, Émile Temime, Les Algériens en France : genèse et devenir d’une migration, Paris, Publisud, p. 19-49.
Tuitt Patricia, 2016, « A-Legality and the Death of the Refugee », Law and Critique, 27, p. 5-8 (https://doi.org/10.1007/s10978-015-9172-x).
[1] Toutes les traductions du livre sont de l’autrice de la recension.
[2] Voir aussi Del Biaggio et Noûs, 2020.