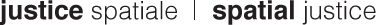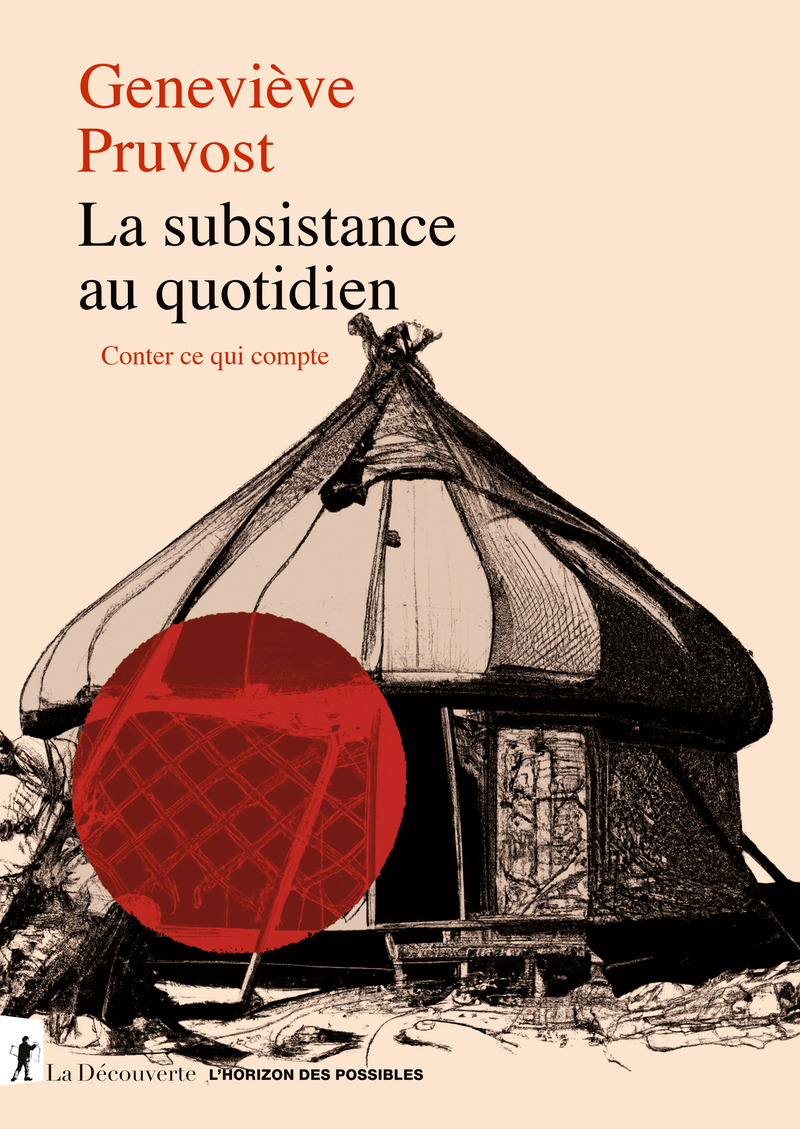
Geneviève Pruvost
La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte
La Découverte, 2024, 504 p. | commenté par : David Frati
La subsistance au quotidien nous fait découvrir le mode de vie d’un couple de paysans « maraîchers-éleveurs-apiculteurs-boulangers à plein temps » (p. 195) qui refusent la production alimentaire industrielle et vivent dans une yourte avec leur enfant dans le village de Valondes (les lieux ont été anonymisés). L’autrice pose la question de ce qui compte quand des gens cherchent « à vivre en prise directe avec leur milieu de vie » (p. 6), et le plus éloigné possible de la production marchande et manufacturière. Geneviève Pruvost a enquêté neuf jours auprès de ce couple dans le cadre d’une enquête plus large sur les modes de vie ruraux alternatifs, qui avait déjà donné lieu à un premier livre, Quotidien politique, également publié aux Éditions de La Découverte (2021).
L’autrice propose ici un ouvrage de lutte, et elle utilise dès les premières pages un vocabulaire du combat, voire de la guerre. Il y est question de « lutte territoriale » (p. 7), de « conquête de lieux » (p. 7) et de « guerre de position » (p. 16). C’est donc une lutte pour l’espace qui nous est contée ici. Constatant que « la citoyenneté a été décorrélée du droit à la terre et à l’eau nourricière » (p. 6), l’objectif de ce livre est de « raconter une alternative concrète » pour « donner de la consistance scientifique et politique à des expériences méconnues » (p. 22), et de démontrer la viabilité d’une vie en retrait du monde marchand chez des paysans pour qui l’espace est « à la fois la fin et le moyen de l’activité quotidienne » (p. 14). Pour cela, Geneviève Pruvost s’approprie très fidèlement la méthode ethnocomptable présentée pour la première fois par Alain Cottereau et Moktar Mohatar Marzok dans leur ouvrage Une famille andalouse (2012). Cette méthode permet de faire découvrir de manière exhaustive ce qui compte et comment on le compte lorsqu’on tente de se déprendre de la consommation marchande, de la production industrielle, de la mise en valeur du foncier, bref, lorsque l’on tente d’échapper à l’hégémonie du capitalisme. Pour montrer la viabilité de ce mode de vie, l’enquêtrice nous fait entrer pleinement dans les plis les plus fins de la vie quotidienne du couple, grâce à une première partie entièrement dédiée à une restitution ethnographique passionnante et époustouflante de détails (230 pages). Celle-ci est complétée par une soixantaine de tableaux extrêmement détaillés en deuxième partie, et une analyse sociologique rigoureuse de ce mode de vie, particulièrement pertinente sur les questions spatiales, en troisième partie.
Conter ce qui compte
La première partie de l’ouvrage s’ouvre presque immédiatement sur le récit ethnographique de la vie quotidienne du couple et de leur petite fille. La narration est dense, sèche, rapide, à l’image du rythme de vie des protagonistes, et en même temps extrêmement minutieuse et détaillée.
Ce récit, qui pourrait être lu comme un roman, intertitres mis à part, n’en est pourtant pas un. La narration ne prend jamais clairement parti entre le récit du quotidien du couple et le récit de la vie de l’ethnographe prise dans le rythme de vie des enquêtés. Geneviève Pruvost fait sans arrêt part de questionnements et de surprises, ce qui permet de découvrir non seulement ce qui compte pour les paysans, mais aussi ce qui compte pour l’enquêtrice ethnocomptable : préférer prendre ses notes au vol à la main, malgré la douleur au poignet, à la prise de note sur ordinateur portable posé sur les genoux, qui met trop à distance (« À trop consigner, je suis passée à côté de la rythmique du pain. », p. 138). Les jugements moraux par rapport à son propre mode de vie urbain (par exemple, sur la consommation de produits laitiers, p. 90) sont des portes qu’elle ouvre pour que nous nous posions des questions à notre tour. Ce choix de ne jamais trancher entre un récit détaché et un journal de bord personnel est finalement ce qui permet le plus d’entrer pleinement dans la vie quotidienne de l’enquêtrice embarquée dans celle, intense, du couple de paysans.
Le rythme des journées peut d’ailleurs poser question. La vie de ces deux « baba speed » (p. 424-430) qui cherchent à être intègres et exemplaires dans leurs refus de la consommation marchande tourne autour d’un travail intense, dans un rythme de vie essoufflant, au point que l’on peut se demander ce qu’il en devient de la question du plaisir, et de ce que les enquêtés tirent de ce mode de vie, au-delà de la satisfaction d’être exemplaires. L’autrice arrive justement à retranscrire un plaisir loin du tandem travail-loisir, à travers des moments de réjouissance construits autour d’un travail réapproprié qui n’est plus aliéné par le rythme du salariat (p. 143, notamment).
Le plaisir de notre lecture est lui aussi bien réel. La découverte de ce mode de vie se fait, on l’a dit, à travers une description d’une richesse et d’une rigueur exceptionnelles qui donne lieu à des moments de surprise ou de suspense magnifiquement retranscrits, comme la castration d’un chevreau (p. 88-91) ou la mesure de la température du four à pain (p. 147-148).
La tension principale du récit réside dans l’importance de la question foncière pour les deux enquêtés qui souhaitent étendre leur activité par l’achat d’une nouvelle parcelle, tout en refusant d’entrer dans des logiques de rendement imposées par l’État, par le statut légal d’agriculteur, qui encourage les grandes propriétés et la mécanisation du travail. Alors, faire un prêt, se mécaniser, s’agrandir, se spécialiser… ? Ce sont autant de questions ambivalentes qui travaillent en permanence ces paysans alternatifs en prise avec la question foncière, à la fois hypothétique ouverture ou fermeture des horizons du possible.
Faire avec les chiffres, contre les chiffres
La deuxième partie de l’ouvrage, composée de 61 tableaux et de deux schémas, tranche radicalement avec le récit de la première. Après une telle immersion dans la vie quotidienne, pourquoi des tableaux ? La question se pose d’autant plus qu’ils peuvent paraître aller à l’encontre des discours portés à la fois par les enquêtés et par l’autrice (« pourquoi recourir au chiffrage, alors que les alternatives écologiques dénoncent la mise en cases du monde par le libéralisme capitaliste ? », p. 27.) Si, comme le souligne Geneviève Pruvost, l’abstraction chiffrée a participé au cours du temps à transformer le monde en marchandise, elle rappelle que d’autres se servent ou se sont servis des chiffres dans des visées d’émancipation collective (p. 29). Ces chiffres ethnocomptables, qui cherchent à rationaliser un mode de vie qui s’appuie beaucoup sur la débrouille et sur un sens pratique résolument ancré dans le réel plutôt que sur une connaissance purement théorique du monde vivant, sont en fait un outil de lutte : il s’agit de combattre avec les chiffres de la vie quotidienne et du savoir situé contre les chiffres des richesses des nations (p. 25). Si l’entrée peut paraître abrupte, ces tableaux sont beaucoup plus accessibles qu’il n’y paraît de prime abord pour qui a déjà parcouru la première partie et a en tête tous les éléments de la vie quotidienne du couple. En effet, ces tableaux servent à une description plus fine du réel, en superposition au récit ethnographique, et non à une rationalisation chiffrée et détachée de la compréhension de ce qui fait sens pour le couple.
Nous ne revenons pas en détail sur ce passionnant « kaléidoscope ethnocomptable » (p. 265) qui passe par un relevé de l’acquisition des parcelles (tab. 1 et 2), un inventaire extrêmement détaillé de toutes les possessions du couple (tab. 9 à 15), un relevé de chaque activité par poste (tab. 16 à 21, 24, 25, 28 à 32), ou encore un emploi du temps à plusieurs entrées qui, dans la perspective féministe de l’autrice, croise l’activité principale avec l’activité secondaire (déjeuner en prenant des décisions, s’occuper de l’enfant en même temps que des chèvres…) avec une précision déconcertante (tab. 50 à 54). Ces tableaux permettent de prendre une autre mesure de l’ampleur du travail réalisé par les deux protagonistes. Ce long déroulé se conclut sur le tableau le plus significatif pour le combat que mène cet ouvrage : l’autrice établit que les soldes annuels sont positifs (2 634 euros en 2012, 1 002 euros en 2013), et démontre ainsi que ce mode de vie est viable économiquement. Les deux schémas qui closent cette partie montrent l’inscription territoriale de cette activité, et préparent au contenu de la partie analytique.
De la maisonnée au territoire
Les analyses thématiques de la troisième partie de l’ouvrage complètent les réflexions de Geneviève Pruvost qui parsèment déjà, ici et là, le texte du journal. Les questions spatiales reviennent souvent comme un point central de l’analyse.
Un premier chapitre (« Politisation du moindre geste ») analyse les différents niveaux de cohérence territoriale de ce mode de vie qui s’insère dans les mailles d’un espace délimité administrativement et dépasse la délimitation politique de la parcelle administrative. Trois niveaux d’action (échelles de la maisonnée, du maillage des dynamiques locales, et des mouvements sociaux) permettent de dessiner « un territoire cohérent par-delà les frontières administratives » (p. 356). Telle est la force de l’enquête ethnocomptable, étude « écologique » (p. 476) dans le sens où elle s’intéresse aux relations entre les choses dans un milieu, plutôt qu’aux choses elles-mêmes, et qui permet d’étudier les dynamiques d’un territoire à plusieurs échelles à partir de l’étude concrète de la vie quotidienne.
En partant de l’analyse du mode de vie en habitat léger (chapitre « Vivre en yourte »), l’étude ethnocomptable met en évidence une dé-spécialisation des espaces qui servent à des tâches différentes selon les moments ou même des prêts et des échanges qui sont faits avec d’autres maisonnées. Ces paysans sont tout sauf autonomes : le territoire, « espace réticulaire de droits d’usage chez les voisins, les copains, la famille, contre services » (p. 397), est à la fois le substrat et le résultat d’un réseau d’entraide rendant possible ce mode de vie alternatif, dégagé de la spécialisation de l’espace et de la division du travail d’un monde manufacturé.
Le chapitre « Un coin de terre où se poser pour basculer » est une partie très importante de l’ouvrage qui met au jour les dynamiques d’appropriation foncière qui permettent ce mode de vie visant, pourtant, à se situer en dehors d’un contrôle rationnel de l’espace de subsistance par un État promouvant l’agriculture industrielle. L’autrice rappelle que la disponibilité de foncier à la vente est la toute première condition à l’établissement d’une population de paysans alternatifs. Il y a peu de terrains oubliés ou délaissés dans ce territoire, ni même de mise en location de terrains communaux, et la possibilité de squat d’une parcelle qui permettrait la subsistance d’une maisonnée n’est pas envisageable. L’installation est néanmoins possible grâce à l’existence de parcelles en mauvais état ou boisées qui se vendent à un prix modique, dans un territoire où l’arrivée de paysans alternatifs en grand nombre n’a pas (encore) eu lieu, ce qui participe au maintien d’un prix de foncier bas (p. 371). La question de la propriété privée se présente donc comme une contradiction importante : « Comment celles et ceux qui promeuvent un mode de vie critique peuvent-ils privilégier l’option de la propriété ? » (p. 370). La propriété privée devient là, justement, la modalité centrale d’un refus du capitalisme, car elle offre une stabilité qui permet de ne pas être expulsable par un État méfiant. Plus encore, ces terres appropriées par les paysans alternatifs se situent dans un réseau d’entraide et servent d’espace d’accueil aux nouveaux arrivants : garer sa roulotte, élever quelques bêtes ou installer un potager permet de commencer à s’ancrer dans le territoire le temps de devenir propriétaire (p. 376). Ces terres servent aussi à la population nomade (travailleurs saisonniers, festivaliers, travellers…) qui, en tant que groupe social, est une composante à part entière du territoire (p. 383). Si les terres achetées peuvent servir de port d’attache aux amis mobiles (p. 385), ces derniers peuvent servir à occuper un lieu pour qu’il ne paraisse pas vacant lorsque ses propriétaires partent (et c’est d’ailleurs le rôle joué par l’autrice au moment de l’enquête, car elle a occupé la roulotte d’une amie du couple qui était partie).
Considérant que « l’impossibilité d’accès à un territoire minimal de subsistance commune constitue une inégalité majeure, tant sur le plan de l’autonomie matérielle que de l’autonomie politique » (p. 475), Geneviève Pruvost montre ici que l’appropriation collective de l’espace par des maisonnées intégrées dans leur milieu social et écologique constitue un excellent outil de mise à distance des logiques d’exploitation marchande de la nature au profit d’une reprise en main de la subsistance individuelle et collective. La force de la démonstration de ces pages d’analyses repose sur la rigueur de la démarche ethnocomptable qui est donnée à voir de manière spectaculaire dans les deux premières parties de l’ouvrage. Le choix d’aborder la cellule familiale comme une « maisonnée » lui permet de « revisiter les divisions classiques faites habituellement entre engagement individuel et collectif, entre espace public et espace privé, entre mise en réseau à bas bruit et mouvements sociaux spectaculaires, entre militantisme affinitaire et institutions » (p. 475), et de démontrer que, derrière la vie d’un couple de paysans qui cherche à vivre de manière intègre et exemplaire son refus du monde marchand, c’est en fait tout un territoire qui résiste à la standardisation imposée par le capitalisme. En entrant par la vie quotidienne, l’autrice démontre que l’espace est un outil de reproduction et de maintien de la rationalité marchande et, en même temps, qu’il offre la possibilité de renversement de cette rationalité : cela fait de cet ouvrage une véritable concrétisation du projet de recherche lefebvrien (Lefebvre, 1958 ; Busquet, 2012). On n’attendrait pas nécessairement d’une sociologue du travail et du genre une lecture territoriale aussi claire et ambitieuse. Et pourtant, La subsistance au quotidien devrait passionner toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à des questions d’appropriation collective de l’espace. Plus encore, cette enquête est une invitation à se saisir de la méthode ethnocomptable qui constitue, comme le montre merveilleusement le travail de Geneviève Pruvost, une superbe entrée dans la géographie de la vie quotidienne.
Bibliographie
Busquet Grégory, 2012, « L’espace politique chez Henri Lefebvre : l’idéologie et l’utopie », Justice spatiale | Spatial justice, 5 (https://www.jssj.org/article/lespace-politique-chez-henri-lefebvre-lideologie-et-lutopie/, consulté le 20/09/2024).
Cottereau Alain, Marzok Moktar Mohatar, 2012, Une famille andalouse : ethnocomptabilité d’une économie invisible, Saint-Denis, Bouchène.
Lefebvre Henri, 1958, Critique de la vie quotidienne. I. Introduction, Paris, L’Arche.
Pruvost Geneviève, 2021, Quotidien politique, Paris, La Découverte.