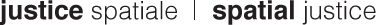Ce numéro « Luttes, territoires et justice spatiale » s’inscrit dans le récent essor des travaux sur les mobilisations et la géographie de l’action collective, dont il souhaite prolonger les analyses (Auyero, 2005 ; Ripoll, 2008 ; Mahoudeau, 2016). On observe en effet depuis plus d’une décennie une augmentation des ouvrages et des numéros de revues visant à étudier ces « formes particulières d’action collective » (Rui, 2010) à travers leur dimension spatiale (Melé et Neveu, 2019 ; Pailloux et Ripoll, 2019). Ce champ a d’abord été structuré dans la géographie anglophone (Miller, 2000 ; Miller et Martin, 2000) et par la sociologie des mouvements sociaux prenant en compte l’espace des mobilisations (Mathieu, 2012 ; Pailloux et Ripoll, 2019). La « mobilisation » est ici entendue comme un moment de mise en relation de pouvoirs entre des groupes ou des collectifs qui portent des revendications impliquant d’une manière ou d’une autre le gouvernement (en tant que médiateur, objet ou cible des revendications) (Mc Adam et al., 2001).
This issue on “Struggles, territories and spatial justice” is part of the recent surge in work on mobilisations and the geography of collective action, and seeks to build on analyses in these fields (Auyero, 2005; Ripoll, 2008; Mahoudeau, 2016). For more than a decade, there has been an increase in the number of books and journal issues focusing on these “particular forms of collective action” (Rui, 2010) from the perspective of their spatial dimension (Melé and Neveu, 2019; Pailloux and Ripoll, 2019). This field first emerged in English language geography (Miller, 2000; Miller and Martin, 2000) and in the sociology of social movements, where attention is given to the spaces in which mobilisations arise (Mathieu, 2012; Pailloux and Ripoll, 2019). “Mobilisation” is understood here as a moment when power relations arise between groups or collectives that are making demands that involve the government in one way or another (as mediator, object or target of the demands) (Mc Adam et al., 2001).
L’inscription dans ce champ de recherche constitué s’accompagne d’une volonté de renouveler les apports de la littérature sur les luttes : en établissant le rapport qu’elles entretiennent avec la justice, en examinant leur dimension territoriale, et en interrogeant leurs enjeux au prisme de l’informalité. Comment les luttes territoriales se saisissent-elles de la justice spatiale ? La notion de territoire peut-elle être considérée comme un outil conceptuel pour penser les luttes contre les injustices spatiales ? Comment ces luttes mettent-elles en relation des rapports de pouvoir, des positionnements, et des modes d’action qui s’inscrivent dans un continuum entre pratiques informelles et dynamiques d’institutionnalisation ?
Within this established field of research, we aim to make new contributions to the literature by establishing the relationship between struggle and justice, by examining their territorial dimension, and by exploring them through the prism of informality. How do struggles relate to spatial justice? Can the notion of territory be seen as a conceptual tool for thinking about struggles against spatial injustice? How do these struggles establish connections between power relations, positions and modes of action that form part of a continuum between informal practices and the dynamics of institutionalisation?
Ce numéro s’attache ainsi à analyser des luttes portées par une aspiration à la justice et par la contestation de diverses formes d’inégalités (sociales, raciales, économiques, environnementales…). Mais au nom de quelle justice se mobilise-t-on ? Parler de « luttes » implique une dimension contestataire, à contre-courant, quand la sociologie des mouvements sociaux fait plus souvent référence à l’« action collective ». Si ces deux formulations peuvent désigner des mouvements sociaux comparables, ce choix terminologique incite à mettre l’accent sur des périodes de cristallisation ou d’accélération de ces luttes, se prêtant à une transformation active du « territoire ». Les luttes que nous considérons comme territoriales définissent-elles leurs objectifs en termes de justice ? Nous faisons le choix d’analyser les luttes au prisme du territoire, en suivant un raisonnement dialectique : tout d’abord, comment se territorialisent-elles, en articulant des dimensions matérielles (ou spatiales), culturelles (ou symboliques) et politiques (ou sociales) ; et comment, ensuite, un territoire est-il aussi produit par des formes d’action collective, informelles ou en cours d’institutionnalisation, qu’elles soient autonomes ou hybridées par des interactions avec les pouvoirs publics.
This issue looks at struggles that are driven by a desire for justice and by challenges to various forms of inequality (social, racial, economic, environmental, etc.). But what kind of justice do these mobilisations serve? To speak of “struggle” implies a dimension of protest, swimming against the tide, whereas the sociology of social movements more often refers to “collective action”. While these two formulations can refer to comparable social movements, this choice of terminology encourages a focus on periods when these struggles coalesce or accelerate, contributing to the active transformation of “territory”. Do the struggles that we consider to be territorial define their goals in terms of justice? We analyse struggles through the prism of territory and follow a dialectical line of reasoning: firstly, we consider how struggles are territorialised, by connecting material (or spatial), cultural (or symbolic) and political (or social) dimensions; and secondly, how a territory is produced by forms of collective action, whether informal or in the process of institutionalisation, whether those forms are autonomous or hybridised by interactions with public authorities.
L’action collective est ici entendue au sens large de la « politique contestataire » telle que définie par Doug McAdam et ses coauteurs (2001), et saisie dans sa capacité à transformer le(s) territoire(s) et leur(s) gouvernement(s). Car, et c’est la troisième entrée que nous retenons, ces mobilisations en faveur de la justice peuvent relever d’une action collective organisée, mais le terme de « luttes » évoque également des modes d’action plus spontanés, que recouvre en partie le concept d’informalité. Les luttes sur lesquelles nous nous penchons seraient de cette manière des formes d’action collective territorialisées engageant un dialogue ou une contestation collective en dehors des cadres d’une démocratie sociale impliquant des acteur·rice·s contestataires repéré·e·s et rencontré·e·s dans des cadres de négociation définis. Nous y reconnaissons ce que Asef Bayat (2013) et Ananya Roy (2009) qualifient d’« insurgent » en référence à des formes ascendantes de transformation du territoire. Ce numéro permet ainsi de s’intéresser à ce que les mobilisations révèlent de la tension, d’une part, et des hybridations, d’autre part, entre une fabrication informelle du territoire (par le bas, spontanée, issue de la société civile) et des formes d’aménagement plus institutionnalisées (initiées et encadrées par les pouvoirs publics, par le haut). L’informalité et l’institutionnalisation sont, dans ce contexte, entendues comme des concepts non exclusifs, éminemment poreux et le plus souvent hybridés (McFarlane, 2012).
Collective action is understood here in the broad sense of “protest politics” as defined by Doug McAdam and his co-authors (2001), and understood in terms of its capacity to transform territory(ies) and their government(s). This is because–and this is our third point of entry–these mobilisations in support of justice may be part of organised collective action, but the term “struggle” also evokes more spontaneous modes of action, which are partly covered by the concept of informality. In this sense, the struggles we are considering would be forms of territorialised collective action in which dialogue or collective protest take place outside social-democratic frameworks that involve identified protest actors and are encountered within set negotiating frameworks. Here we recognise what Asef Bayat (2013) and Ananya Roy (2009) describe as “insurgent” in reference to bottom-up forms of territorial transformation. This issue of the journal therefore looks at what mobilisations reveal about both the tension and the hybridisations between an informal construction of territory (bottom-up, spontaneous, emerging from civil society) and more institutionalised forms of planning (top-down, initiated and supervised by the authorities). In this context, informality and institutionalisation are understood as non-exclusive concepts that are highly porous and often hybrid (McFarlane, 2012).
S’engager et se positionner dans des luttes territoriales
Engaging and taking up positions in territorial struggles
Les textes réunis renvoient aux débats sur l’engagement et la positionnalité des chercheur·euse·s, et interrogent sur une éventuelle spécificité en la matière des travaux sur les luttes. La littérature scientifique relative à celles-ci invite les chercheur·euse·s à la réflexivité pour définir où iels « se situent ». Ces luttes territoriales sont d’ailleurs bien souvent examinées par des chercheur·euse·s se réclamant des courants critiques, qui engagent à une forte réflexivité, afin d’analyser les biais d’enquête, notamment. En effet, au-delà de la seule condition d’accès au terrain, la publicisation du positionnement et de la participation de ces dernier·ère·s à ces luttes est consubstantielle de leur démarche scientifique. Pour des raisons éthiques, iels réfutent toute idée de neutralité, en particulier quand la recherche s’insère au sein de champs de pouvoirs (conflictuels). Si le double ancrage qui en découle – académique et militant – est bien souvent revendiqué dans la littérature scientifique anglophone (voir par exemple Ferreri et al., 2024, p. 470 ; Tubridy, 2024), il peut faire l’objet d’une défiance et être considéré comme moins légitime par les instances politiques et universitaires françaises. Les propositions d’articles reçues pour ce numéro témoignent d’une certaine discrétion des auteur·rice·s sur leur positionnement au cours de ces luttes. Plus largement, ces questions d’engagement s’articulent avec les temporalités des recherches restituées : alors que les chercheur·euse·s réuni·e·s dans ce numéro sont présent·e·s au début des luttes, dans les moments d’ébullition et les acmés de mise en visibilité, on trouve moins d’enquêtes au long cours sur les suites, les échecs et les enlisements de ces mobilisations dans les articles du numéro (sur une observation de mobilisation sur le long terme, voir par exemple Lion [2024]). Par ailleurs, produire de la recherche sur ces luttes territoriales et explorer les émotions qui s’y font jour participent aussi d’une démarche des chercheur·euse·s impliqué·e·s pour légitimer ces dimensions longtemps niées ou ignorées par la recherche urbaine.
The texts in this collection reflect the debates about the engagement and positionality of researchers, and raise questions about the possible specificity of work on struggle in this respect. The relative scientific literature invites researchers to reflect on where they “stand”. These territorial struggles are often studied by researchers who identify with critical currents and who are committed to a high degree of reflexivity, particularly in the analysis of research biases. Indeed, over and above the mere condition of access to the field, the public nature of their position and participation in these struggles is inherent to their scientific approach. For ethical reasons, they reject any idea of neutrality, particularly when research is carried out in (conflicting) spheres of power. While the dual positioning–as academic and activist–that arises from this is often stated openly in English-language scientific literature (see, for example, Ferreri et al., 2024, p. 470; Tubridy, 2024), it may be viewed with suspicion and perceived as less legitimate by French political and academic institutions. The authors of the article proposals submitted for this issue also display a certain discretion as to their position during these struggles. More broadly, these questions of engagement are linked to the timeframes of research: while researchers are present at the start of struggles, in moments of turmoil and maximum visibility, there are fewer long-term investigations into the aftermath, the failures and momentum losses of these mobilisations (on this topic, see Lion [2024]). Moreover, producing research on these territorial struggles and exploring the emotions that emerge in them are also part of a process whereby the researchers involved seek to legitimise these aspects, which have long been denied or neglected in urban research.
Ce que la justice spatiale fait aux luttes
The impact of spatial justice on struggles
Comment les luttes territoriales définissent-elles la justice, et comment défendent-elles la justice spatiale ? Une approche désormais classique des luttes a pu un temps les réduire à leur caractère de proximité ou de riveraineté, et à une démarche qualifiée de « NIMBY » (Not in My Backyard [pas dans mon jardin]). Cette figure caricaturale de l’opposant·e arc-bouté·e sur son intérêt particulier au détriment de l’intérêt général (Sintomer, 2007) masque un enjeu analytique : quels référentiels de justice sont mobilisés par les acteur·ice·s des luttes, sachant que des référentiels de justice partagés contribuent également à mettre en mouvement des collectifs et donc à favoriser une territorialisation des luttes ?
How do territorial struggles define justice, and how do they advocate spatial justice? There has been a tendency for these struggles to be reduced to their local or neighbourhood character, and to NIMBYism. This caricature of an opponent fixated on their own interest to the detriment of the wider community (Sintomer, 2007) masks an analytical issue: what criteria of justice do participants in such struggles adopt, bearing in mind that shared frames of reference regarding justice also helps to set groups in motion and therefore to encourage the territorialisation of struggle?
Les articles présentés dans ce numéro abordent ainsi les luttes territoriales dans leur complexité et interrogent les enjeux de justice qu’elles induisent. Ils font état d’injustices produites par des systèmes de domination structurels et une « violence spatiale » où l’espace constitue un moyen de perpétuer un « ordre social violent » (Allaverdian et al., 2023). Ces injustices sont partie prenante de systèmes spatiaux qui viennent en appui d’une production capitaliste de l’espace (concentration illimitée de capitaux productrice d’inégalités sociales) et d’une variété de dispositifs de prédation ou d’oppression (comme l’apartheid, la colonisation, la surexploitation des ressources naturelles, etc.), et qui font l’objet de contestations. Toutefois, lutter n’implique pas nécessairement un engagement en faveur de plus de justice sociale. La défense d’une fermeture des frontières ou d’une préférence territoriale (nationale, par exemple) existe, et ses partisan·e·s sont nombreux·ses à se mobiliser, notamment dans les urnes.
The articles in this issue address the complexity of these territorial struggles and the issues of justice they raise. They point to injustices produced by structural systems of domination and “spatial violence” in which space is a means of perpetuating a “violent social order” (Allaverdian et al., 2023). These injustices are part and parcel of spatial systems that support capitalist production of space (social inequalities produced by unlimited concentration of capital) and a variety of predatory or oppressive systems (such as apartheid, colonisation, over-exploitation of natural resources, etc.), and which are targets of protest. However, the readiness to fight does not necessarily imply a commitment to greater social justice. The defence of closed borders or territorial (e.g. national) preference exists, and its supporters mobilise in large numbers, particularly at the ballot box.
Ce numéro de JSSJ rassemble des articles qui entreprennent d’analyser des luttes que nous considérons comme territoriales, et qui s’attachent en particulier à qualifier les injustices en jeu, et à détailler les théories de la justice à l’œuvre dans leur diversité (Rawls, 1971 ; Young, 1990 ; Bret, 2015). Ces textes mettent également en évidence comment des représentations concurrentes du juste peuvent coexister au cœur des luttes territoriales.
This issue of JSSJ brings together articles that attempt to analyse struggles that we consider to be territorial, and question injustices and state the criteria of justice at work (Rawls, 1971; Young, 1990; Bret, 2015). These texts also highlight how competing representations of justice can coexist at the heart of territorial struggles.
Saisir les luttes par le territoire
Understanding struggle through territory
Ce numéro fait suite à de nombreux travaux qui ont démontré l’importance de la dimension spatiale dans l’analyse des mouvements sociaux. Ces contributions se sont notamment attardées sur la manière dont l’espace conditionnait les formes de l’action collective. Pour William Sewell, les mouvements sociaux sont ainsi « façonnés et contraints par l’environnement spatial dans lequel ils s’inscrivent, mais participent également de la production de nouvelles structures et relations spatiales » (2001, p. 5). Dans le but d’apporter un autre regard sur la géographie des mobilisations, nous avons fait le choix de nous appuyer sur la notion de territoire. Si son usage est beaucoup moins répandu que celui d’espace pour saisir les mobilisations sociales, il n’est pour autant pas absent des littératures francophone, anglophone et latino-américaine.
This issue draws on a number of studies that have demonstrated the importance of the spatial dimension in the analysis of social movements. These contributions focused in particular on how space conditions the forms of collective action. For William Sewell, social movements are thus “shaped and constrained by the spatial environment in which they take place, but also participate in the production of new spatial structures and relations” (2001, p. 5). In order to look at the geography of mobilisation differently, we employ the notion of territory. Although it is much less widely used than the concept of space as a means to understand social mobilisation, it is not absent from French, English and Latin American literature.
Depuis les années 1980, des débats qui opposent les tenant·e·s de la notion d’espace à celleux qui promeuvent celle de territoire traversent la géographie française (Ripoll et Veschambre, 2004). Ces deux notions, étroitement liées dans la géographie française, sont bien distinctes et ne sont pas interchangeables. Pour nous, la notion de « territoire » traduit une forme d’appropriation spatiale (Le Berre, 1995), qui résulte d’une action humaine. Cette appropriation pouvant être contestée, nous appréhendons le territoire comme un enjeu de luttes. Ce sont les interventions d’une pluralité d’acteur·rice·s, poursuivant des objectifs qui peuvent être divergents ou communs, en fonction de moyens hétérogènes et selon des stratégies évolutives, qui fondent un territoire. Saisir les luttes par le territoire dirige alors l’attention vers les acteur·rice·s qui les construisent et soulève la question de « la dimension spatiale du pouvoir » (Klein, 1996, p. 36). Enfin, nous retenons des définitions du « territoire » une dimension idéelle ou immatérielle, mise en avant par la géographie culturelle (Soja, 1971 ; Bonnemaison, 1981 ; Chivallon, 1999), pour laquelle il se rapporte à un système de représentations et de valeurs qui participe à la cristallisation d’une identité.
Since the 1980s, French geography has been riven by debates about the use of “space” vs that of “territory” (Ripoll and Veschambre, 2004). These two notions, which are closely linked in French geography, are quite distinct and not interchangeable. For us, the term “territory” reflects a form of spatial appropriation (Le Berre, 1995) that arises from human action. As this appropriation can be contested, we envision territory as a battleground. The actions of a wide range of actors, pursuing either divergent or common objectives, possessing heterogeneous resources and employing evolving strategies, form the basis of a territory. Conceiving struggles in terms of territory directs attention to the people taking part in them, and raises the question of “the spatial dimension of power” (Klein, 1996, p. 36). Finally, the definitions of “territory” include an ideal or immaterial dimension, highlighted by cultural geography (Soja, 1971; Bonnemaison, 1981; Chivallon, 1999), in which territory relates to a system of representations and values that help to crystallise an identity.
Des débats sur ces deux notions sont également présents dans la littérature anglophone. En effet, la conceptualisation de l’espace y est largement dominante, comme le rappelle Fabio Duarte dans un ouvrage de 2017 sur l’espace (space), le lieu (place) et le territoire (territory). Notre propos s’inscrit alors dans la continuité de celui d’auteur·rice·s anglophones qui voient dans le territoire un « outil de praxis politique produit et contesté » (Ince, 2012, p. 1646), reconnaissant une agentivité à une diversité de groupes sociaux et ne limitant pas à l’État l’exercice d’un pouvoir sur l’espace. Cette approche ouvre notamment la voie à l’analyse de la production de territoires par et depuis des actions collectives, dont certaines se déroulent dans un cadre conflictuel et peuvent ainsi être envisagées en tant que luttes territoriales.
Debates about these notions are also present in Anglophone literature, where the concept of space largely prevails, as Fabio Duarte showed in a 2017 book on space, place and territory. Our argument is in line with that of authors who see territory as a “tool of political praxis that is produced and contested” (Ince, 2012, p. 1646), recognising the agency of a diverse spectrum of social groups rather than confining it to the exercise of power over space by the state. In particular, this approach opens the way to analysing the production of territories by and through collective actions, some of which take place in a situation of conflict and can therefore be seen as territorial struggles.
Depuis ce « retour du territoire » (Painter, 2010) dans la littérature anglophone, qui s’est également enrichi d’une perspective féministe (Jackman et al., 2020), plusieurs ouvrages et articles (Escobar, 2008 ; Agnew et Oslender, 2013 ; Routledge, 2015) se sont plus particulièrement intéressés à la manière dont les mouvements sociaux se territorialisent et aux apports de la notion de territoire pour l’étude de l’action collective contestataire, prolongeant par là une approche féconde au sein de la littérature latino-américaine (Sandoval et al., 2017 ; Halvorsen, 2018), et en particulier les travaux du géographe brésilien Bernardo Mançano Fernandes. À partir de sa proximité avec le mouvement des travailleurs ruraux sans terre au Brésil, il développe, en lien avec les travaux de Jean-Yves Martin (2001), le concept de mouvements socioterritoriaux (Fernandes, 2005).
Since this “return of territory” (Painter, 2010) in Anglo literature, which has also incorporated a feminist perspective (Jackman et al., 2020), a number of books and articles (Escobar, 2008; Agnew and Oslender, 2013; Routledge, 2015) have focused on how social movements are territorialised and how “territory” can add to the study of collective protest action, echoing an approach that has been fruitful in Latin American literature (Sandoval et al., 2017; Halvorsen, 2018), and in particular in the work of Brazilian geographer Bernardo Mançano Fernandes. Drawing on his close links with the landless rural worker movement in Brazil, he developed the concept of socio-territorial movements (Fernandes, 2005), in conjunction with the work of Jean-Yves Martin (2001).
Dans le cadre de ce numéro, nous cherchons à appréhender les luttes comme des actions collectives territorialisées qui s’établissent dans la durée et dans une confrontation avec d’autres organisations (dont des institutions) par la mise en œuvre d’objectifs politiques nécessitant une appropriation à la fois spatiale et idéelle. Les luttes territoriales sont donc définies par la combinaison d’une configuration et d’une appropriation spatiales, d’un substrat culturel immatériel, d’une action politique et d’une inscription évolutive dans le temps long.
In this issue, we seek to understand struggles as territorialised collective actions that develop over time and in confrontation with other organisations (including institutions) through the implementation of political objectives that require both spatial and ideological appropriation. Territorial struggles are therefore defined by the combination of spatial configuration and appropriation, an intangible cultural substratum, political action and evolving embeddedness over time.
Les luttes se territorialisent tout d’abord à travers la mise en application de projets politiques, dans le cadre d’une confrontation avec ceux de l’État et du capital, rappelant que le territoire est toujours le produit d’un rapport de force (Raffestin, 1980). Selon Sam Halvorsen, Mançano Fernandes Bernardo et Valeria Torres Fernanda, « la relation entre un mouvement socioterritorial et l’État (à différentes échelles de gouvernement) est centrale en raison de la dépendance mutuelle ou l’antagonisme qui peut survenir une fois qu’un mouvement atteint une taille suffisante pour revendiquer des ressources politiques et économiques significatives » (2019, p. 1466). Les luttes territoriales naissent alors des interactions entre acteur·rice·s, et de la confrontation spatialisée entre des mobilisations sociales et une autorité, souvent représentée par la puissance publique.
Struggles are territorialised first and foremost through the implementation of political projects, in the context of a confrontation with the projects of the state and of capital, reminding us that territory is always the product of a balance of power (Raffestin, 1980). According to Sam Halvorsen, Mançano Fernandes Bernardo and Valeria Torres Fernanda, “the relationship between a socio-territorial movement and the state (at different scales of government) is central because of the mutual dependence or antagonism that can arise once a movement reaches sufficient size to claim significant political and economic resources” (2019, p. 1466). Territorial struggles therefore arise from the interactions between actors, and from the spatialised confrontation between social mobilisations and an authority, often public authorities.
Les luttes territoriales étudiées dans ce numéro s’illustrent donc par la place qu’elles accordent à la remise en cause des mécanismes du marché, qui participe également à la transformation des territoires en dehors des cadres institutionnels : ainsi, la production urbaine est saisie comme le produit d’une conception néo-libérale de la société (Hackworth et Moriah, 2006 ; Peck et Tickell, 2002 ; Jessop, 2002). L’État y est l’acteur majeur de l’accroissement des prérogatives du marché privé (du logement, par exemple). Le brouillage des responsabilités inhérent aux politiques urbaines néo-libérales (Swyngedouw, 2011) apparaît alors à travers ces luttes qui ont pour ambition de remédier à des injustices. Les moments de conflits contribuent à mettre au jour des normes et les contraintes de l’action publique ainsi que les idéologies qui les sous-tendent, et à déconstruire les mécanismes de légitimation qui y sont liés (Roy, 2011).
The territorial struggles studied in this issue stand out for the importance they assign to challenging market mechanisms, which also play a part in the transformation of territories outside institutional frameworks: the making of the city is thus seen as the product of a neoliberal conception of society (Hackworth and Moriah, 2006; Peck and Tickell, 2002; Jessop, 2002). The state plays a major role in increasing the market powers (e.g. the housing market). The blurring of responsibilities inherent in neoliberal urban policies (Swyngedouw, 2011) can be seen in these struggles to remedy injustices. Moments of conflict help to reveal the norms and constraints of public action, as well as the ideologies that underpin them, and to deconstruct the mechanisms of legitimisation associated with them (Roy, 2011).
La territorialisation des luttes produit en outre une socialisation politique, par exemple à partir d’une circulation des expériences individuelles et de mise en commun des trajectoires militantes, favorisant le développement de l’activisme. Elle traduit ainsi la politisation de mobilisations qui ne naissent pas, pour la majorité d’entre elles, dans le cadre d’un engagement politique, mais qui articulent progressivement des valeurs sociales à leurs dimensions spatiales, où peuvent notamment se croiser des enjeux de reproduction (travail de la terre ou procréation) et de soin porté à l’espace de l’intime et de la sphère domestique (le domicile, précaire ou durable). Loin de se limiter à une logique de quotidienneté, les luttes territoriales portent donc des enjeux politiques qui sont fortement liés à des revendications en matière de justice : droit au logement, maintien des classes populaires en centre-ville, désenclavement, dépossessions foncières et expulsions, apartheid… Le passage de l’appropriation d’un espace, souvent familier, à la production d’un territoire traduit de cette façon une montée en généralité des revendications.
The territorialisation of struggle also produces political socialisation, for example through the circulation of individual experiences and the interplay of trajectories of political action, which encourage the development of activism. It thus reflects the politicisation of movements which, for the most part, do not originate in political engagement, but which progressively link social values to their spatial dimensions, where–in particular–issues of reproduction (working the land or procreation) and care for the private and domestic spheres (the home, whether temporary or permanent) may intersect. Far from being confined to the everyday, territorial struggles have larger political implications that are closely linked to demands for justice: the right to housing, maintaining a working-class presence in the city centre, interconnection, land grabbing and eviction, apartheid, etc. The shift from appropriating an area, often a familiar one, to creating a territory, reflects the growing generality of these demands.
Les luttes territoriales se fondent ensuite, dans leur dimension matérielle, sur des configurations spatiales variables et dont les limites ne sont pas fixes. Elles se territorialisent en effet à des échelles plus ou moins vastes, par la combinaison d’une occupation durable et d’occupations temporaires, se distinguent par ailleurs par des dynamiques spatiales de concentration ou au contraire de dispersion, et par des mouvements qui les voient se déplacer d’une périphérie vers un centre ou depuis ce dernier vers des espaces de repli. Les luttes évoluent donc de la défense de lieux menacés, en tant qu’unités spatiales ponctuelles et circonscrites (Piveteau, 2010), vers l’appropriation d’un espace plus vaste, contribuant alors à leur territorialisation. Cette diffusion spatiale s’accompagne d’une circulation des pratiques et des stratégies contestataires, notamment lorsque les luttes analysées s’articulent avec d’autres pour intégrer des revendications plus générales. La dimension matérielle des luttes territoriales se lit ensuite dans une pratique occupationnelle tangible, récurrente et visible (Ripoll et Veschambre, 2005), qui fait de l’espace approprié une ressource stratégique pour faire entendre des revendications en matière de justice.
The material dimension of territorial struggles is founded in variable spatial configurations whose boundaries are not fixed. Indeed, they are territorialised on scales of varying size, through a combination of long-term and temporary occupancies, and are distinguished by spatial dynamics of concentration or dispersal, and by movements that run from a periphery to a centre or from a centre to areas of withdrawal. Struggles thus evolve out of the defence of threatened places as specific and circumscribed spatial units (Piveteau, 2010), to the appropriation of a wider space, thus contributing to their territorialisation. This spatial diffusion goes hand-in-hand with a circulation of practices and strategies of protest, particularly when the struggles analysed join with others in pursuit of more general demands. The material dimension of territorial struggles can then be seen in a tangible, recurring and visible practice of occupation (Ripoll and Veschambre, 2005), which turns appropriated space into a strategic resource to have demands for justice heard.
Néanmoins, cette appropriation matérielle de l’espace ne suffit pas à qualifier les luttes de « territoriales ». En effet, la territorialisation des luttes réside également dans une appropriation symbolique et dans la construction d’une identité collective qui relie la mobilisation à un territoire (voir Keith et Pile, 1993 ; Featherstone, 2008, Halvorsen et al., 2019). De nombreux travaux ont souligné le rôle des affects et des émotions dans l’engagement individuel et collectif (Goodwin et al., 2001 ; Juris, 2008 ; Traïni, 2015 ; Dechézelles et Olive, 2016 ; Melé et Neveu, 2019) et attesté des ressorts liés à l’attachement aux lieux dans la structuration de nombreux mouvements sociaux (Altman et Low, 1992 ; Stedman, 2003 ; Devine-Wright, 2009). Le processus d’attachement, éventuellement construit dans la durée, apparaît comme étant à l’origine d’émotions (colère, peur, tristesse…), elles-mêmes vectrices de mobilisation (Guinard et Tratnjek, 2016). Le territoire est alors un support (et un outil) de manifestation d’émotions collectives d’opposition, tout autant que l’objet de manifestations d’attachement, qui nourrissent également des projets politiques.
Nevertheless, this material appropriation of space is not enough for struggles to be described as “territorial”. The territorialisation of struggle also lies in symbolic appropriation and in the construction of a collective identity that links a mobilisation to a territory (see Keith and Pile, 1993; Featherstone, 2008, Halvorsen et al., 2019). Numerous studies have highlighted the role of affects and emotions in individual and collective engagement (Goodwin et al., 2001; Juris, 2008; Traïni, 2015; Dechézelles and Olive, 2016; Melé and Neveu, 2019) and attested to the factors associated with attachment to place in the construction of many social movements (Altman and Low, 1992; Stedman, 2003; Devine-Wright, 2009). The attachment process, which may be constructed over time, appears to be a source of emotions (anger, fear, sadness, etc.), which in turn trigger mobilisation (Guinard and Tratnjek, 2016). The territory is thus a medium (and a tool) for expressing collective emotions of opposition as well as being the object of expressions of attachment, which also fuel political projects.
Enfin, nous retrouvons dans les articles réunis dans ce numéro une dynamique de pérennisation des luttes et de l’investissement militant, que nous considérons caractéristique des luttes territoriales qui s’inscrivent plus largement dans un processus de territorialisation, déterritorialisation et reterritorialisation (Fernandes, 2005). La territorialisation des mouvements est en effet indissociable d’un ancrage temporel et spatial de l’action collective. Cette dernière s’ancre alors à la fois dans une histoire, par la défense d’un patrimoine individuel, collectif, ou les deux, et dans une projection temporelle. Les luttes étudiées dans ces textes se font en réaction à une situation, visible à un moment donné. Pour autant, elles relèvent aussi de temporalités plus étendues, où l’objet de la lutte donne lieu à une construction mémorielle liée au territoire. Chaque mouvement cherche de cette manière à s’inscrire dans une histoire locale ou supralocale en partie choisie et mobilisée pour les besoins de la cause. Cette dimension mémorielle et cette histoire politique du territoire – parfois en décalage avec l’histoire officielle – constituent alors une ressource pour les luttes étudiées. La temporalité des luttes est donc centrale dans l’analyse de leur processus, qu’il s’agisse d’une référence à une histoire de lutte, ou à un lien sur le temps long – un ancrage – à un territoire. On observe en outre que les luttes analysées sont relatives à des enjeux qui s’inscrivent dans la durée, qui devient un élément déterminant de leur territorialisation.
Finally, in the articles collected in this issue we find a dynamic of long-term struggle and activist engagement which we consider characteristic of territorial struggles that are more broadly part of processes of territorialisation, deterritorialisation and reterritorialisation (Fernandes, 2005). The territorialisation of movements is inextricably linked to the temporal and spatial embeddedness of collective action. This action is thus rooted both in a history, through the protection of an individual or community legacy, or both, and in a projection of time. The struggles studied in these texts are a reaction to a situation that is visible at a given moment. However, they are also part of a longer timeframe, in which the object of struggle gives rise to the construction of a territorially-linked memory. In this way, each movement seeks to become part of a local or supralocal history that is partly chosen and mobilised for the purposes of the cause. This dimension of memory and this political history of the territory–sometimes at odds with official history–are a resource for the struggle. The timeframe of struggles is therefore central to the analysis of their process, whether the reference is to a history of struggle, or to a long-term link to, or embeddedness in, a territory. We can also see that the struggles analysed relate to long-term issues, so that time becomes a determining factor in their territorialisation.
Articulation des pouvoirs dans les luttes territoriales, entre fabrique ordinaire et informalité
Articulation of powers in territorial struggles, between ordinary making and informality
Issues de la confrontation entre des mobilisations contestataires et des autorités, publiques en particulier, les luttes territoriales participent à une fabrique ordinaire des villes au sens de Jennifer Robinson (2006). Ainsi, si elles peuvent parfois se cristalliser dans des moments de visibilisation particulière (manifestations, occupation ponctuelle), une partie des mobilisations étudiées s’inscrivent dans la durée, au quotidien. À distance de mobilisations encadrées, les luttes analysées dans ce numéro sont aussi plus souvent le fait des « subalternes » ou d’« urbains dépossédés » (Bayat, 2007, p. 581). Elles sont décrites ici per se, les études proposées se penchant assez peu sur les réponses institutionnelles apportées, pouvant néanmoins se dessiner en creux.
A product of the confrontation between protest movements and authorities, particularly public authorities, territorial struggles are part of the ordinary making of cities as defined by Jennifer Robinson (2006). So while they may sometimes coalesce in moments of particular visibility (demonstrations, one-off occupations), some of the mobilisations studied are part of a long-term, day-to-day process. Far from being organised mobilisations, the struggles analysed in this issue are also more often the work of “subalterns” or “dispossessed city dwellers” (Bayat, 2007, p. 581). They are described here in their own right, as the studies proposed do not focus much on the institutional responses, though these can be glimpsed in the background.
Étudier les luttes territoriales permet ainsi d’analyser les « zones grises » (Yiftachel, 2009), les « arrangements » (Bayat, 2013 ; collectif Inverses et al., 2016), au cœur de la fabrication du territoire, là où ce dernier est discuté et disputé. L’étude de ces mobilisations, traversées par l’articulation entre dimensions informelle et institutionnelle, permet d’aborder le caractère pluriel, ordinaire et négocié de la fabrication des territoires (Bayat, 2013). Ce numéro aide ainsi à cerner plus spécifiquement comment les luttes – contestations localisées, définies dans le temps, et en dehors des arènes de débat public – contribuent non seulement à produire du territoire, mais aussi à brouiller ses processus de fabrication, entre institutionnalisation et informalité.
To study territorial struggles is thus a way to analyse the “grey areas” (Yiftachel, 2009), the “arrangements” (Bayat, 2013; collectif Inverses et al., 2016) at the heart of the making of territory, where territory is discussed and disputed. Through the study of these mobilisations, characterised by a connection between informal and institutional dimensions, we are able to look at the plural, ordinary and negotiated nature of the production of territories (Bayat, 2013). This issue thus illuminates more specifically how struggles–localised disputes, defined over time and outside the arenas of public debate–contribute not only to producing territory, but also to blurring the processes–part institutional and part informal–by which it is produced.
Les luttes territoriales analysées par les auteur·rice·s de ce numéro ont lieu à distance de répertoires d’actions institutionnalisés (Tilly, 1984). Elles allient ainsi fréquemment des pratiques ayant fortement intégré les contraintes juridiques et d’autres, plus revendicatives, qui relèvent éventuellement de l’illégalité ou, plus souvent, d’une « zone grise ». Elles usent en effet de modes d’action généralement informels et peu institutionnalisés, hybridés de modes de contestation plus formels et réguliers.
The territorial struggles analysed by the authors in this issue take place at a distance from institutionalised repertoires of action (Tilly, 1984). They frequently combine practices that have taken full account of legal constraints with other, more forceful practices that may be illegal or, more often, in a “grey area”. They use modes of action that are generally informal and not much institutionalised, hybridised with more formal and regular forms of opposition.
Ce numéro montre donc en quoi les luttes territoriales contribuent à contester des formes de gouvernement tout en se situant à l’écart des cadres institutionnalisés, c’est-à-dire en usant de pratiques informelles. Les articles mettent également au jour combien l’action publique est elle-même pétrie d’informalité. Ce fait, déjà bien établi par la littérature, est central dans le déclenchement de certaines luttes. Dans plusieurs textes, le rôle de l’État se caractérise par l’usage de pratiques arbitraires ou bureaucratiques qui peuvent bénéficier aux acteur·rice·s privé·e·s. Elles peuvent en outre se traduire par des pratiques autoritaires, à l’occasion de projets urbains comme au quotidien, dans les dispositifs de violence légale et l’action de la police. Dans les luttes pour plus de justice, l’informalité apparaît alors comme la création active de marges de manœuvre (collectif Inverses et al., 2016) par les militant·e·s, afin d’utiliser de manière tactique (de Certeau, 1990) des failles et des champs des possibles territorialisés.
This issue therefore shows how territorial struggles contribute to challenging forms of government while remaining outside institutionalised frameworks, in other words by means of informal practices. The articles also highlight the extent to which public action is itself steeped in informality. This fact, already well established in the literature, is central to the triggering of certain struggles. In several texts, the role of the state is characterised by the use of arbitrary or bureaucratic practices that may benefit private actors. It can also be reflected in authoritarian practices, both in urban projects and in processes of everyday legal violence and in police action. In struggles for greater justice, informality thus appears to be the way activists actively create room for manoeuvre (collectif Inverses et al., 2016) in order to make tactical (de Certeau, 1990) use of territorialised loopholes and potentialities.
Des articles pour croiser luttes et territoires
Articles that link struggles and l territories
Les objets des luttes étudiées par les auteur·rice·s de ce numéro sont particulièrement divers, ne se limitant ni à l’arène du quartier, ni à l’échelle du projet d’aménagement, ni au contexte de l’urbain dense. Sont en effet analysés ici autant des luttes relatives à l’échelle de bassins de vie que des espaces ruraux, ou des processus urbains non planifiés et ordinaires. Les articles qui composent ce numéro appréhendent tous la relation croisée entre lutte et territoire, en soulevant la diversité des enjeux de justice qui fondent les mobilisations et les hybridations dynamiques de ces dernières, entre informalité et institutionnalisation.
The struggles studied by the authors in this issue are particularly diverse, not confined to the neighbourhood arena, to the scale of development projects or to dense urban areas. Here, the analysis encompasses struggles taking place at the scale of public spaces, rural areas and unplanned, ordinary urban processes. The articles in this issue all look at the intersecting relations between struggle and territory, highlighting the diversity of the issues of justice that underpin mobilisations and their dynamic hybridisation between the informal and the institutional.
L’article de Margaux de Barros étudie la manière dont la discrimination raciale et la ségrégation sociospatiale héritée de l’apartheid au Cap suscitent une mobilisation contre la gentrification et les expulsions locatives. À partir de cette revendication pour une plus grande justice en matière d’habitat, des occupations ponctuelles ou plus durables permettent une montée en généralité de la lutte et traduisent la dimension territoriale du répertoire d’action utilisé par le mouvement Reclaim the City. En effet, au-delà d’une simple appropriation physique de l’espace par des actions informelles, la lutte se territorialise par la mise en scène d’une appartenance des classes populaires au quartier de Woodstock, à travers la dimension symbolique que revêtent l’occupation d’un hôpital public en centre-ville, le marquage territorial par les slogans revendicatifs ou encore la pratique de « l’escrache » (pratique de shaming localisée).
Margaux de Barros’s article looks at how racial discrimination and the socio-spatial segregation inherited from apartheid in Cape Town are driving mobilisation against gentrification and tenant evictions. On the basis of the demand for greater justice in housing matters, one-off or longer-term occupations have helped to broaden the struggle and have reflected the territorial dimension of the repertoire of action employed by the Reclaim the City movement. Indeed, beyond the simple physical appropriation of space through informal actions, the struggle has been territorialised by the staging of working-class identity in the Woodstock district, through the symbolic dimension of the occupation of a public hospital in the city centre, the territorial marking of protest slogans or the practice of “escrache” (localised shaming).
S’opposant également à des injustices sociales et économiques relatives au logement, les pratiques du collectif Réquisitions, analysées par Annaelle Piva et Oriane Sebillotte, donnent naissance à Paris à un « territoire de la lutte pour le droit au logement [qui] résulte de l’appropriation, même éphémère, de l’espace ». Ce dernier apparaît alors comme un support pour la territorialisation de la lutte, en favorisant sa visibilisation et sa médiatisation, et en créant un rapport de force avec les autorités locales. Ainsi, les occupations de bâtiments publics ne se limitent pas à une réponse aux besoins de personnes sans-abri. Elles contiennent une dimension politique de plus grande ampleur qui remet en cause la vacance immobilière et le primat de la valeur d’échange sur la valeur d’usage, et qui permet de « faire territoire par la lutte ». Enfin, les autrices montrent que les interactions avec les pouvoirs publics et la dynamique d’institutionnalisation de l’action collective conduisent à une perte de la capacité d’autogestion des contestataires, construite dans des initiatives informelles, et à leur démobilisation.
The practices of the Réquisitions Collective, analysed by Annaelle Piva and Oriane Sebillotte, also oppose social and economic injustices in the housing sphere in Paris, giving rise to a “territory of struggle for the right to a home [which] arises from the seizure of space, however ephemerally”. The latter is seen as a means of territorialising the struggle, raising its profile and attracting media attention, and creating a balance of power with the local authorities. So, occupations of public buildings are not just a way to respond to the needs of homeless people. They contain a broader political dimension that challenges the prevalence of vacant properties and the primacy of exchange value over use value, and which makes it possible to “[make] territory through struggle”. Finally, the authors show that interactions with public authorities and the progressive institutionalisation of collective action resulted in the protesters losing their capacity for self-organisation–a capacity developed through informal initiatives–and becoming demobilised.
Le rôle de la politisation d’un mouvement au départ fondé sur l’occupation d’un espace circonscrit et du changement d’échelle de la mobilisation qu’elle induit dans la territorialisation d’une lutte se retrouve dans le texte de Lucile Garnier. Celui-ci pointe comment la défense des jardins du Bas-Chantenay et des usages quotidiens qui lui sont liés contre un projet d’aménagement rejoint la scène de contestation de la métropolisation nantaise. Il décrit également la manière dont une lutte produit du territoire par une valorisation de la proximité et de pratiques ordinaires comme le jardinage ; en (ré)activant des « attachements […] projetés sur les qualités d’un territoire à protéger pris en charge par une communauté de voisinage » ; et en inscrivant les revendications du présent dans l’histoire longue d’un territoire familier, support d’« une identification collective qui donne du sens à la coprésence des riverains et politise leur expérience du quotidien ». Les liens de proximité et les communautés préexistantes jouent en effet un rôle essentiel dans le déclenchement de mouvements sociaux (McAdam, 1982 ; Lichterman, 1996).
Lucile Garnier’s paper illustrates the role in the territorialisation of a struggle played by the politicisation of a movement that began with the occupation of a circumscribed area and subsequently grew in scale. It shows how the defence of the Bas-Chantenay gardens and their everyday uses against a development project became part of an arena of opposition to the metropolisation of Nantes. It also describes how a struggle produces territory by making the most of proximity and ordinary practices such as gardening by (re)activating “attachments […] projected onto the qualities of a protection area tended by a neighbourhood community”; and how, by embedding the demands of the present in the long history of a familiar territory, the support of “a collective identification that gives meaning to the co-presence of local residents and politicises their day-to-day experience”. Bonds of proximity and pre-existing communities play an essential role in triggering social movements (McAdam, 1982; Lichterman, 1996).
La territorialisation des luttes se joue donc en partie dans des mécanismes d’identification collective, qui renvoient aux affects liés au territoire et à sa charge symbolique (Piveteau, 1995). Dans son article, Alexis Gumy constate la manière dont la confrontation entre des demandes de justice mobilitaire, d’une part, et de préservation de l’environnement, d’autre part, s’établit sur des registres identitaires divergents et des représentations concurrentes du territoire et de son développement. Ainsi, dans le Chablais s’opposent une association pro-mobilité, favorable à une connexion routière et composée notamment d’entrepreneur·se·s locaux·les, et une association réunissant des habitant·e·s d’horizons divers (chasseur·euse·s, randonneur·euse·s), défendant l’enclavement du Chablais comme une ressource. Ces deux groupes structurent leurs mobilisations à partir de ressources informelles, de différentes formes d’expertises d’usage et du capital d’autochtonie (voir Retière, 2003 ; Berthomière et Imbert, 2020) de leurs membres, dans le but que les pouvoirs publics légitiment « une vision territoriale conforme à leurs modes de vie ».
The territorialisation of struggle is thus partly a matter of mechanisms of collective identification, which connect with affective links to the territory and its symbolic power (Piveteau, 1995). In his article, Alexis Gumy notes how the confrontation between demands for mobility justice, on the one hand, and environmental protection, on the other, is based on diverging understandings of identity and competing representations of the territory and its development. In the Chablais region, a pro-mobility organisation–mainly made up of local entrepreneurs–supports a road link, whereas an association of residents from a variety of backgrounds (hunters, walkers) favours the “enclavement” of the Chablais as a resource. These two groups build their mobilisations from informal resources, different forms of practical expertise and their members’ “autochtony capital” (see Retière, 2003; Berthomière and Imbert, 2020), with the aim of persuading the public authorities to legitimise “a territorial vision that is consonant with their lifestyles”.
Philippe Lavigne Delville et Momar Diongue montrent, dans le cas de projets immobiliers dans des espaces ruraux de la périphérie de Dakar, au Sénégal, l’opacité juridique qui irrigue les pratiques de prédation foncière de la part des institutions publiques. Les luttes étudiées portent sur les enjeux d’appropriation de terrains occupés de longue date, pour des pratiques agricoles et sacrées (cimetière). L’article explore une lutte territoriale où entrent en concurrence différents types de droit (juridique, coutumier…), fruit du détournement du cadre légal par les institutions publiques. Il revient aussi sur la nécessité dans laquelle se trouvent les collectifs de recourir à des réseaux non officiels pour accéder à quelques informations et documents. La publicisation du conflit par les collectifs de villageois devient ainsi le moyen de s’opposer à ces dépossessions. Le travail des auteurs permet de souligner les enjeux distributifs et procéduraux des luttes contre les dépossessions foncières, l’usage du droit comme modalité d’action de l’injustice, et le continuum d’informalité dans les pratiques qui participent de l’identification de l’injustice et qui contribuent aux luttes.
Philippe Lavigne Delville and Momar Diongue use the case of real estate projects in rural areas on the outskirts of Dakar, Senegal, to demonstrate the legal opacity that underlies the practices of land predation by public institutions. The struggles studied here concern the appropriation of land long-occupied for farming and sacred practices (cemeteries). The article explores a territorial struggle in which different types of law (legal, customary, etc.) come into competition, the outcome of the misuse of the legal framework by public institutions. It also looks at the need for collectives to employ unofficial networks in order to access information and documents. The publicising of the conflict by village collectives thus becomes a means of opposing land grabs. The authors’ work highlights the distributive and procedural issues at stake in struggles against land dispossession, the use of the law as a means of dealing with injustice, and the continuum of informality in the practices involved in identifying injustice and contributing to struggle.
Enfin, l’entretien mené par Céline Allaverdian avec Tania Li, qui figure dans la rubrique Espace public, propose un riche échange qui revient sur les situations d’injustices qui ne font pas l’objet de contestation et articulent des contextes locaux et des enjeux globaux. L’absence d’action et le non-recours dans le cas indonésien dont il est question sont présentés comme une situation ordinaire dans un contexte d’injustice et d’accaparement (voire de prédation) de terres dans les espaces ruraux qui, du fait des conditions spatiales et politiques, ne peuvent se construire en territoires. Tania Li met ainsi en évidence l’importance des conditions locales (complexes et rares) pour rendre possible (ou non) une lutte et l’émergence d’un territoire. L’absence de mobilisation n’empêche cependant pas le sentiment d’injustice. Elle montre également comment des pratiques informelles sont aussi une forme de recours, afin de garder l’usage de certains lieux ou pratiques dans un contexte de survie.
Finally, Céline Allaverdian’s interview with Tania Li, which appears in the Public Space section, airs a rich discussion of situations of injustice that are not opposed and that link local conditions with global issues. The lack of action and of recourse to law in the Indonesian case in question are presented as an ordinary situation in a context of injustice and land grabbing (or even predation) in rural areas which, because of the spatial and political conditions, cannot be constructed as territories. Tania Li highlights the importance of local conditions (complex and rare) in making it possible (or impossible) for a territory to mobilise and emerge. The absence of mobilisation does not, however, prevent a feeling of injustice. It also shows how informal practices are equally a form of recourse, a way of maintaining the use of certain places or practices under conditions of survival.
Les contributions réunies dans ce numéro viennent donc éclairer les enjeux territoriaux des luttes pour davantage de justice. Les articles y décrivent et analysent des luttes qui articulent des caractéristiques spatiales, politiques, temporelles, culturelles, sensibles et symboliques, construisant le territoire à la fois comme support et comme enjeu multidimensionnel. Ces propositions expriment ainsi le potentiel heuristique de la notion de territoire pour saisir une action collective à la croisée de dynamiques informelles et institutionnelles.
The contributions gathered in this issue shed light on the territorial issues at stake in the struggle for greater justice. The articles describe and analyse mobilisations that encompass spatial, political, temporal, cultural, sensory and symbolic characteristics, constructing the territory both as a frame and as a stake. These proposals thus express the heuristic potential of the notion of territory as a way to capture collective action at the intersection of informal and institutional dynamics.
Pour citer cet article
To quote this article
Dietrich Judicaëlle, Roche Elise, Zanetti Thomas, 2025, « Luttes, territoires et justice spatiale » [“Struggles, territories and spatial justice”], Justice spatiale | Spatial Justice, 19 (http://www.jssj.org/article/luttes-territoires-et-justice-spatiale/).
Dietrich Judicaëlle, Roche Elise, Zanetti Thomas, 2025, « Luttes, territoires et justice spatiale » [“Struggles, territories and spatial justice”], Justice spatiale | Spatial Justice, 19 (http://www.jssj.org/article/luttes-territoires-et-justice-spatiale/).