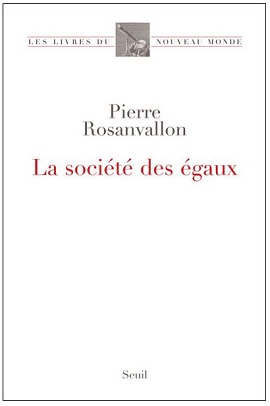
Pierre Rosanvalon
La Société des Egaux
Seuil, 2011, 432 pages | commenté par : Bernard BRET
La phrase par laquelle s’ouvre La Société des égaux est un constat sans appel : La démocratie affirme sa vitalité comme régime au moment où elle dépérit comme forme de société.
De fait, si un large consensus existe aujourd’hui pour considérer la souveraineté populaire comme seule source de légitimité du pouvoir politique, les chiffres montrent que les inégalités de revenus et de patrimoines se creusent partout dans le monde dans des proportions qui bousculent la société. Choquant en lui-même, ce paradoxe est gros de danger pour le fonctionnement de la démocratie politique : face à cette situation, Pierre Rosanvallon veut aider à refonder cette idée d’égalité. Il le fait dans une démarche qui articule de façon très convaincante perspective historique et réflexion théorique. Il donne, ce faisant, une contribution majeure au débat citoyen sur l’art de vivre ensemble, sur la nécessité de mieux comprendre le fait social pour mieux agir dans la cité.
Enseignement historique de l’ouvrage, l’aggravation actuelle des inégalités constitue un renversement récent de tendance. L’analyse sur la longue période montre d’abord la rupture de la Révolution de 1789. Celle-ci institue un nouvel ordre social en même temps qu’un nouvel ordre politique dès lors qu’est proclamée l’égalité des hommes en tant que membres du souverain. Est ici apportée une nuance subtile à l’affirmation parfois avancée que les idées révolutionnaires, celles que l’on appellera ensuite les valeurs républicaines, seraient les héritières des valeurs évangéliques en quelque sorte laïcisées. En fait, plutôt qu’héritage, il y a transformation. Etant égaux devant Dieu dans la tradition chrétienne, le maître et l’esclave partagent une égalité d’humanité, d’où découle un devoir moral de charité. Parce qu’elle abolit les privilèges, l’égalité juridique fonde, quant à elle, l’égalité de société qui fait de chaque citoyen l’égal de l’autre. Cette égalité-similarité permet à chacun d’exister comme sujet responsable de lui-même, c’est-à-dire libéré des dépendances personnelles. Ce bouleversement explique qu’à l’époque, le marché soit l’expression de la liberté (on est affranchi des corporations) et le vecteur d’une égalité (une égalité de concurrence) : le lien est alors établi entre la liberté et l’indépendance économique. Quant à l’égalité des partenaires sociaux, si elle se concrétise par le suffrage universel dans l’ordre politique, elle se lit également dans la fête révolutionnaire qui donne à chacun le bonheur de manifester avec ses semblables et dans le même espace public son adhésion aux idées nouvelles.
Les fondements de l’égalité étaient ainsi posés, à travers la similarité du statut et donc des droits, l’indépendance de chaque individu et l’exercice de la citoyenneté par tous. Les hommes étant identifiés d’abord comme des citoyens (l’emploi même du mot citoyen dans les usages de politesse de l’époque le montre bien), les différences entre les individus se trouvaient alors reléguées à un plan secondaire pour ce qui est du lien social, et ce d’autant plus que l’économie de marché devait assurer la circulation des richesses et donc la mobilité des conditions, empêchant de la sorte que se reconstitue une aristocratie de la fortune.
La Révolution constitue donc bien en France une rupture essentielle. A une société d’ordres marquée aussi par l’extrême inégalité des conditions matérielles d’existence, succède une société d’égaux en droits théoriquement préservée des écarts de fortune excessifs par les nouvelles règles du jeu économique. Ce tableau quelque peu idyllique constitue ce que l’on pourrait appeler l’utopie libérale, si forte dans l’inspiration des fondateurs des Etats-Unis qu’elle continue encore aujourd’hui à alimenter le rêve américain.
C’est le capitalisme industriel qui, au XIXème siècle, va bouleverser la donne et faire s’inverser la tendance. A partir des années 1830, les inégalités explosent en France : d’un côté les capitaines d’industrie et d’un autre les ouvriers trop souvent réduits à la misère. La réalité d’une société coupée en deux enlève de sa crédibilité au projet d’un monde de semblables forgé quelques décennies plus tôt. Les termes qui décrivent cette situation disent le recul enregistré. On parle de nouvelle féodalité, l’asymétrie du lien social entre le patron et l’ouvrier recréant une dépendance personnelle qui conduit même à comparer la condition prolétarienne à un nouvel esclavage. Que dire alors face à la montée du paupérisme ? Certains qui refusent d’y voir une rupture d’avec l’idéal égalitaire antérieur, font des pauvres les responsables de leur propre malheur. Dans cette optique, que Pierre Rosanvallon nommeidéologie libérale-conservatrice, la misère est le produit du vice, voire un fait de nature et non de société quand le darwinisme social naturalise l’inégalité. D’autres qui refusent l’ordre existant donnent dans les différentes variantes des utopies communistes, non sans malmener dangereusement l’idéal démocratique.
Pour les convergences qu’il présente avec certaines tendances actuelles, il est intéressant de noter comment, à la fin du XIXème siècle, le protectionnisme (le tarif Méline de 1892 en est l’expression la plus évidente en France) est considéré comme un remède possible à l’agitation sociale. Loin d’être seulement une politique économique, le protectionnisme fonctionne alors comme une philosophie sociale unissant tous les défenseurs du travail national (on parle d’ouvriers français et non plus deprolétaires) autour d’un projet présenté comme rassembleur et égalisateur où Maurice Barrès verra une alternative à l’idée socialiste.
C’est à la même époque, c’est-à-dire à partir des années 1890, que le racisme va s’affirmer comme la réaction la plus radicale, la plus dangereuse, la plus contradictoire avec l’idéal égalitaire. Pierre Rosanvallon avance que le groupe social dominant cherche à faire de la ségrégation raciale le ressort de l’identité collective. Il note qu’aux Etats-Unis, car c’est là que le problème a pris le tour le plus grave, la ségrégation raciale a été mise en place une vingtaine d’années après l’Abolition. Comment comprendre ce décalage historique ? Pierre Rosanvallon propose une explication inspirée des observations faites plus tôt par Alexis de Tocqueville. C’est parce que la loi n’est plus là pour le désigner comme supérieur que le groupe dominant utilise alors l’espace pour se distinguer de l’inférieur : la distance géographique doit alors mettre en évidence la distance sociale entre les groupes. Si des inégalités existent, bien entendu, dans chacun des groupes raciaux, ces inégalités sociales sont peu de chose en comparaison de l’inégalité fondamentale que les racistes mettent entre les Blancs et les Noirs. On refuse l’idée d’égalité entre les individus, et on est d’autant plus attaché (voir le comportement petit-blanc) à cette égalité de groupe, de type aristocratique, liée à la couleur de la peau.
Un nouveau renversement de tendance se produit au début du XXème siècle avec, dans de nombreux pays, le recul des inégalités. L’instauration de l’impôt sur le revenu, le début des assurances sociales et les progrès de la législation du travail en sont les instruments. Qu’il s’agisse du réformisme de la peur mis en œuvre pour désamorcer la tentation révolutionnaire (les mesures sociales voulues par Bismarck dès les années 1880) ou du réformisme inscrit dans un projet socialiste (Berstein, Jaurès, Kautsky), cela confère à l’Etat une fonction redistributrice et conduit à un certain rapprochement des conditions de vie. L’impôt progressif, écrit Pierre Rosanvallon, a été conçu comme un instrument nécessaire de socialisation, corrigeant le biais de privatisation et d’individualisation des mécanismes de marché. C’est aussi la fraternité des tranchées, quand la Grande Guerre exposait tous les soldats au même danger de mort, qui a redonné un sens directement actif et sensible à l’idée d’une société de semblables.
Mais, l’Etat-providence, dont en France la Sécurité Sociale reste l’institution phare, se trouve en crise à la fin du XXème siècle. Alors que, durant un siècle, la tendance lourde avait été à la réduction des inégalités, voilà que celles-ci augmentent désormais dans de terribles proportions. C’est, pour reprendre l’expression de l’auteur, le grand retournement. Et, comme à la fin du siècle précédent, voilà que renaissent les crispations nationalistes, voire xénophobes, qui désignent l’étranger comme responsable des malheurs du temps. La toute puissance du marché, la fin du fordisme, l’apparition du capitalisme financier se conjuguent pour mettre en marche un mouvement de désolidarisation, et cela dans un contexte de crise qui met en péril l’équilibre des comptes des institutions redistributrices : c’est le cœur même de la fabrique des sociétés démocratiques qui est menacé dans des termes inédits, avec la montée en puissance de nouvelles représentations du juste et de l’injuste. Certains milieux, en France, ne dissimulent pas leur objectif de détricoter petit à petit l’héritage du projet social issu du Conseil National de la Résistance. L’individu est alors valorisé sous une forme contradictoire avec l’idée d’universalité. Pierre Rosanvallon parle d‘individualisme de singularité qui prétend donner une légitimité à une compétition sociale devenue sévère, où les héritages matériels et sociaux privent de sa substance l’idée d’égalité des chances, surtout quand l’école républicaine faillit à sa mission de compenser les inégalités culturelles des contextes familiaux.
Que faire, aujourd’hui et dans ces conditions, pour penser et construire l’égalité ? Parce qu’il ne prétend pas fournir une recette, mais participer à une réflexion partagée (il donne à la dernière partie de son ouvrage le sous-titre modeste d’esquisse), Pierre Rosanvallon ouvre de multiples pistes à partir du constat qu’il fait de l’insuffisance de la justice distributive, toute impérieuse qu’elle demeure. Il reste absolument indispensable de débattre des écarts admissibles dans la répartition des revenus et des patrimoines, du niveau minimal de ressources à attribuer à chacun, de l’égalité des chances et des dispositions à prendre pour en garantir l’effectivité. Tout cela est d’une importance cruciale à une époque où les fortunes les plus ostentatoires et les revenus les plus extravagants côtoient le chômage et la pauvreté. Mais, parce que l’égalité est … une notion politique autant qu’économique, il est non moins nécessaire de réfléchir aux autres composantes du lien social. Trois idées force sont ici avancées : la singularité, la réciprocité, la communalité. Par singularité, il faut entendre une forme d’égalité qui reconnaît les particularités et refuse les discriminations contre quiconque. Avec la réciprocité, il faut constater que, contrairement à une lecture étroite du choix rationnel, l’homme est à la fois égoïste et altruiste : s’il est rationnel de viser son intérêt personnel, on voit mal en quoi il serait irrationnel de penser aussi aux autres et d’agir pour eux. La réciprocité est égalité d’interaction entre les personnes et égalité de celles-ci devant l’Etat. La communalité, elle, constitue la forme sociale de la citoyenneté, c’est-à-dire celle qui fait des citoyens des concitoyens, attentifs non seulement à l’exercice de leurs droits individuels, mais aussi à faire société ensemble. Portent atteinte à cet objectif les gated communities où certains groupes cultivent un entre-soi et s’isolent du reste de la population. La fragmentation spatiale traduit alors et aggrave la déchirure du tissu social. Ce séparatisme à base territoriale nous rappelle l’importance du territoire pour ou contre la cohésion sociale. Encore faut-il définir l’échelle à laquelle la concitoyenneté peut le mieux fonctionner. Il convient alors d’interroger le maillage politico-administratif et en particulier les intercommunalités en France : que celles-ci soient des périmètres efficaces pour la gestion des agglomérations urbaines ne veut pas dire que, dans le système actuel de répartition des pouvoirs, elles seraient favorables à l’expression de la souveraineté populaire. Ces interrogations disent bien comment la réflexion théorique sur ce que peut être l’égalité ne saurait être dissociée du débat citoyen concernant les moyens de construire aujourd’hui, dans la cité et dans le monde, la société des égaux.

