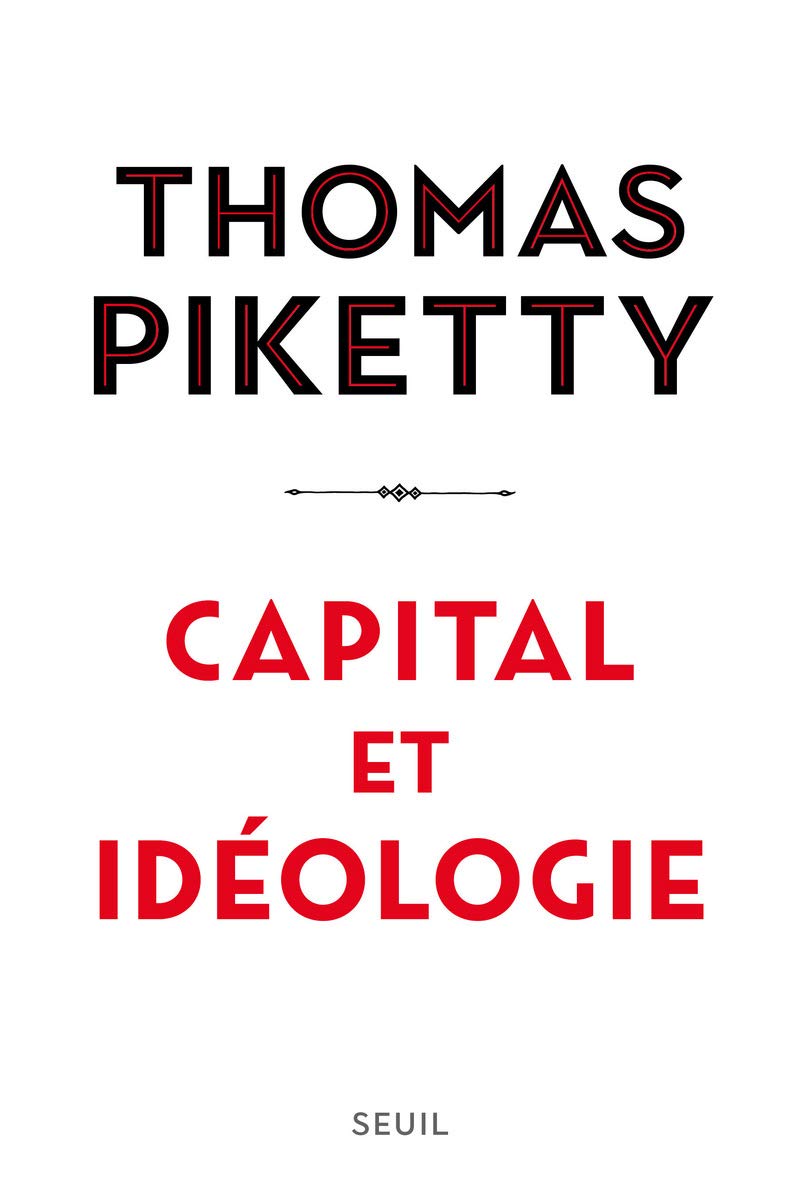
Thomas Piketty
Capital et idéologie
Paris, Le Seuil, 2019, 1197 p. | commenté par : Bernard Bret
Peu d’années après Le Capital au XXIe siècle, voici que Thomas Piketty nous donne à lire un magnifique ouvrage : Capital et Idéologie, qui prend pour objet « l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires » (p. 15) en partant du constat que « chaque société humaine doit justifier ses inégalités » (p. 13) et que, pour ce faire, elle avance son idéologie, c’est-à-dire un complexe d’idées et de représentations susceptibles de reconnaître au fonctionnement social une légitimité sur le plan des valeurs. Le tableau impressionne par son ampleur historique – partir des sociétés ternaires de jadis pour arriver à aujourd’hui et mettre en évidence les évolutions possibles de demain constitue une prouesse – et géographique – étudier le cas de la France, puis étendre l’analyse à l’Europe et confronter cela aux États-Unis, aux territoires coloniaux, à l’Inde, à la Chine, au Japon, à la Russie, entre autres, en constitue une autre. Il serait difficile de rendre compte d’un si vaste panorama si n’était maintenu très ferme l’objectif, rappelé en ces termes au début du dernier chapitre : « J’ai essayé dans cet ouvrage de présenter une histoire raisonnée des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés hypercapitalistes et postcoloniales modernes ». Le résultat est très convaincant. Non seulement ce livre nous apprend beaucoup, y compris sur des thèmes a priori arides, tels les systèmes fiscaux, mais surtout, s’adressant aux citoyens, il nous donne à penser sur notre société et nous éclaire sur les actions possibles.
L’analyse traite d’abord les sociétés d’ordres européennes, construites selon la logique ternaire considérée ici comme la matrice de l’inégalité sociale : l’ordre trifonctionnel associe dans un ensemble intégré ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Les trois ordres de l’Ancien Régime, le clergé, la noblesse et le Tiers-État entretiennent ainsi « des relations d’échange et de domination » (p. 96) qui valident l’inégalité. Ce « mélange complexe de contrainte et de consentement » (p. 83) a été contesté au XVIIIe siècle, mais la Révolution a fait naître une société où, malgré l’égalité civile, l’inégalité des fortunes et des conditions de vie était extrême, et donc aussi la distance sociale entre les personnes. À une société d’ordres a succédé une société de propriétaires. L’auteur parle de « propriétarisme » pour désigner son idéologie dans le sens que la propriété privée s’y trouve comme sacralisée. Intouchable et supérieure à tout. Consolidée par le système fiscal en vigueur et notamment par la faiblesse des droits de mutation, la propriété a produit cette figure balzacienne du rentier si caractéristique du XIXe siècle. Dans les sociétés coloniales, se sont cumulées les inégalités de type statutaire héritées du passé et les inégalités de type propriétariste nées de la domination extérieure. Décrit d’une façon précise, le cas de l’Inde est particulièrement éclairant, où la colonisation britannique a imposé l’assignation identitaire de chacun et, ce faisant, a aggravé les tensions entre les groupes. Parce que toucher au droit de propriété était inenvisageable, l’abolition de l’esclavage a partout comporté une indemnisation versée aux anciens propriétaires… alors que les esclaves libérés ne recevaient rien en tant que victimes d’un système dont était enfin reconnue la fondamentale injustice. C’est avec l’impôt sur le revenu en 1914 et surtout avec la Grande Guerre que l’idéologie propriétariste est ébranlée. Thomas Piketty décrit au XXe siècle la mise en place de l’État fiscal social. Les nationalisations de 1945 et la création de la sécurité sociale constituent en France un moment clé de cette période où, comme aux États-Unis (1920-1950) et dans plusieurs pays européens (1920-1980), les inégalités de revenus reculent : les sociétés de propriétaires se transforment en sociétés sociales-démocrates, que les partis au pouvoir affichent explicitement ou non cette appartenance politique. Puis, après la période 1950-1980 identifiée dans ces pays comme l’âge d’or de la social-démocratie, les inégalités ont de nouveau augmenté, avec une hausse particulièrement nette des plus hauts revenus : échec de la social-démocratie face aux défis posés à elle par la mondialisation et incapacité à maintenir l’État fiscal et social. De plus, le communisme stalinien a constitué un repoussoir tel que l’idée de l’intervention de la puissance publique dans la sphère économique a perdu de sa crédibilité, légitimant du même coup le néo-libéralisme comme si, ainsi que le prétendait Margaret Thatcher, il n’y avait pas d’alternative entre le dirigisme d’État et la liberté totale laissée au capitalisme mondialisé. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé quand les régimes communistes se sont brutalement effondrés : la thérapie de choc imposée à leur système, c’est-à-dire en fait un hold-up pratiqué par une oligarchie de type kleptocratique, a mis en place un capitalisme sans règle.
Les transformations économiques, sociales et culturelles ont, bien entendu, eu de lourdes répercussions dans l’ordre politique. Thomas Piketty analyse ainsi l’usure de la social-démocratie quand celle-ci a perdu sa base sociale traditionnelle et quand « le parti des ouvriers est devenu le parti des diplômés ». A joué, en effet, un rôle important dans cette affaire la massification de l’enseignement supérieur, évolution en soi positive n’était la dérive qu’elle a alimentée quand les partis sociaux-démocrates ont été investis par une clientèle de classe moyenne et n’ont plus été perçus comme leur expression politique par une classe ouvrière elle-même en perte d’identité. Constituent donc ce que Thomas Piketty nomme la Gauche brahmane les personnes éduquées qui adhèrent intellectuellement aux valeurs progressistes sans avoir un véritable enracinement dans la culture ouvrière. De fait, aujourd’hui, le niveau de diplôme détermine le vote au moins autant que le revenu. La recomposition politique qui résulte de cela distingue quatre catégories d’électeurs. La gauche électorale comprend une version radicale favorable à la redistribution des richesses et la gauche brahmane plus ouverte à l’économie de marché. La droite électorale, quant à elle, est également composite, avec un centre-droit favorable au marché et une droite nationaliste et même, selon le terme de Thomas Piketty, « nativiste », attachée à son territoire et, contre l’universalisme, à ses valeurs traditionnelles plus ou moins mythifiées Signe que la division droite/gauche a perdu de sa pertinence, ou plutôt qu’elle doit être lue dans le contexte de la mondialisation, ces positionnements mettent en évidence des combinaisons idéologiques nouvelles. Certains internationalistes plaident pour l’égalité alors que d’autres tiennent l’inégalité pour un ressort utile à la dynamique sociale : les premiers, attentifs au sort des immigrés et des pauvres, pensent l’égalité à l’échelle mondiale, les seconds voient davantage l’international comme le cadre désormais naturel de l’économie mondialisée et de la compétition entre les acteurs sociaux. En face d’eux, les « nativistes ». Réunis dans une commune méfiance, voire de haine, à l’endroit des immigrés, certains d’entre eux défendent les hauts revenus alors que d’autres affichent des prises de position favorables aux démunis… à condition toutefois qu’ils ne soient pas des étrangers ! À ces électeurs, il faudrait ajouter les écologistes, ou plutôt noter que les préoccupations environnementales pénètrent tous les courants politiques, sans que tous les partis fassent leurs les conséquences à long terme d’un tel engagement.
Alors que le sentiment d’appartenance à une classe sociale oriente de moins en moins le choix électoral, l’évolution est inverse dans les pays émergents, comme le montrent l’Inde et le Brésil où le vote classiste s’affirme de plus en plus.
Ce début du XXIe siècle se caractérise par l’aggravation des inégalités de revenus, la concentration croissante de la propriété et l’opacité financière d’un système mondialisé, autant de phénomènes qui menacent la démocratie quand ils ne l’affectent pas déjà. Mais, nous dit Thomas Piketty, cette situation n’est pas une fatalité pour peu que les citoyens s’emparent du problème à l’échelle où il est posé. Se résigner à l’impuissance des Etats est une sorte de démission qui ne correspond pas à la marge d’action importante qui reste la leur. Si l’objectif de long terme est le social-fédéralisme à l’échelle mondiale, rien n’empêche de procéder par étapes à des échelles intermédiaires. Pour les Européens, l’Union européenne constitue l’échelle la plus adéquate à laquelle exercer la citoyenneté pour faire naître un socialisme participatif. Sans exclusive d’autres terrains d’action, les pistes en sont d’une part une fiscalité progressive portant sur le revenu, la propriété et l’héritage, capable d’empêcher l’enrichissement sans limite de certains et de financer les dotations aux personnes, et d’autre part une politique audacieuse d’éducation. Tels sont sans doute les leviers principaux par lesquels seraient assurées l’égalité des chances et la participation de tous dans les délibérations et les prises de décision.

