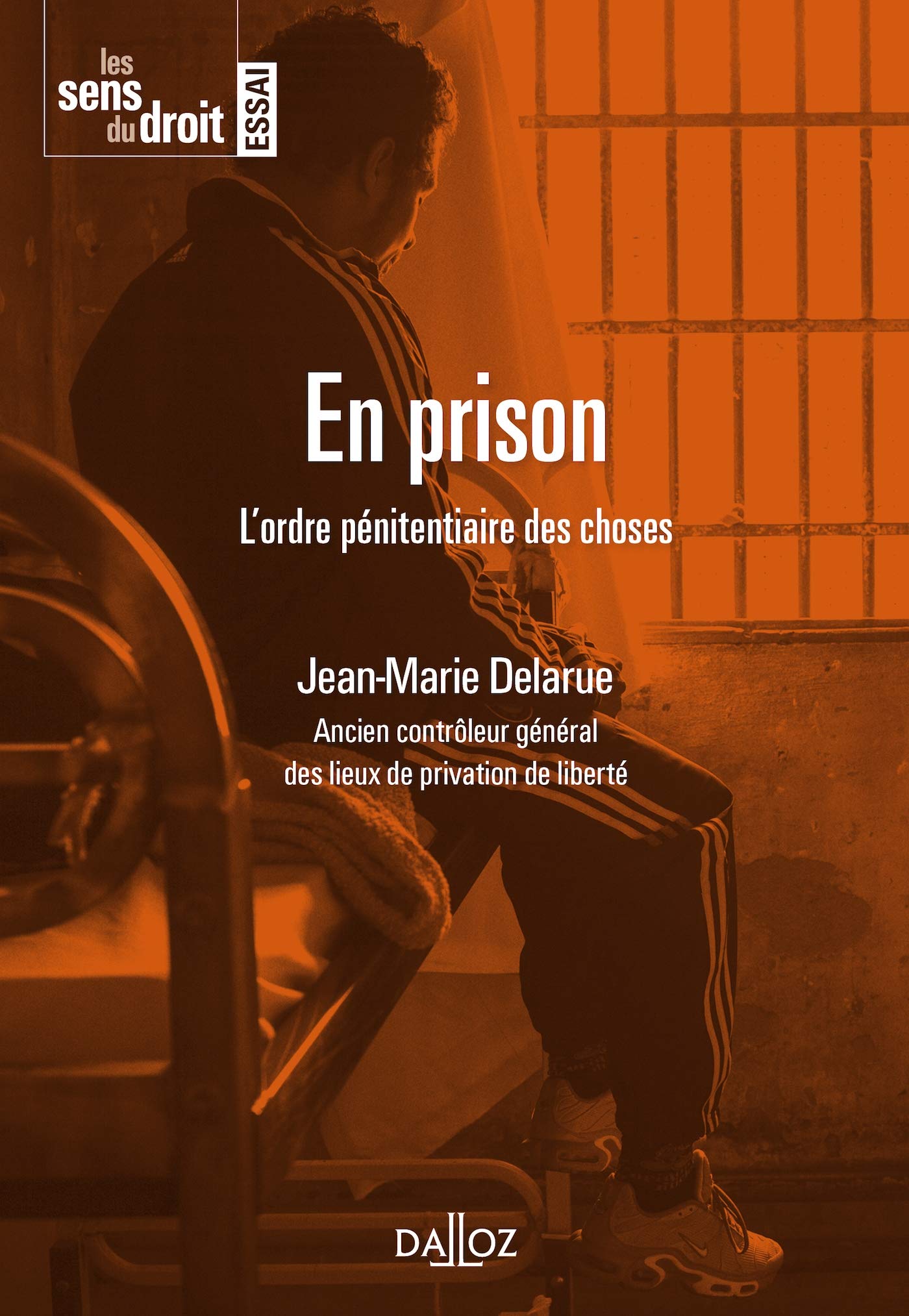
Jean-Marie Delarue
En prison. L’ordre pénitentiaire des choses
Paris, Dalloz, 2018, 877 p. | commenté par : Bernard Bret
C’est un tableau précis et sans concession de la question pénitentiaire que nous propose Jean-Marie Delarue. On sait que l’auteur fut le premier Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce qui le plaça au cours des six années qu’il exerça ses fonctions (2008-2014) à un poste d’observation sans égal. Bien que son contrôle se soit exercé sur d’autres établissements que les prisons, c’est à ces dernières qu’il consacre une véritable somme, avec deux buts, mentionnés dès l’introduction : d’une part « tracer un portrait aussi exact que possible des conditions d’existence quotidiennes des personnes détenues » (p. 29) et, d’autre part, « examiner les écarts entre la norme et la pratique » (p. 33) dans le déroulé des peines.
Viser ces objectifs requiert une connaissance approfondie de la norme et de ce qui se passe dans les lieux de détention. L’auteur tire de son expérience une légitimité peu contestable pour satisfaire à cette double exigence. Son propos interroge la réalité du système pénitentiaire au regard des textes qui en fixent les objectifs et les modalités de fonctionnement. L’auteur pose donc d’abord sur le problème un regard de juriste : que dit la loi sur la sanction pénale et comment le droit français s’articule-t-il avec les conventions internationales en la matière. Il examine ensuite la façon dont le droit est appliqué par l’administration. Il décrit et analyse enfin longuement (plus de 500 pages sur les 877 que compte l’ouvrage) La Prison de la personne détenue. Ce dernier regard est particulièrement nourri. L’auteur a personnellement visité, et longuement, des dizaines de prisons, qu’il s’agisse de maisons d’arrêt ou d’établissements pour peine, il s’est entretenu avec des centaines de détenus et a lu des milliers de lettres reçues de ces derniers. Il restitue les conditions de vie d’une façon minutieuse parce que, il le montre très bien, beaucoup de faits qui seraient vus comme des détails sans importance pour qui voit la chose de l’extérieur prennent une dimension considérable pour le détenu. Ainsi en est-il de la nourriture et, en conséquence, la possibilité de cantiner pour améliorer l’ordinaire et, à travers le fait de cuisiner soi-même, trouver un certain plaisir, et même peut-être retrouver une certaine confiance en soi. Voilà qui n’est pas anodin. De même en est-il, a fortiori, des incidents qui perturbent l’emploi du temps et déçoivent les attentes (une panne de téléviseur, un retard compromettant la promenade, c’est-à-dire quelques pas dans une cour) ou, plus graves, le report d’une consultation médicale, la suppression d’un parloir, c’est-à-dire la visite d’un proche, ou l’impossibilité de participer à une formation ou à un travail. Sont ainsi traités le choc carcéral subi lors de l’entrée en détention, la vie dans la cellule et les rapports souvent difficiles noués avec les codétenus, la pratique des activités permettant de sortir de la cellule, les relations possibles avec le dehors. La description détaillée qui en est faite confirme et prolonge ce que disent les rapports annuels établis par le Contrôle général, suite aux visites des établissements. Croiser ces multiples faits pour en comprendre l’intrication et en saisir la logique globale répond à la recommandation de Malinowski, citée par Jean-Marie Delarue : « L’un des impératifs du travail scientifique bien conçu est certainement de s’occuper à la fois de tous les aspects sociaux, culturels et psychologiques d’une communauté, car ceux-ci s’imbriquent de telle sorte que chacun ne peut être compris qu’à la lumière des autres. » Ainsi, Jean-Marie Delarue a-t-il voulu « tracer un portrait aussi exact que possible des conditions d’existence quotidiennes des personnes détenues (p. 29) et est-il fondé à dire avoir tenté une ethnographie de la prison » (p. 29).
Outre la distinction juridique de leur statut – sont-ils des prévenus ou des condamnés, et, si oui, à de courtes ou de longues peines ? – d’autres points différencient les détenus et justifient l’individualisation des peines selon, en particulier, l’aptitude à la réinsertion sociale. Toutefois et malgré de rares exceptions, la population pénale présente la caractéristique commune d’être pauvre. Les budgets individuels le montrent, tout comme la modicité des dépenses faites à la cantine. Or, là encore, il faut mesurer la chose du point de vue de la personne détenue. Des sommes que l’on jugerait dérisoires depuis l’extérieur prennent une tout autre signification à l’intérieur. Elles sont essentielles pour « tenir » et, du moins pour certains, préparer la sortie. Mais, quand le travail en prison, d’ailleurs très mal rémunéré, n’est proposé qu’à une minorité, d’où peut venir l’argent sinon des familles ? Quand on sait que, pour la plupart, ces dernières ont des revenus très modestes, que la détention de leur proche les prive souvent d’un salaire et enfin que les trajets pour les parloirs impliquent un lourd effort financier, on comprend qu’il est impossible à beaucoup d’entre elles de faire davantage. Une très petite allocation prévue pour les indigents confirme que la prison enferme des pauvres. On se représente aussi que l’inégalité devant l’argent fait naître un trafic interne et renforce entre les détenus des relations de pouvoir où les forts écrasent les faibles, par exemple pour dissimuler un objet interdit tel qu’un téléphone portable. La cohabitation s’en fait d’autant plus pénible, voire dangereuse pour les personnalités fragiles, surtout lorsque la surpopulation aggrave l’inévitable promiscuité. Et l’on comprend alors le repli sur soi comme moyen d’assurer sa sécurité quand la cour de promenade elle-même devient un lieu dangereux.
Le tableau dressé par cette étude interroge finalement la politique pénale. Si on retient que la prison est faite pour protéger la société, c’est-à-dire éviter la récidive et réinsérer le détenu à sa sortie, force est de constater que le bilan n’est guère positif. Si cette conclusion n’est pas d’une totale originalité, il faut reconnaître qu’elle est ici validée par une documentation de première main et d’une ampleur exceptionnelle. C’était là un des buts poursuivis. Cette plongée dans l’univers carcéral apporte des pièces au puzzle commencé par d’autres auteurs. Elle en montre la logique d’ensemble et les incohérences. Du coup, ayant aussi répondu à l’hypothèse initiale selon laquelle il existe un écart entre la norme et la pratique, Jean-Marie Delarue s’interroge sur l’adéquation du dispositif technique de la détention avec les objectifs fixés par la politique pénale. Dans cette affaire, l’espace joue un rôle majeur. Comment pourrait-il en être autrement quand la peine infligée consiste en l’enfermement. L’idée de la réinsertion du détenu est-elle compatible avec l’architecture des lieux de détention pensée pour la vie en cellule et avec la localisation des établissements loin des villes ? La mise à l’écart est-elle vraiment une solution ? Comparer notre système avec d’autres qui, en Europe, sont plus efficaces pour un coût finalement moindre serait d’une forte utilité.

