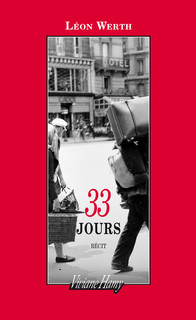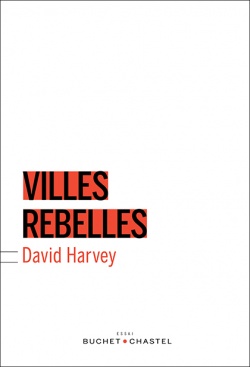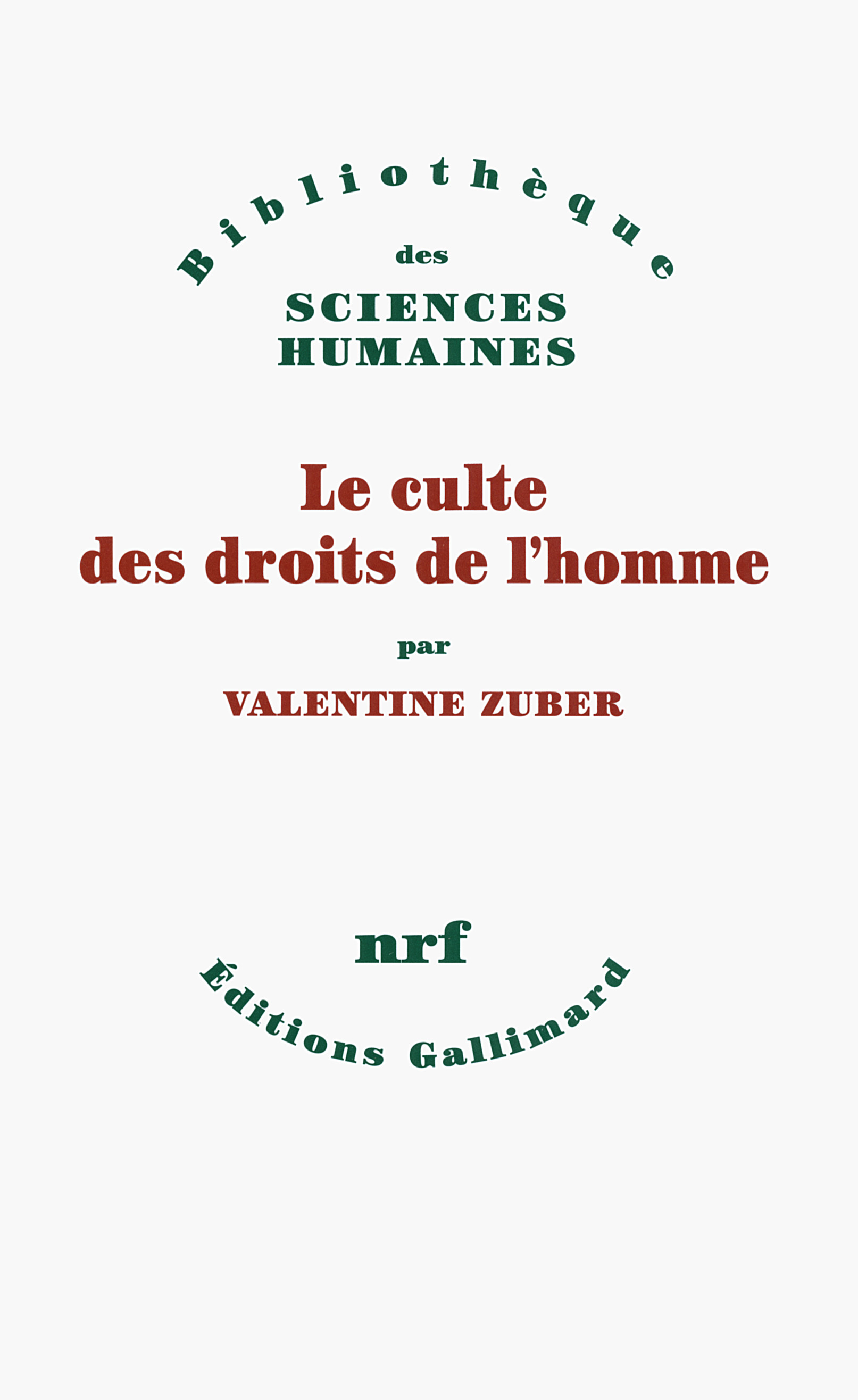Les écrits du géographe marxiste David Harvey n’ont longtemps été accessibles qu’au public anglophone. Echelonnés de la fin des années 1960 à aujourd’hui, ses travaux sont depuis les années 2000 traduits, massivement, notamment grâce à l’implication de maisons d’éditions comme Syllepse (Géographie et capital : vers un matérialisme historico-géographique, 2010), Amsterdam (Le capitalisme contre le droit à la ville : Néolibéralisme, urbanisation, résistances, 2011), La ville brûle (Pour lire Le Capital, 2012) et surtout les Prairies ordinaires (Géographie de la domination, 2008 ; Le nouvel impérialisme, 2010 ; Paris, capitale de la modernité, 2011 ; Brève histoire du néolibéralisme, 2014).
La concentration dans le temps de ces traductions-comme s’il y avait un retard à rattraper- interroge. D’autant plus que le mouvement n’est sans doute pas achevé : les ouvrages fondateurs ne sont toujours pas traduits (Social justice and the city, 1973 ; The limits to capital, 1982). En tout cas, la figure de David Harvey s’impose au moment où la géographie radicale française prend un certain essor, sur fond de crise universitaire.
Il faut dire que le personnage a du répondant : issu de la nouvelle géographie quantitative (Explanation in géography, 1969), il devient très rapidement marxiste, et, à la différence des géographes français communistes des années 1970 (un Pierre George ou un Jean Dresch, d’une génération plus avancée et marqués par une autre histoire), a fait du marxisme un élément fondamental de son analyse géographique. On pourrait alors plus le rapprocher du Yves Lacoste de la Géographie du sous-développement, mais, à la différence d’Yves Lacoste, David Harvey a conservé tout au long de sa carrière le fil rouge du marxisme et une réflexion fondée sur quelques concepts clefs : l’absorption urbaine du surproduit capitaliste, l’accumulation par dépossession, le droit à la ville.
Ayant ainsi participé, très seul, à la naissance et la survie d’une géographie marxiste, il se retrouve au temps des grandes crises nomades des années 1990-2000 (crise asiatique, crise argentine, crise nord-américaine, crise de la zone euro…), un des seuls géographes capables de parler en termes politiques et économiques, sans se contenter de la fausse neutralité du discours systémique sur la mondialisation, ses discours et ses effets, ses avantages et ses inconvénients, sa carpe et son lapin.
David Harvey, en bon marxiste est à l’aise dans l’identification et l’explication de la crise, et la crise le lui rend bien : toute une génération de géographes français se l’approprie aujourd’hui pour dire tout à la fois l’importance d’une pensée universitaire critique et la nécessaire critique de la pensée universitaire. En faisant le lien entre les pratiques d’exploitation propres à la sphère productive du capital et les formes de domination propres à la ville – et donc aux diverses facettes de la reproduction sociale – David Harvey propose en quelques sortes un chapeau théorique à toutes celles et ceux qui font de la question du genre, de la gentrification ou de la commodification des objets particuliers d’une vaste économie politique incarnée dans l’espace social.
Reste qu’un certain nombre de questions demeurent… et cette nouvelle livraison est le prétexte d’y revenir, tant, et c’est quelque chose d’assez récurrent, le lecteur peut avoir l’impression d’avoir « déjà lu ça quelque part »… Pénélope remet sans cesse sur le métier l’écheveau.
L’ouvrage est la traduction d’un recueil d’articles qui avaient été précédemment publiés dans la New left Review (chapitre 1), le Socialist register (chapitres 2, 4 et 5), la Radical history review (chapitre 3) entre 2008 et 2011 (sauf le chapitre 4 qui reprend un article de 2002). Ces articles légèrement remaniés sont ici encadrés par une préface consacrée à la vision qu’avait Henri Lefebvre du droit à la ville, et de deux très courts chapitres polémistes (6 et 7) sur les émeutes de 2011 à Londres et le mouvement Occupy Wall street. La cohérence globale s’en ressent. Les chapitres un à quatre forment une première partie volumineuse (Le droit à la ville, 208 pages sur 298) qui se lit comme un rappel actualisé des grandes théories de l’auteur développées dans ses ouvrages séminaux depuis 1973 sur l’accumulation du capital en ville et la fabrication d’un espace social caractéristique du capitalisme. La seconde partie, beaucoup plus modeste (77 pages) regroupe les trois derniers chapitres autour de la notion de « villes rebelles », c’est-à-dire d’un examen des conditions de possibilité de véritables « révolutions urbaines » anticapitalistes.
La préface pose la question de l’actualité de la pensée d’Henri Lefebvre à la fin de la première décennie du XXI° siècle. David Harvey rappelle la dette qu’il a vis-à-vis du sociologue de l’urbain, et la richesse d’une pensée qui s’est développée autour de mai 1968 à la rencontre d’un marxisme hétérodoxe et du mouvement situationniste. Tout est déjà là, en germe, pour les décennies à venir. La question du droit à la ville y est posée dans les termes d’un droit à participer à la construction d’un espace social configuré par et pour les besoins du capitalisme. C’est une manière pour David Harvey de rappeler que la question du droit à la ville est une question creuse, qui ne se remplie qu’au moment où l’on se demande de qui (le droit) et pour quoi (quelle ville) ? Déjà, une limite est fixée : il ne s’agit évidemment pas du droit des riches et des investisseurs capitalistes qui n’ont pas besoin de cette aide… Mais il ne s’agit plus non plus – dès les années 1960 – du droit des seuls travailleurs de l’industrie, les prolétaires exploités dans le procès de production. Il s’agit du droit des classes urbaines dominées, travailleurs précaires, habitants, femmes… parce qu’un marxisme orthodoxe trop étriqué a longtemps considéré comme subalternes et déterminées les questions de domination dans les sphères reproductives.
PREMIERE PARTIE. LE DROIT A LA VILLE
Le premier chapitre est consacré au droit à la ville. Il reprend le débat dans les termes de Robert Park : en créant la ville, l’homme s’est créé lui-même (p 28). Or, dans les conditions qui règnent aux XX° et XXI° siècle, le capitalisme a besoin de l’urbanisation pour absorber le surproduit qu’il produit en permanence (p. 30). Cette nécessaire absorption du surproduit par la ville joue alors un rôle fondamental dans le fonctionnement du capitalisme en général : elle en est le cadre et le produit. Le Paris d’Hausmann comme le New York de Moses cent ans plus tard (et à une échelle toute différente) sont des actualisations des modes de vies et des sujets urbains conformes aux besoins de l’absorption du surproduit capitaliste. Aujourd’hui, nouveau changement d’échelle, et c’est à l’échelon planétaire que se reconfigurent les marchés de l’immobiliers et les règles de l’urbanisme capitaliste, avec, pour caractéristique principale, l’étalement urbain, mais aussi la fragmentation urbaine, où « chaque fragment semble vivre et fonctionner de façon autonome, s’accrochant obstinément à se dont il a pu s’emparer dans sa lutte quotidienne pour la survie » (p 47). C’est dans ce contexte que des théoriciens comme Hernando de Soto peuvent se faire les chantres de la sécurisation foncière des pauvres, ce à quoi Harvey répond par une critique de l’appropriation privative du sol urbain, y compris par les pauvres, conçue comme un « marché de la dépossession » (p.56), auquel participe activement la politique des microcrédits initiée par Yunus, et destiné à ouvrir « ce gigantesque marché à la base de la pyramide » (p 57). Harvey ne veut donc pas que le droit à la ville se retrouve entre les mains « d’intérêts privés ou quasi privés » (p 60).
Le deuxième chapitre est une forme de rappel des enjeux en présence : les « racines urbaines des crises capitalistes » sont selon l’auteur aussi profondes que négligées. S’appuyant notamment sur les travaux de Goetzmann et Newman (p 76), l’auteur montre que les grandes crises de 1929, 1973, 1987 ont, comme celle de 2008, débuté par des périodes de spéculation immobilière incroyable, des périodes d’intense construction suivies de krachs retentissants : « l’optimisme en matière de marchés financiers a le pouvoir de faire se dresser l’acier, mais pas celui d’assurer la rentabilité d’une construction ». Or, ces éléments demeurent peu étudiés, « tant les urbanistes sont perçus comme des spécialistes, le noyau de la théorie macroéconomique marxiste se situant ailleurs » (p 79).
La faute à Marx lui-même, tant son exposé se veut général et détaché des circonstances particulières de la distribution (intérêts, rentes, impôts et même salaires réels et taux de profit). Harvey se positionne donc plutôt du côté de l’operaïsme de Mario Tronti ou de Tony Negri quand il cherche à réintégrer les pratiques de consommation à niveau égal avec les pratiques de production dans la formulation générale des lois du mouvement du capital (p. 84). D’où son intérêt pour le crédit, et sa lecture de la crise des subprimes qui atomisa en 2007 le marché immobilier états-unien. Lecture, qui, une fois de plus, le renvoie à Marx, via le concept de capital fictif : « pour Marx, le capital fictif n’est pas une invention née dans l’esprit embrumé par la cocaïne d’un quelconque trader de Wall Street. C’est une construction fétiche (…) Quand la banque prête à un client de quoi s’acheter une maison et touche un flux d’intérêt en contrepartie, on peut avoir l’impression qu’il se passe dans la maison quelque chose qui produit directement de la valeur, ce qui n’est pas le cas en réalité » (p 86). Et on le suit avec intérêt son raisonnement quand il note que capital fixe et capital fictif ne se distinguent pas par leurs aspects matériels mais par l’utilisation qui en est fait : « Le capital fixe décline quand des usines textiles cèdent la place à des immeubles résidentiels, alors que la microfinance transforme des huttes paysannes en capital fixe de production-bien meilleur marché ! » (p 88). C’est au final bien une forme de fétichisme « le capital-automate engendrant de la valeur par lui-même » qui a été pris – une nouvelle fois et à une échelle sans précédent – sérieusement en défaut, puisqu’il a pu laisser se créer une véritable « pyramide de Ponzi », bien décrite dans l’ouvrage de Michael Lewis The Big short (Le casse du siècle).
Ceci dit, Harvey rappelle dans le même mouvement que la spéculation immobilière sert aussi d’autres objectifs. Il cite à ce propos le journaliste Binyiamin Applebaum pour qui «les Américains se remettent des récessions en construisant davantage de logements qu’ils remplissent d’objets » (p 104). Et dans ces procédés politiques, les intérêts de classe jouent à plein : faute d’avoir su lire les petits caractères de leurs contrats de prêts immobiliers, les pauvres se retrouvent expulsés de leurs logements quand les financiers à l’origine de la crise mondiale se sont retrouvés à peu près tous exemptés de leurs responsabilités. C’est ainsi que les concessions salariales octroyées dans la sphère productive peuvent se voir balayées au profit de la classe capitaliste « par des pratiques de prédation et d’exploitation dans la sphère de la consommation » (p 115). Phénomène qui est sans doute en train de se reproduire, en Chine, cette fois, où le développement immobilier est sans commune mesure tant sur le plan des volumes investis et des constructions, que du caractère inégalitaire : « Ce déséquilibre du développement urbain le long de la ligne de faille des classes sociales représente en fait un phénomène mondial » (p 126). La Chine, où d’ailleurs, Harvey note la coexistence de plusieurs modèles de développement urbain, certains étant de manière explicite, destinés à juguler par l’investissement public les oppositions politiques engendrées par un développement urbain trop inégalitaire, comme si les deux alternatives – l’Etat ou le marché – perduraient, et comme si le socialisme d’état s’incarnait maintenant dans les choix urbanistiques de certaines agglomérations plurimillionnaires.
Le chapitre trois, La création du commun urbain répond au précédent comme étant une réflexion sur la fabrication continue des questions communes qui font la ville. C’est le développement capitaliste lui-même qui crée sans cesse ce commun, à commencer par la ville elle-même, bien commun par excellence. Toute la question est alors de comprendre qui va s’arroger les droits à la gestion de ce commun, au bénéfice de qui. Harvey reprend ici pour les discuter quelques grands noms des études sur les communs : Harding et Ostrom. Sa préférence va bien sûr à Ostrom, mais il élabore surtout sa propre théorie, en reprochant à Ostrom de toujours privilégier les exemples de bonne gestion commune à petite échelle, dans des cercles de quelques dizaines à quelques milliers d’ayant-droits. Pour Harvey, la question des communs urbains s’articule à diverses échelles, de la plus locale à la plus globale. Or, chaque échelle ayant son indépendance relative, il y a fatalement conflit entre ce qui fait commun pour un îlot, un quartier, une commune, une agglomération ou un système de villes : « chaque changement d’échelle transforme spectaculairement la nature du problème des communs et les perspectives pour trouver une solution » (p 137). Harvey a son idée sur le sujet, une idée assez bien arrêtée : la gauche se refuse à tort de considérer ces contradictions d’échelles et, par paresse intellectuelle, laisse trop systématiquement entendre qu’une parfaite horizontalité des prises de décision peut aboutir à une bonne gestion (c’est-à-dire participative et égalitaire) des communs. Or, de fait, et sans que cela soit lié à la question du fonctionnement du capital, ce qui est bon à une échelle peut être mauvais à une autre. Ce qui oblige à penser en termes de hiérarchie des prises de décision. Les enclosures servent ici d’exemple. Il faut rappeler que les enclosures sont un exemple classique chez les marxistes pour expliquer le décollage de l’économie capitaliste anglaise au 18° siècle. Les enclosures sont une forme de privatisation de la terre agricole aux dépends des domaines féodaux et des terres collectives des villageois. Elles ont permis le décollage des productions agricoles (la révolution agraire) et le déversement de la main d’œuvre prolétarisée des campagnes vers les villes. Ici, en jouant avec les échelles, Harvey se fait (ironiquement ?) le défenseur de (certaines) enclosures contemporaines : « une action d’enclosure en Amazonie sera ainsi indispensable pour protéger à la fois la biodiversité et les cultures des populations indigènes, qui font partie de nos communs naturels et culturels mondiaux » (p 139). On pourra sans doute sourire du caractère assez naïf de l’exemple (qu’est-ce que la biodiversité et qui définit le « commun mondial » ?), à un point important du raisonnement. Pourtant, on pourra suivre l’auteur quand il remet ainsi la question des échelles au premier plan, en rappelant que la destinée de tout bien commun est de réserver des droits d’accès. Droits particulièrement bien compris par les classes dominantes, qui savent mettre des enclosures à leur service pour définir ces communs… C’est le cas par exemple de toute gated community. D’où l’intérêt de l’étude des diverses formes d’appropriation des biens publics par certains groupes et certaines classes… ce que l’auteur définit comme des pratiques de communage : « cette pratique produit ou établit une relation sociale avec un commun dont l’utilisation est soit exclusivement réservée à tel groupe social, soit partiellement ou entièrement ouvert à tous » (p 144). Il prend ici l’exemple de la gentrification, somme de pratiques valorisant le caractère multiculturel des quartiers populaires, qui profite d’un commun (l’ambiance multiculturelle), et qui, par la montée des prix de l’immobilier, se l’approprie et le réserve à une classe sociale qui n’a plus rien de populaire. Une fois de plus, Harvey s’en prend alors à De Soto pour identifier le même phénomène dans toutes les tentatives de sécurisation foncière sous la forme de propriété individuelle, par exemple dans les bidonvilles indiens… formes de gestion capitaliste de la ville qui aboutissent à la disparition ou à l’accaparement des communs.
Finalement, on en revient toujours à Marx :« La valeur – le temps de travail socialement nécessaire- constitue le commun capitaliste et elle est représentée par l’argent- instrument universel de mesure de la richesse commune. Le commun n’est donc pas quelque chose qui a existé jadis et qui a été perdu depuis, mais quelque chose qui, comme le commun urbain, ne cesse d’être produit. Le problème est que le capital, lui aussi, ne cesse de lui imposer une enclosure et de se l’approprier sous sa forme de marchandise et sous sa forme d’argent, alors même qu’il est continuellement produit par le travail collectif » ( p 151). Quelles solutions s’offrent alors, pour, jour après jour, revendiquer ces communs urbains ? Harvey développe une critique sévère du « localisme » des idéologues de gauches et tente de repenser des formes de reconnaissance des hiérarchies scalaires inévitables évoquées en début de chapitre. Faute de quoi, « la puissance politique existante n’a pas plus de difficulté à récupérer l’idée des communs- comme celle du droit à la ville- que n’en ont les intérêts immobiliers à récupérer la valeur à extraire d’un commun urbain réel » (p 167).
Consacré à L’Art de la rente, le quatrième chapitre s’articule au précédent autour de la notion de captation des communs. Il s’agit ici de montrer comment cette captation des communs assure des profits à ceux qui l’organise. L’espace est ici présent au titre de son caractère éminemment irréductible car à chaque fois particulier : Paris n’est pas Londres qui ne sont ni Lille ni Liverpool. Les position spatiales sont autant de positions de rentes foncières, et ces rentes foncières ont une tendance éminemment monopolistique, à l’image de toute dynamique capitaliste, qui aboutit fatalement, par le jeu de la concurrence, à la création de monopoles auxquels seule la puissance publique peut s’opposer pour la bonne régulation des marchés. Les marchandises ont ainsi, en général, tout intérêt à créer de l’unicité, de la singularité pour définir une situation de monopole. C’est le cas par exemple des très grands crus du vignoble français (p 172). En ce qui est des places urbaines, la captation d’un commun par un groupe singulier vise à en tirer des revenus monopolistiques. C’est par exemple le cas de l’ambiance d’un quartier comme Soho à New York. Il existe donc une esthétique de la marchandise qui élargit sans cesse ses frontières dans le domaine du culturel (p 175). Mais cette transformation en marchandise comporte sa propre contradiction en faisant de son caractère monnayable et échangeable un produit standardisé qui n’a plus grand-chose à voir avec l’authenticité et la singularité : « Pour que ces rentes soient préservées ou réalisées, il faut que certaines marchandises ou lieux restent suffisamment uniques et particuliers (…) pour conserver un avantage monopolistique dans une économie de marchandisation et de concurrence souvent féroce ». C’est toute la contradiction du système : le capitalisme a tendance à créer sui generis des situations de monopoles locaux, mais l’élargissement de la sphère capitaliste dans l’espace géographique « l’annihilation de l’espace par le temps » (p 179) détruit ces rentes monopolistiques par l’élargissement de la concurrence. C’est ainsi que l’on passe d’une situation où de petites brasseries locales faisaient boire dans les pubs du Kent des bières monopolistiques, à une situation où, à Manhattan, des pubs servent des bières « locales » du monde entier ( p 179).
L’idée de « culture » est alors examinée plus en détail par Harvey pour mieux expliquer les stratégies urbaines. Selon lui (et il file ici longuement la métaphore avec les stratégies de distinction des entreprises viticoles), les villes cherchent à mettre en valeur une singularité, une unicité porteuse de rentes monopolistiques qui dans le même mouvement, doivent être jugulées pour ne pas s’opposer au mouvement général du capital : « Mettre l’accent sur la singularité et la pureté de la culture balinaise peut être vital pour l’hôtellerie, les transports aériens et le tourisme, mais qu’adviendrait-il si cela encourageait un mouvement balinais de résistance violente contre l’impureté de la commercialisation ? » (p 186). C’est alors la question de l’entreprenariat urbain qui est posée, en termes géographiques, comme « la dialectique de l’espace et du lieu ». Certaines formes de capitaux (financiers par exemple) sont extrêmement mobiles, d’autres ne le sont pas du tout (le foncier, par excellence). Un jeu complexe entre le mobile et l’immobile s’opère alors, faisant de la mondialisation « une structure géographiquement articulée d’activités et de relations capitalistes mondiales » (p 188). Les « machines à croissance urbaine » sont alors présentées comme des organes de gouvernance urbaine visant à la mise en synergie des facteurs valorisant la rente monopolistique dans un système interurbain concurrentiel pour ce qui est des capitaux mobiles. Le jeu de l’entreprenariat urbain est donc toujours de créer les conditions de l’exceptionnalité. Or, quoi de plus exceptionnel et singulier que la culture ? Lille n’est pas Paris, Liverpool n’est pas Londres. Mais la réussite même d’une construction managériale de l’exceptionnalité métropolitaine n’est pas sans contrepartie : Barcelone a su miser sur ses atouts culturels pour assurer un développement urbain remarquable au cours des trois dernières décennies. Mais le prix à payer en est contradictoire : la banalité des productions architecturales récentes et la congestion des réseaux de transport la défavorisent et l’uniformisent dans la médiocrité.
Où doit alors se situer le discours de la gauche vis-à-vis de ces rentes monopolistiques ? Dans le localisme intégral qui la caractérise (selon l’auteur) trop souvent ? C’est-à-dire dans la valorisation de la singularité première et irréductible des lieux ? Mais alors n’y a-t-il pas le risque de se perdre dans le racisme ou l’esprit de clocher ? Harvey là encore donne son point de vue, somme-toute assez attendu : à l’anti-mondialisme, il préfère l’altermondialisme et prend pour exemple l’expérience de Porto Alegre, une ville qui ne cherche pas à cultiver ses rentes monopolistiques, qui a développé des expériences de budgets participatifs sans prétendre « faire le socialisme dans une seule ville » et qui « construit activement de nouvelles formes culturelles et de nouvelles définitions de l’authenticité, de l’originalité et de la tradition » (p 204).
SECONDE PARTIE. VILLES REBELLES.
Autant le lecteur peu familier de David Harvey trouvera dans la première partie les bases d’une pensée marxiste de l’espace géographique, autant les lecteurs réguliers y trouveront des éléments de synthèse et d’actualisation intéressants, autant la seconde partie laissera tout le monde sur sa faim. Des trois chapitres un seul surnage : le chapitre 5 Reconquérir la ville au profit de la lutte anticapitaliste. Le chercheur s’y fait encore plus clairement militant. Surtout, il reprend ici la question exposée en préface à propos de l’œuvre d’Henri Lefebvre, filée au long de l’ouvrage et qui finalement peut s’exposer comme celle de la dialectique entre l’identité de lieu et l’identité de classe. Dialectique qui, dans certaines conditions seulement, peut aboutir à donner un contenu positif à l’expression de « droit à la ville » : « les luttes anticapitalistes doivent-elles se concentrer et s’organiser explicitement sur le vaste terrain de la ville et de l’urbain ? Le cas échéant, comment et pourquoi exactement » (p 209). A ce stade, l’ouvrage nous avait déjà convaincu de l’intérêt d’une analyse marxiste centré sur les sphères de la consommation et de la domination et non plus obnubilée par la sphère de la production et de l’exploitation. Restait à travailler des éléments concrets de ces « révolutions urbaines » appelées par David Harvey. Une fois de plus, l’auteur passe en revue les grands épisodes de révoltes urbaines plus ou moins abouties depuis la Commune de Paris de 1871, point de repère toujours aussi incontournable, puis les communes de Shanghai et les soviets de Petrograd, Barcelone 1936, Prague ou Paris 1968, Cordoba 1969, les rassemblements altermondialistes ou anti mondialistes (Seattle 1999) pour aboutir au mouvement des places (Syntagma, Tahrir, Puerta del Sol) en passant par Oaxaca et Cochabamba… L’air de la ville chez Harvey, rend libre. Reste à définir cette liberté, ses conditions et son caractère révolutionnaire. S’agit-il de revendications de droits (et donc de réformisme) ou d’anticapitalisme ? Sans chercher à trancher de manière trop rapide, Harvey s’efforce à montrer combien l’espace rattrape parfois les mouvements politiques ou syndicaux : tel syndicat réfléchit à une organisation en secteurs géographiques et non plus en secteurs productifs (p 241), tel parti politique (le PCF) laisse sa marque par son action municipale et citoyenne plus que nationale et classique (p 243). Surtout, Harvey développe un exemple documenté. Il s’appuie sur les travaux de Lesley Gill et Sian Lazar pour examiner ce que la situation d’El Alto (le doublon de La Paz, posé sur l’Altiplano et lieu de concentration des migrants ruraux pauvres attirés vers la capitale bolivienne) avait de véritablement révolutionnaire au cours des années 2000-2005, jusqu’à l’élection d’Evo Morales à la présidence de la république. Et de conclure que ce sont bien des éléments « de loyauté vis-à-vis de la ville, des éléments de citoyenneté » qui ont permis de construire une ville politique à partir des « processus débilitants de l’urbanisation néolibérale et de reconquérir la ville pour la lutte anticapitaliste » (p 266). Mais les limites de l’expérience d’El Alto (le réformisme finalement adopté par Evo Morales à la tête de l’état bolivien) poussent Harvey à relancer le débat : manque toujours une pensée plus globale capable de penser les relations hiérarchiques incontournables qu’implique l’articulation des échelles géographiques. Il se déclare ici plus proche des interrogations d’une philosophe comme Marion Iris Young (justice and the politics of difference) que des solutions marxistes plus ou moins horizontalistes promues par Toni Negri et Hardt (Commonwealth) ou du municipalisme plus ou moins libertaire d’un Bookchin (Remaking Society : pathways to a green future).
More