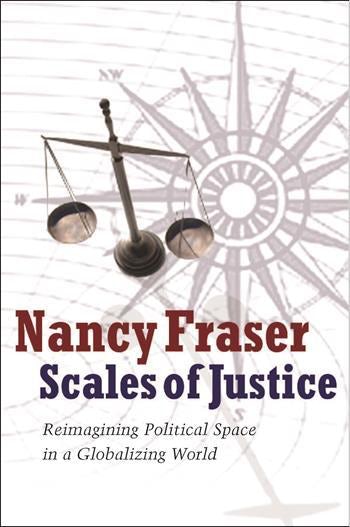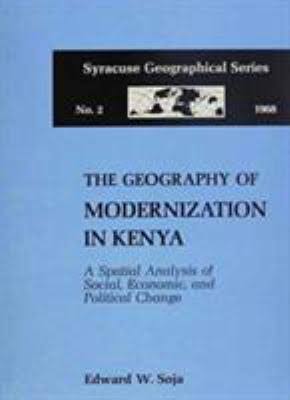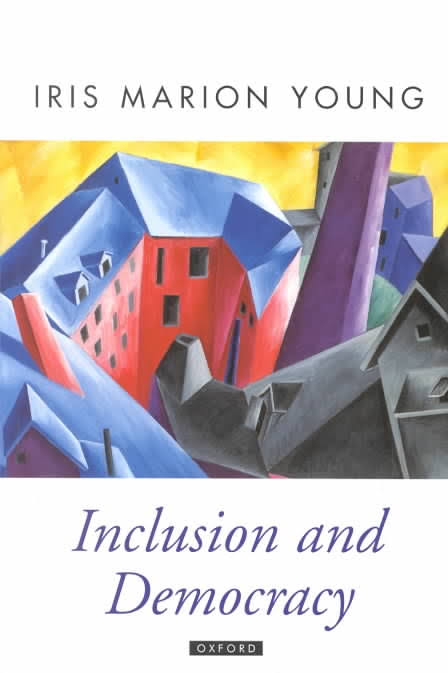
Forever Young : lectures situées
| commenté par : Frédéric Dufaux | Philippe Gervais-Lambony | Claire Hancock
Iris Marion Young, décédée prématurément en 2006, laisse une oeuvre théorique considérable et dont beaucoup d’aspects semblent extrêmement pertinents aux géographes soucieux.ses des relations entre justice sociale et espace. Dans ce texte, nous essayons de montrer quels traits de cette œuvre nous semblent contribuer à cette actualité, et comment nous nous en saisissons dans nos réflexions sur les villes contemporaines et les formes d’injustice que nous y identifions.
Ces lectures sont situées, dans le sens où nous savons que ce qui nous parle le plus dans les écrits de Young n’est pas nécessairement ce qui semblerait le plus novateur, ou important, à des spécialistes de philosophie politique ; nous assumons donc une sélectivité disciplinaire, en nous autorisant à saisir dans son œuvre ce qui éclaire le mieux pour nous la dimension spatiale des injustices.
Ces lectures sont situées aussi parce que nos lectures de Young sont de véritables rencontres, marquées d’une émotion que nous assumons. Avec Iris Marion Young, pour beaucoup de celles et ceux qui ont participé aux réflexions sur la justice spatiale au sein du collectif constitué autour de la revue JSSJ, il s’est passé quelque chose de cet ordre. C’est-à-dire que s’est établie une forme de connivence avec une personne, à travers ses écrits, en même temps que se révélaient des apports théoriques majeurs.
On peut se demander pourquoi une telle chose arrive. Dans le cas de Young, découverte par les géographes par le biais d’une réflexion sur le concept de justice spatiale, ou avant cela par ses travaux sur le féminisme, ou encore par des intermédiaires à la lecture de textes de David Harvey ou de Neil Smith, nous avons affaire à des textes de philosophie politique qui sont parole humaine, ici et maintenant. C’est une chose rare : engagement dans le concret de luttes, ancrage dans l’expérience personnelle, clarté absolue du propos, toujours, force de conviction, application systématique du théorique au réel et recherche de solutions se combinent à une extraordinaire capacité à transformer le regard porté sur la société, à faire changer de point vue théorique.
C’est donc un échange, certes inégal (parce qu’évidemment à sens unique quoi qu’on puisse en ressentir), avec une personne que nous avons développé avec Young. Il nous semble pour au moins trois raisons de fond. Pour les géographes que nous sommes, impossible de ne pas être sensibles au fait que les textes de Young, parce qu’elle les veut « applicables », impliquent une réflexion sur l’espace : « social relationships defined by location that have consequences for democracy and justice are not only metaphorical […] Space itself matters. Few theories of democracy, however, have thematized the normative implications of spatialized social relations » (2000, p. 198). Il y a chez Young, plus précisément, un intérêt direct pour l’espace urbain en tant qu’il serait le fondement de l’idéal-type d’une société juste. Et ce n’est pas par hasard non plus que l’on tombe en amour pour des textes dans lesquels les appels à la sensibilité et au plaisir sont si fréquents : plaisir de la ville, plaisir de la circulation dans l’espace urbain (ce que Young appelle la qualité érotique de l’urbain) qui peut aussi évoquer les textes d’une autre grande militante à la parole libre, Jane Jacobs. Ajoutons, et c’est lié, que pour des chercheurs de sciences sociales travaillant sur la base de travaux qualitatifs, la mise en question du « paradigme distributif » est essentielle : si l’on s’accorde sur ce point, c’est que les approches strictement quantitatives ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Enfin, pour des auteurs francophones, quelle libération que de lire des textes si clairement « engagés » ! Engagés au sens où ils balayent toute inquiétude de neutralité et d’objectivité scientifique et, plus même, nous rappellent sans cesse que, toujours, on parle d’un point de vue situé, que jamais on ne peut être extérieur ni surplombant.
Cette déclaration d’amour étant faite, nous proposons ici quelques développements sur les trois ouvrages les plus immédiatement importants pour nous : Justice and the Politics of Difference (1990) ; Inclusion and Democracy (2000) ; Responsability for Justice (2011).
Bien sûr, les liens entre ces trois ouvrages et le reste de l’œuvre d’Iris Marion Young sont organiques : sa pensée chemine et va en s’approfondissant d’un ouvrage à l’autre, dans un jeu d’harmoniques et de correspondances. Ses textes se répondent, précisant sa pensée ou donnant des éclairages, parfois décalés (ainsi, on comprend mieux Justice and the Politics of Difference [1990] en lisant le recueil On Female Body Experience [2005]). Un des fondements de cet enrichissement progressif, c’est la capacité de Young de se nourrir de pensées autres, et d’avancer avec ces lectures. Sans doute, la présence de nombreuses lectures dans une écriture de sciences sociales, en particulier dans le domaine anglophone est devenue extrêmement banale pour nous, et parfois même étouffante. La particularité des lectures de Young : ce sont des lectures en empathie, qui nourrissent sa propre écriture, et sur lesquelles elle revient longuement, comme dans un dialogue amical sur le temps long, en identifiant points d’accord et points de désaccord, mais aussi points d’approfondissement possibles de la réflexion de la personne qu’elle discute. Même dans des passages dans lesquels elle formule un désaccord important, elle constate souvent aussi, en parallèle, des apports de la réflexion avec laquelle elle diverge pour sa propre réflexion.
Il en résulte une écriture qui ne s’affiche pas du tout comme l’établissement d’une pensée radicalement en rupture mais plutôt comme une polyphonie, comme une discussion amicale à plusieurs voix (animée par de forts points de désaccord). D’une certaine façon, dans son écriture, Iris Marion Young donne corps à sa réflexion sur la « théorie morale féministe », avec la remise en question d’une expérience spécifiquement masculine des relations sociales, qui valorise la compétition et les accomplissements individuels isolés : « female experience of social relations, arising both from women’s typical domestic care responsabilities and from the kinds of paid work that many women do, tends to recognise dependance as a basic human condition » (Justice and the Politics of Difference, p. 55). La figure de l’autrice / de celle qui fait autorité apparaît donc volontairement ouverte aux voix qu’elle invite et qu’elle écoute. Les démonstrations de Young sont, volontairement, issues de ce tissage et du dialogue avec ces voix multiples.
Face à cette richesse et cette pensée vivante, nos lectures ne prétendent donc pas à l’exhaustivité, mais se veulent des incitations à lire, et utiliser, Young en géographie et études urbaines, tant sa pensée apporte de clés utiles pour répondre à nos questionnements. Nous ne discuterons ici que de trois façons dont l’œuvre de cette grande autrice contribue à des débats contemporains et fournit des réponses à des interrogations issues de nos recherches empiriques.
La première, c’est son élaboration théorique des « visages de l’oppression » et la réflexion sur la différence qui la sous-tend : si ses travaux des années 1990 nous parlent si directement aujourd’hui, c’est parce que nombre des débats qui ont eu lieu en Amérique du Nord dans les dernières décennies du XXe siècle sont aujourd’hui centraux en France. L’accent qu’elle place sur la « structure » comme « sujet de la justice » permet de sortir les formes de l’oppression du cadre des relations interpersonnelles ou des relations entre groupes pour mettre en évidence leur caractère systémique.
Le second aspect qu’aborde ce texte, c’est la façon dont Young a travaillé le contexte urbain comme lieu d’expression des enjeux de la justice : c’est en effet une caractéristique de son travail que de ne pas rester dans l’abstraction, mais de se nourrir d’une implication active dans les enjeux sociaux de la société dans laquelle elle s’inscrivait, et de lectures approfondies de travaux de sciences économiques et sociales sur la ville. C’est ainsi qu’elle aborde les questions de différence en ville, les enjeux de la ségrégation résidentielle et ceux de l’établissement de démocraties locales qui résonnent dans toutes les aires urbanisées aujourd’hui.
Enfin, dans le prolongement de son travail de réflexion féministe et toujours dans des contextes citadins, Young s’est plongée dans les expériences différenciées de l’espace, depuis l’échelle du corps jusqu’à celle de la région urbaine, que peuvent faire des catégories différentes, femmes, personnes âgées… Sa pensée permet d’inscrire pleinement dans le politique ces différences parfois lues comme biologiques ou affaire d’essence, mais aussi de proposer une pensée de la responsabilité de chacun, question, aujourd’hui heureusement de plus en plus reconnue comme majeure par les sciences sociales et humaines, d’éthique de la recherche.
Justice et différence : poser les bases en 1990
L’ouvrage de Young de 1990 est un choc. Il pose les bases d’une pensée de la société qui connaîtra des échos immenses, il inverse nos perspectives et interroge vigoureusement nos idéaux républicains. Parce qu’il déboulonne radicalement ce que Young appelle le « paradigme distributif » : à partir de là, il n’est plus possible de penser l’injustice seulement en termes de distribution matérielle inéquitable. En même temps, le même ouvrage démonte aussi l’idée selon laquelle qui que ce soit pourrait être en position surplombante de dire ce qui est juste : le juste ne peut être que dialogique. Enfin, plus possible non plus de raisonner seulement en termes d’individus (reproche que Young fait à la théorie de John Rawls) : la définition de Young porte sur les dominations et les oppressions de groupes sociaux parce que, simplement, l’individu isolé n’existe pas. Dès lors, l’injustice est la domination en cela qu’elle empêche certains groupes de faire des choix, ou l’injustice est l’oppression en cela qu’elle empêche certains groupes d’acquérir les moyens mêmes de faire ces choix. Toute oppression est en même temps domination, en revanche la domination n’implique pas forcément l’oppression. Cette dernière peut prendre cinq formes (qui peuvent se combiner) qui, quoique désormais bien connues, méritent qu’on les rappelle ici :
– l’Exploitation. Liée au système capitaliste, elle correspond à l’oppression des classes sociales défavorisées, non pas seulement parce qu’elles ne bénéficient pas d’une redistribution équitable des revenus de leur travail, mais aussi parce qu’elles sont exclues des processus de prise de décision, des choix individuels de vie et de la reconnaissance de leur identité collective.
– la Marginalisation. Elle concerne ceux qui ne sont pas inclus dans le fonctionnement de la société, notamment du monde du travail. Ces exclus de la vie sociale (vieux, mères célibataires, sans logis, sans emploi ni espoir d’en trouver un…) perdent le respect de soi, même s’ils bénéficient d’une redistribution économique qui leur permet de survivre.
– l’Absence de pouvoir – Powerlessness. Elle désigne l’oppression de ceux qui, indépendamment des questions de redistribution économique, sont exclus de toute prise de décision, soit sur leur lieu de travail, soit dans leur espace de vie en général.
– l’Impérialisme culturel. Il diffère des trois premières formes d’oppression car il n’est pas directement lié aux rapports au travail ou dans le travail. C’est le processus par lequel un groupe est rendu invisible : « the universalisation of a dominant group’s experience and culture, and its establishment as the norm » (Young, 1990, p. 59, traduit par nous). Il passe par la désignation comme « autre ». Le groupe qui subit cette oppression est donc défini de l’extérieur, dans le même temps il est rendu invisible et stéréotypé.
– la Violence. Il ne s’agit pas de la violence individuelle, mais de celle faite à un groupe. Plus précisément, ce n’est pas la violence en soi qui constitue une oppression, mais le fait qu’elle devienne une « pratique sociale » envers certains groupes sociaux, pratique éventuellement considérée comme acceptable (dans le cas des femmes tout particulièrement, mais aussi bien sûr des minorités en général) parce qu’elle est simplement la conséquence de l’appartenance au groupe.
À partir de là, on définira une situation comme injuste quand un groupe est victime d’au moins une de ces formes d’oppression, aucune n’est strictement de l’ordre du distributif… Peut-il exister une société où ces formes de domination et d’oppression seraient absentes ? Young s’efforce de répondre à cette question dans le dernier chapitre de Justice and the Politics of Difference : selon elle une telle société pourrait se déployer, idéalement, dans un espace citadin. Et c’est dans ce chapitre que l’on trouve sans doute l’expression la plus forte de la relation de Young à la ville, une ville utopique ?
Young et la ville : « City life as an openness to unassimilated otherness » (1990, p. 227)
Fondamentalement Iris Marion Young est une « citadine ». D’ailleurs, les luttes sociales auxquelles elle participe sont urbaines. Les questions qu’elle pose, en termes de justice sociale, concernent centralement les espaces urbanisés. Et comme elle le dit elle-même, son point de départ est la ville nord-américaine : « normative reflection arises from hearing a cry of suffering or distress, or feeling distress oneself. The philosopher is always socially situated » (1990, p. 5).
Cette articulation entre réflexion normative et écoute attentive de la souffrance ou de la détresse, l’œuvre d’Iris Marion Young en offre un exemple saisissant avec un retour sur un épisode brutal de son histoire familiale, qui est aussi l’occasion d’une réflexion sur la capacité émancipatrice de la grande ville. L’« Interlude » du texte « House and Home » (On Female Body Experience, recueil de 2005 : « Interlude: My Mother’s Story » [p. 133-136]) restitue cette expérience fondatrice. Ce texte est éclairant par sa dimension autobiographique, et saisissant par la restitution du caractère oppressif et normalisateur du voisinage de banlieue de la fin des années 1950. Iris Marion Young y narre l’histoire de sa mère, jeune veuve dans les suburbs du New Jersey, après le décès soudain de son époux, qui la laisse seule avec trois enfants (dont Iris Marion). Sa mère, toute à la douleur du deuil (et aussi plus intéressée par les livres et la vie créative que par les tâches ménagères) est rapidement considérée comme une « mère indigne » par ses voisins intrusifs, parce qu’elle néglige sa maison. Elle se voit retirer ses enfants, puis, après un début d’incendie, connaît même la prison : « The dream of a house in the suburbs became my mother’s nightmare » (p. 133) (« Le rêve d’une maison en banlieue est devenu le cauchemar de ma mère » [notre traduction]). Il y a là des pages d’une grande force sur l’expérience de l’oppression au quotidien par un voisinage bien-pensant, qui impose brutalement son mode de vie comme seul normal. La libération vient (après, pour les enfants, plus d’un an en foyer puis en famille d’accueil) grâce au départ vers la grande ville : l’émancipation de la mère et la reconstitution du foyer sont assurées par le retour dans New York : « the safe indifference of New York City » ! Une grande ville qui libère, par la possibilité de l’indifférence, et de la coexistence de normes et de comportements profondément différents, sans intrusion.
On comprend peut-être mieux, dès lors, pourquoi la ville chez Young tient deux rôles. Elle est à la fois l’espace par excellence où pourrait de réaliser matériellement la justice sociale (Justice and the Politics of Difference) et l’espace par excellence où elle n’est pas réalisée (chapitres sur la ségrégation d’Inclusion and Democracy). À 10 ans d’écart ces deux textes se répondent. Plus précisément est détaillée en 2000 ce qui est ébauché en 1990 : une proposition de gouvernement urbain respectueux des différences. En même temps, Young, d’un texte à l’autre, fonde une vision ambivalente de l’urbain : il est l’idéal possible jamais atteint, il est l’espace de la pire ségrégation.
Nous trouvons donc chez Young : une définition de la vie citadine (city life) idéale ; une définition de la ségrégation comme injuste et de l’agrégation affinitaire comme juste (d’où un apparent paradoxe qu’elle résout avec l’idée de « differenciated solidarity ») ; une proposition de gouvernement de la ville tenant compte des échelles métropolitaines.
La ville citadine idéale pour Young est « a form of social relations which I define as the being together of strangers… » (1990, p. 237). Mais elle doit permettre aussi l’existence de « communities » affinitaires. Les caractères de la ville dans laquelle pourrait se déployer cette vie citadine idéale sont :
– la différenciation sociale sans exclusion ;
– la variété des usages de l’espace ;
– l’érotisme (c’est-à-dire le plaisir de l’expérience concrète de la différence par la rencontre avec l’autre) ;
– l’existence de l’espace public (condition des contacts entre individus et groupes différents).
Certes. Mais cette ville n’existe pas, en tout cas pas dans les États-Unis au moment où Young écrit, elle le sait : c’est au contraire une ville où se dressent murs et séparations, de plus en plus… Et Young sait aussi que son idéal-type peut être totalement incompris ou détourné, et c’est bien souvent ainsi que l’entendent des lecteurs francophones peu habitués à penser la société en termes de groupes sociaux différenciés : en quoi la ville qui respecte des espaces « communautaires » n’est-elle pas, justement, la ville ségréguée ?
D’où, en 2000, une interrogation centrale pour Young : qu’est-ce qui distingue une situation de ségrégation injuste d’une situation de différenciation juste ? Comment déterminer si la différenciation socio-spatiale est volontaire ou imposée ? Young s’appuie sur un autre des auteurs favoris de JSSJ, Peter Marcuse, elle reprend la distinction qu’il propose entre l’enclave (volontaire, affinitaire) et le ghetto (imposé). Mais comment faire la différence entre l’un et l’autre, donc entre « residential clustering » et « residential segregation » dans une ville multiculturelle ? Young, méthodiquement, propose des critères. On pourra déterminer que l’on a affaire à un espace ségrégué si : sa population est discriminée quand elle cherche à se loger ailleurs ; si l’espace est stigmatisé par les autres citadins ; si l’on observe un départ du quartier des citadins du groupe dominant ; si l’on note une faiblesse des investissements publics et privés dans le quartier ; quand les services urbains sont de faible qualité ou absents. Mais la question de la ségrégation reste une difficulté, reflet spatial de la difficulté à traiter de la question des groupes sociaux « affinitaires ». En effet, l’application de la reconnaissance des groupes affinitaires fait courir le risque d’une justification de la ségrégation spatiale, de la même manière que dans le social elle fait courir le risque d’une acceptation du communautarisme.
À cela s’ajoute, enfin, un problème d’échelles, avec ce que Young appelle un dilemme normatif : la grande échelle (quartier) permet la démocratie, la petite échelle (métropolitaine) est nécessaire à la démocratie. Cela conduit à se poser des questions similaires à celles de Nancy Fraser sur le « qui » de la justice (voir le texte qui est consacré à Nancy Fraser dans la présente rubrique « JSSJ a lu ») : envers qui est-on dans une « relation de justice » ? Cela conduit aussi Young à élaborer un modèle de gouvernance qui combine les deux échelles, pour une « décentralisation décentrée » qui permet à la fois l’autonomie et la négociation.
À ce point de sa réflexion, dans Inclusion and Democracy, Young semble penser la ville en termes de groupes sociaux-spatiaux (assez proches des classes socio-spatiales d’Alain Reynaud). Mais, malgré l’importance accordée à l’espace, elle ajoute que la réflexion sur les groupes sociaux ne peut pas s’y limiter, que le territorial n’épuise pas la question. En effet, comment prendre en compte les groupes transversaux (femmes, enfants, etc.) et comment les intégrer au modèle de gouvernance ? Young propose de sortir de cette difficulté en mobilisant une notion d’échelle que l’on pourrait dire aterritoriale : « the scope of the polity […] ought to coincide with the scope of the obligations of justice which people have in relation to one another because their lives are intertwined in social, economic, and communicative relations that tie their fates » (2000, p. 229). D’où la solution finalement proposée de « decentred decentralization » et « relational autonomy ». C’est-à-dire : autonomie de l’échelle locale mais possibilité pour les autres territoires et groupes affectés par des décisions locales de se manifester pour demander à négocier ces décisions. Ceci est fondé sur la reconnaissance d’une « relation de justice ». Il faut donc créer des mécanismes qui permettent ces communications, c’est le rôle du gouvernement métropolitain, qui ne doit pas être hiérarchiquement « au-dessus » mais permettre les articulations entre territoires locaux. En conséquence, il faut un double mode de représentation au niveau métropolitain : représentation de chaque territoire local, mais aussi de chaque groupe transversal (femmes, jeunes, etc…). Dès lors, les décisions locales ne sont pas prises qu’en considération de leurs conséquences locales mais aussi des conséquences sur les autres territoires.
Cette volonté têtue d’Iris Marion Young de proposer toujours, malgré les difficultés théoriques, des options politiques et des horizons d’action, est très caractéristique de la dimension éthique et politique de son œuvre, dimension dont le terme de « responsabilité » est celui qui rend le mieux compte. Il est dès lors tout à fait légitime que son livre posthume, publié en 2011, soit intitulé Responsability for Justice, et légitime aussi pour nous de conclure le présent texte en évoquant cet ouvrage qui à nouveau mobilise des réflexions sur les injustices « urbaines » pour proposer des avancées théoriques.
Justice et responsabilité : une affaire qui nous concerne
Le deuxième chapitre de Responsibility for Justice est intitulé « Structure as the subject of justice » et consacré à l’explicitation de ce qu’est l’injustice structurelle. Young y part du cas de Sandy, une jeune mère de famille isolée, qui se retrouve à la rue avec ses enfants, pour expliquer qu’il s’agit d’une forme d’injustice dans laquelle on ne peut identifier ni un individu qui serait « coupable » du tort qui lui est fait, ni une politique précise qui l’aurait causé. Iris Marion Young opère alors un détour par l’analyse des marchés du logement dans les villes états-uniennes (en entrant très précisément dans les enjeux liés aux coûts du foncier, aux marchés financiers, à la régulation des loyers, aux zonages, aux règles sur les densités de construction…), l’asymétrie entre propriétaires et locataires, la déconnexion entre l’offre et la demande de logement : en d’autres termes, elle prend la production de l’espace urbain comme illustration de ce qu’est la « contrainte objective », tout un cadre normatif et légal, auquel s’ajoutent des structures sociales qui apparaissent comme des faits sociaux échappant aux individus. Ces « faits sociaux » sont, en l’occurrence, la position de classe et de genre de Sandy, qui détermine son parcours, le type d’emploi auquel elle a accès, le fait qu’elle se retrouve avec la charge d’enfants… mais aussi tout un ensemble de normes sociales partagées quant à ce qui constitue un quartier « sûr » pour élever des enfants, qui viennent de la classe moyenne mais que des personnes plus défavorisées comme Sandy ont internalisées également.
Dans cet exemple, la ville sert de métaphore pour la « structure » : sa configuration reflète à la fois une somme de choix individuels et de préférences collectives (où construire, où habiter, où faire ses courses, comment se déplacer…), tout un ensemble d’actions individuelles qui toutes additionnées (re)produisent la structure. L’exemple illustre aussi ce que Young appelle les conséquences non voulues (« unintended consequences ») : cette somme d’actions individuelles conduit à un résultat qui n’est souhaité par personne (une famille qui se retrouve à la rue), dont personne n’est coupable, mais qui est injuste (car il ne peut être juste que, dans une société riche, une personne se trouve dans une telle insécurité). Et ce résultat a, comme la ville, tout l’aspect d’un fait concret, sur lequel personne n’a de prise, un héritage d’une multiplicité de choix passés qui prend forme matérielle dans une structure (qui peut apparaître indépendante de ces choix, et extérieure à toute intentionnalité). Mais, et c’est le propos de Responsibility for Justice, tout.e membre de cette société (tout.e habitant.e de cette ville) participe à en (re)produire la structure, et donc détient une part de responsabilité individuelle.
Young appuie son raisonnement sur un grand nombre de travaux d’économistes et de sociologues travaillant sur l’urbain, et ne sous-estime pas la dimension spatiale de ce qu’elle décrit : c’est parce que le type d’emploi que Sandy est susceptible d’occuper se trouve, dans une ville états-unienne, dans une lointaine périphérie qui n’est pas desservie par les transports en commun, qu’elle est obligée d’investir dans l’achat d’une voiture, et se trouve par là même privée du dépôt de garantie pour louer un nouveau logement. Tout en apportant des élaborations conceptuelles précieuses, Young nourrit sa pensée des apports empiriques d’autres disciplines, et d’un souci minutieux du réel et des mécanismes socio-spatiaux à l’œuvre. C’est cette qualité qui rend son travail éminemment pertinent pour des géographes ou spécialistes de la ville, qui n’ont pas à la suivre dans un registre d’abstraction excessive, juste à travailler pour recontextualiser et adapter ce qu’elle écrit à des contextes urbains où les mécanismes sont différents.
La pensée d’Iris Marion Young s’avère également politiquement utile pour réfléchir sur les injustices : c’était déjà le cas avec Justice and the Politics of Difference, son classique de 1990, où elle avait déjà posé l’idée de la violence systémique, bien distincte de la violence interpersonnelle. Comme elle l’explique à nouveau dans l’ouvrage de 2011, une personne qui commet un tort à notre endroit (mensonge, manque de respect…) ne commet pas pour autant une injustice. L’injustice vient de structures qui permettent que ces torts soient commis en toute impunité, une société qui normalise certaines formes de mépris et de violence, un système judiciaire qui ne sanctionnera pas, par exemple, une violence policière commise à l’encontre d’une personne racisée, ou qui minorera la gravité d’un viol.
Mais le message, important, est bien aussi que ces structures ne sont pas totalement extérieures aux actes individuels, les personnes impliquées ont une prise sur elles, et donc la responsabilité de se mobiliser, à leur échelle, par les moyens dont elles disposent, pour changer ces états de fait injustes. Elle s’inscrit donc en faux contre une certaine forme d’apathie qui pourrait venir de la désignation de la structure comme sujet de la justice, qui ne dégage en rien des responsabilités individuelles de faire quelque chose ; son propos n’épargne pas non plus la complaisance qu’il peut y avoir (et nous chercheur.e.s ne sommes pas à l’abri de cela) à se contenter de désigner des coupables (le néolibéralisme, le gouvernement, le méchant propriétaire qui met une famille à la rue…) sans envisager notre complicité éventuelle (quel.le universitaire pourrait certifier que ses stratégies résidentielles ne participent pas de logiques de gentrification, par exemple ?).
Ces réflexions sont importantes aujourd’hui pour nous, en France, dans un contexte où les enjeux de la différence et les formes de domination des minorités ont longtemps été passées sous silence ou discréditées sous couvert d’universalisme. Cette situation explique comment notamment les organismes officiels chargés de la lutte contre le racisme persistent à dépeindre le racisme comme une disposition individuelle, quelque chose qui se joue dans l’interpersonnel, plutôt que de reconnaître son caractère structurel – ainsi, traiter les difficultés d’accès au logement ou à l’emploi des personnes racisées comme étant le fait d’une poignée d’individus racistes occulte l’ampleur structurelle de ce qui produit de la ségrégation et de la pauvreté. Cela permet aussi de se voiler la face sur le fait que chacun.e d’entre nous, indépendamment de ses intentions ou de sa volonté personnelle, peut être indirectement bénéficiaire de structures racistes, sexistes ou classistes, et donc avoir une part de responsabilité pour modifier ces structures (à bien distinguer, donc, d’une quelconque culpabilité susceptible d’être sanctionnée par le système judiciaire).
L’exemple de la ville fonctionne particulièrement bien ici parce qu’il permet de mettre en évidence les interrelations et ce que Young appelle les connexions sociales : les choix individuels, nos habitudes et actions quotidiennes, affectent les autres habitant.e.s d’un même espace urbain, à cause de cette coprésence au sein d’un même espace. Mais elle montre aussi comment ces connexions se nouent également à d’autres échelles, y compris l’échelle mondiale, puisque les choix opérés par des consommateurs de pays du Nord ont des impacts sur les modes de production et conditions de travail de producteurs de pays du Sud : ces consommateurs ont une responsabilité, car ils ont la possibilité d’acheter autrement, de préférer les habits produits dans des conditions correctes, par des travailleur.se.s majeur.e.s et correctement rémunéré.e.s, au lieu de bénéficier indirectement de conditions de production s’apparentant à de l’exploitation, et qui font peu de cas de la santé ou de la sécurité des employé.e.s. De même, ces responsabilités s’étendent dans le temps : ainsi, il importe de reconnaître une responsabilité historique des sociétés esclavagistes, ou des sociétés américaines qui ont massacré et spolié des populations amérindiennes, et de tenter de réparer concrètement ces torts constamment reproduits dans des injustices sociales toujours vives.
Un appel à la responsabilité qui peut servir ici de conclusion à ces quelques pages ; c’est aussi un appel à rester, toujours, forever, « young », projet utopique, clin d’œil joyeux que nous sommes convaincus qu’Iris Marion Young aurait volontiers partagé avec l’alias de Robert Zimmermann.
More