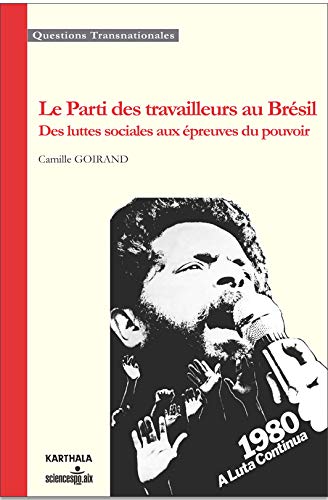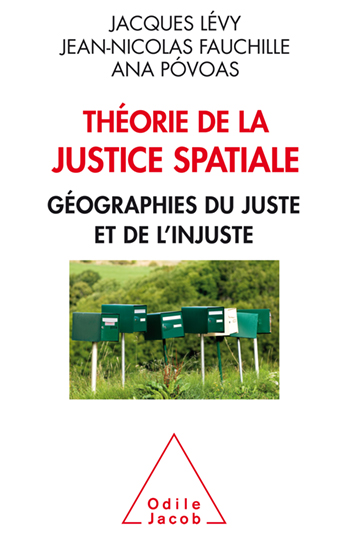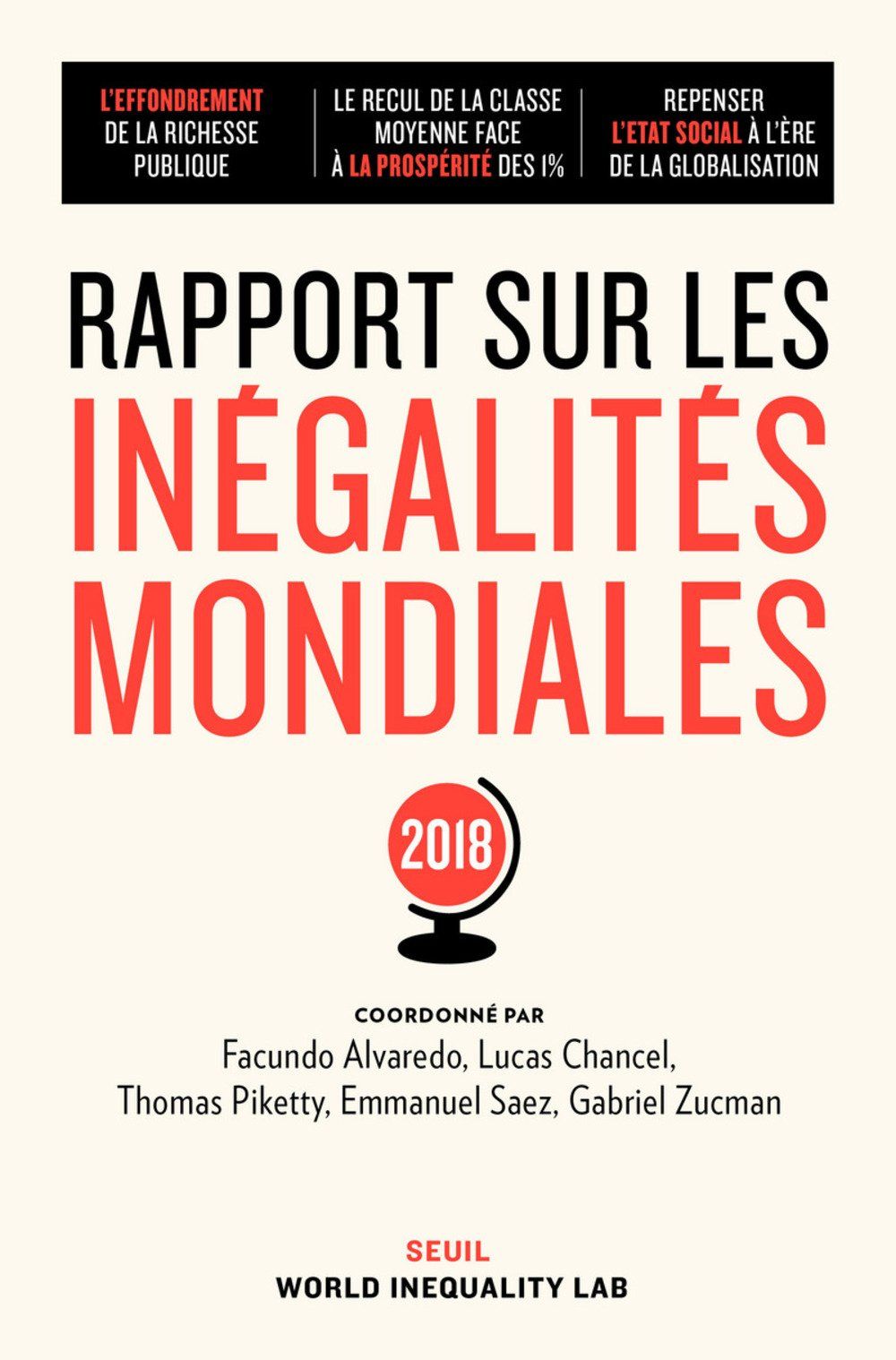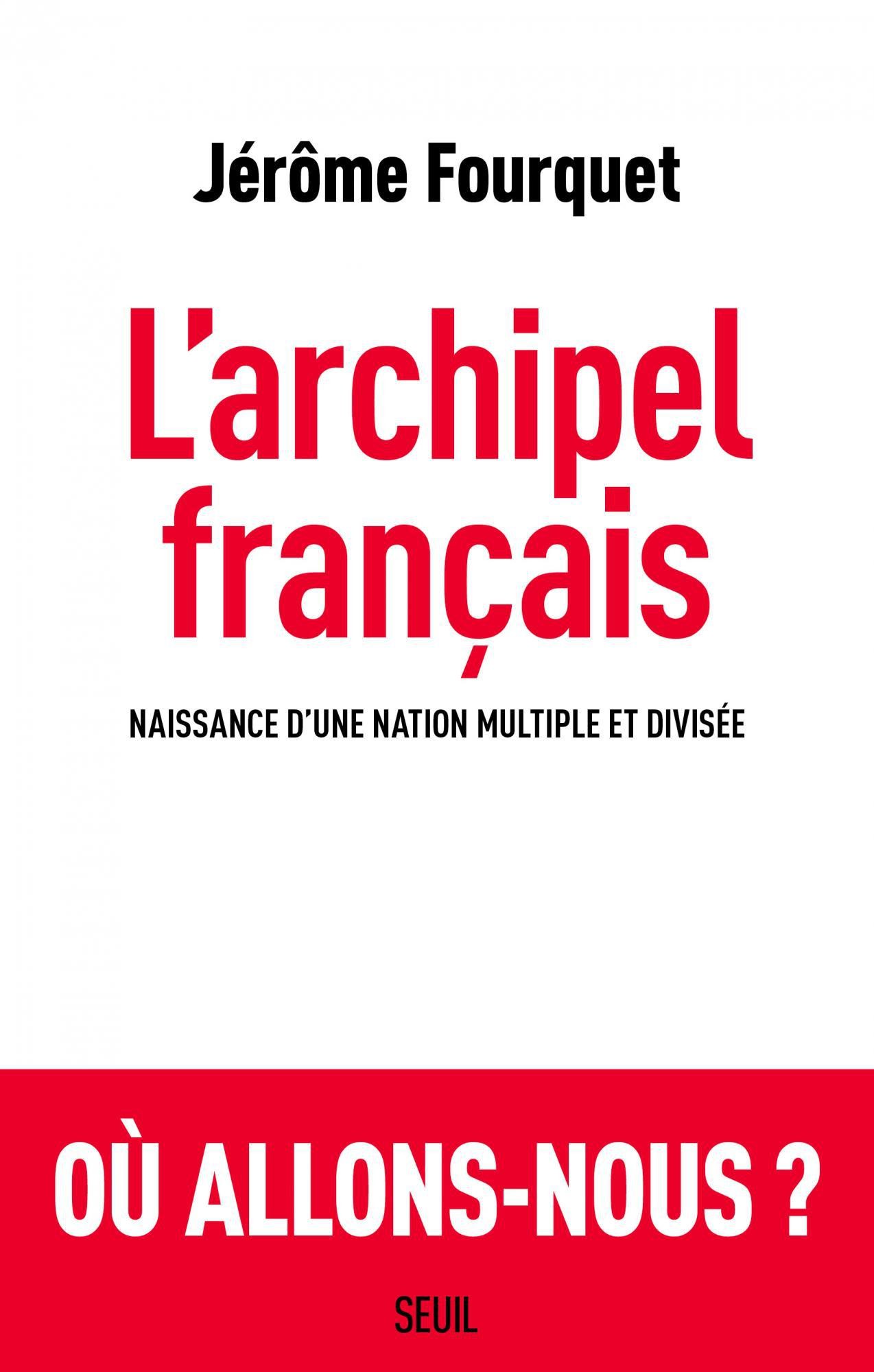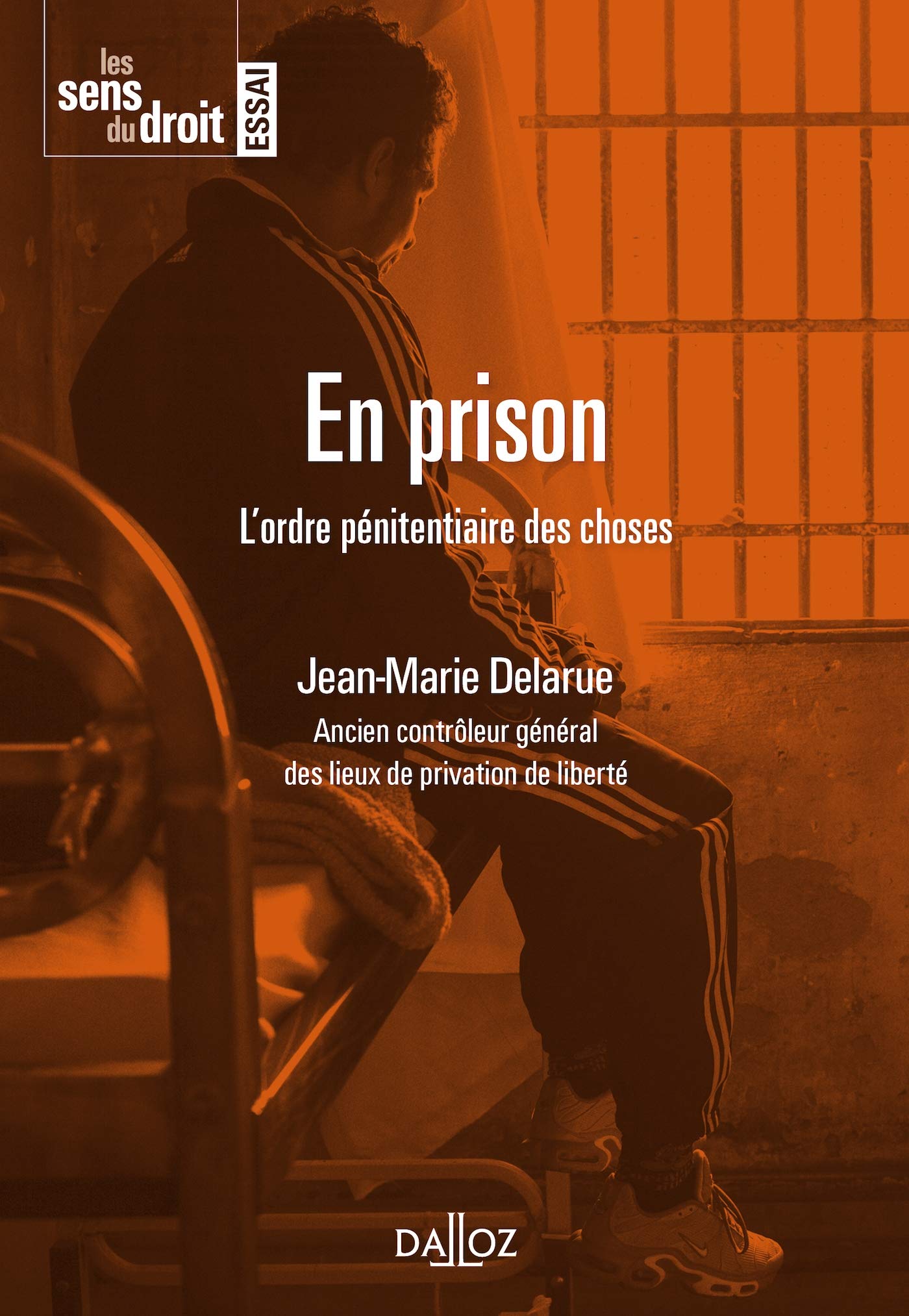
Jean-Marie Delarue
En prison. L’ordre pénitentiaire des choses
Paris, Dalloz, 2018, 877 p. | commenté par : Franck Ollivon
Le livre de Jean-Marie Delarue « En prison, l’ordre pénitentiaire des choses » a suscité une discussion au sein de la revue. Aussi, le comité de rédaction a choisi de soumettre à ses lecteurs deux points de vue différents. Cette démarche inédite, mais susceptible d’être renouvelée, confirme que Justice Spatiale/Spatial Justice se veut être un lieu de débat.
Alors que le gouvernement français lance un « Plan pénitentiaire » destiné à doter le pays de 15 000 places de prison supplémentaires au cours de la prochaine décennie, l’ouvrage que publie Jean-Marie Delarue, En prison. L’ordre pénitentiaire des choses, permet de porter un regard averti sur l’état actuel des prisons françaises.
Le propos se nourrit de l’expérience que l’auteur a acquise du système pénitentiaire français à travers sa fonction de Contrôleur général des lieux de privation de liberté entre 2008 et 2014. Outre une connaissance très riche de la réglementation et de la jurisprudence tant françaises qu’européennes, Jean-Marie Delarue s’appuie sur les visites de contrôle réalisées dans les lieux de détention pendant ses six années de fonction ainsi que sur l’abondant courrier adressé au Contrôleur par les détenus, leurs proches ou leurs avocats. Dès l’introduction, l’auteur précise qu’il entend mobiliser ce matériau afin de poser un regard neuf sur les espaces carcéraux par rapport à l’ample littérature qui leur est consacrée. Selon ses termes, il s’agit « d’ajouter une pièce au puzzle ». Dès lors, Jean-Marie Delarue assigne deux fonctions à son ouvrage : décrire les conditions d’existence des personnes détenues et établir l’écart qu’il estime croissant entre la norme juridique encadrant la détention et la pratique effective de celle-ci. De ces deux enjeux, le second prend nettement le pas sur le premier dans la mesure où la description est très largement structurée par cette tension entre la norme et la pratique. En témoigne le plan général de l’ouvrage qui se décompose en trois parties. L’espace carcéral est ainsi successivement appréhendé sous l’angle des codes pénal et de procédure pénale, sous l’angle de l’administration pénitentiaire et enfin sous l’angle de la personne détenue. Le lecteur glisse ainsi progressivement du texte de loi à son application concrète, la dernière partie étant de loin la plus développée.
Après un premier chapitre historique succinct prolongeant l’introduction, la première partie rappelle d’abord que la prison n’est que l’une des modalités pénales contemporaines dont les missions sont variées – punition, défense de la société, réhabilitation du détenu, prévention de la récidive – et parfois difficilement conciliables. L’auteur s’attache ensuite à décrire cette population carcérale qui connaît une croissance particulièrement marquée depuis 2000 ce qu’il attribue à l’évolution de la législation et des pratiques de l’institution judiciaire (rôle accru des parquets, procédures de comparution immédiate, multiplication des courtes peines conduisant à l’incarcération, peines dites « plancher »…). Il revient ensuite sur les deux grandes catégories juridiques constituant la population carcérale française, les prévenus et les condamnés. Il s’attarde enfin sur les différents mécanismes juridiques qui permettent la réduction ou l’aménagement de peine et donc une sortie de prison anticipée par rapport au quantum de peine prononcé.
La deuxième partie commence par un premier chapitre consacré à la « règle carcérale » principalement définie par le Code de procédure pénale avant 2000, mais dont Jean-Marie Delarue montre qu’elle a depuis été enrichie par « de nombreux textes normatifs et une jurisprudence active » : Règles pénitentiaires européennes et Protocole de la Convention des Nations Unies contre la torture à échelle internationale, loi pénitentiaire et code de déontologie pénitentiaire à échelle française par exemple. Il fait toutefois ressortir une limite majeure à cette régulation : « dans la loi pénitentiaire, comme dans les textes réglementaires qui l’ont précédée et suivie, la mise en œuvre des droits des personnes détenues est toujours subordonnée à la sauvegarde de la sécurité et du bon ordre de l’établissement » (p. 126). Il montre alors comment s’organise le contournement de certaines de ces règles en prison au nom de la sécurité et du bon ordre en prenant l’exemple des fouilles « intégrales » ou « à corps ». Il en conclut à « la large part d’autonomie dans la prise en charge des personnes détenues dont bénéficient les personnels de surveillance et la part modeste qu’y tient la référence à une norme explicite » (p. 132). Ce constat l’amène à décrire d’abord le personnel pénitentiaire avant d’exposer les conditions de travail de celui-ci dans un neuvième chapitre consacré au parc immobilier pénitentiaire. Le dernier chapitre de cette deuxième partie expose en détail le fonctionnement de la discipline pénitentiaire. Il interroge ainsi utilement l’hybridité du dispositif disciplinaire carcéral « qui balance entre le pouvoir unilatéral de sanction conféré à un responsable hiérarchique et les garanties qui s’attachent à un procès contradictoire » (p. 177). Il montre enfin comment ces procédures disciplinaires constituent pour les chefs d’établissement des « éléments de négociation et de pression » tant à destination des détenus que du personnel.
La troisième partie évoque le quotidien de la détention pour les personnes détenues à travers des chapitres thématiques : l’entrée et l’affectation, la vie en cellule, la vie hors de la cellule sous l’angle des « loisirs » (promenade, sport, enseignement et culture) puis sous l’angle du travail et de la formation professionnelle, l’accès aux soins, et enfin « la rencontre du dedans et du dehors » sous l’angle des liens « désintéressés » puis des « liens monétaires ». De cette longue troisième partie qui constitue à elle seule plus de la moitié de l’ouvrage, on retiendra notamment le chapitre sur le travail en prison. Il montre les contradictions du système pénitentiaire qui fait du travail un élément de la réinsertion mais peine à en organiser les conditions concrètes dans les établissements et maintient des niveaux de rémunération faibles, bien inférieurs à ce qui se pratique en-dehors. De même, le chapitre sur l’accès aux soins est assez éloquent : alors que les quelques études sur le sujet montrent que l’état de santé des détenus est préoccupant et alors que l’encadrement médical en prison reste dans l’ensemble médiocre, les contraintes de la vie carcérale et en particulier la gestion des circulations de détenus occasionnent un fort absentéisme des détenus aux rendez-vous médicaux fixés, rendant « inutiles entre le tiers et le quart des moyens déployés » (p. 513). Dans la conclusion de l’ouvrage, Jean-Marie Delarue revient sur la politique pénitentiaire française qui est certes relativement centralisée mais, pour lui, se définit avant tout « dans chaque coursive puisque le surveillant – c’est la noblesse et le malheur du métier – largement libre de définir à sa guise le choix des moyens, non seulement imprime sa manière d’être dans la construction des rapports sociaux qui se nouent, mais aussi […], sauf à l’égard de quelques fortes individualités, a le dernier mot » (p. 736). Bien qu’elles ne soient pas toujours mobilisées dans l’ouvrage, signalons enfin la richesse des annexes, en particulier les annexes 4.13 (p. 795 et suivantes) donnant la parole aux personnes détenues.
Au total, l’ouvrage remplit tout à fait les deux fonctions que son auteur lui attribue en introduction. Du point de vue de l’enjeu descriptif, le propos est tout particulièrement riche de ses nombreuses références aux textes de loi et à la jurisprudence consacrés à la prison. Éclairé par son expérience de haut-fonctionnaire au Conseil d’État, Jean-Marie Delarue donne à lire un commentaire fort stimulant de ce matériau juridique et normatif au service d’une lecture critique du traitement par le législateur du fait carcéral. À ce regard de juriste s’ajoute l’abondance des cas concrets provenant d’établissements pénitentiaires variés puisque, comme il est rappelé en introduction, tous les établissements pénitentiaires français ont été visités par les contrôleurs du contrôle général des lieux de privation de liberté entre 2008 et 2014, à l’exception des établissements des îles Marquises et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’auteur dresse donc un tableau très complet qui embrasse la condition carcérale dans ses moindres détails. Dans cette somme volumineuse de près de 877 pages, on pourra cependant regretter que le souci d’exhaustivité soit poussé à l’excès, en particulier dans la troisième partie où un certain nombre d’éléments rapportés restent peu ou pas analysés : c’est par exemple le cas de la description des menus détaillés des repas froids servis au détenu entrant en détention après l’heure des repas dans quatre maisons d’arrêt (p. 242).
Au-delà de la seule description, l’ouvrage obéit à un second enjeu, celui de faire ressortir l’écart entre la norme et la pratique carcérales. Jean-Marie Delarue constate tout d’abord le fossé qui sépare l’espace carcéral tel que le représentent les textes juridiques et normatifs et l’espace carcéral concret pratiqué par les détenus et les surveillants. L’espace cellulaire (en particulier pour les personnes handicapées ou les mères avec enfant, voir p. 278-279), les déplacements des détenus au sein de l’espace carcéral (par exemple les difficultés des mineurs ou de ceux qui travaillent pour accéder à la promenade, voir p. 359) ou encore la séparation entre les différentes populations carcérales connaissent parfois dans certains établissements des entorses sinon aux réglementations du moins aux objectifs affichés par l’administration pénitentiaire.
Jean-Marie Delarue ne se contente pas de ce constat et montre les nombreuses variations que connaît la condition carcérale selon les établissements. Qu’il s’agisse de la superficie des cours de promenade, des infrastructures sportives, de l’accès au travail, à l’enseignement ou aux soins, les établissements français présentent de grandes disparités, indépendamment des catégories auxquelles ils appartiennent, maison d’arrêt ou établissement pour peine. Plus encore, au sein d’un même établissement, les différences peuvent être radicales : « à la maison d’arrêt d’Ajaccio, la […] surface par personne varie selon les cellules (toute surface incluse) de 3,8 m² à 12,35m² » (p. 274). Le constat de ces variations, répété de page en page sur la quasi-totalité des thématiques abordées par l’ouvrage, permet à l’auteur de conclure que la prison, « en France et ailleurs », repose sur un antagonisme entre uniformité et diversité, antagonisme fondamental puisqu’un certain nombre d’autres en découlent selon lui (individualisation/socialisation, immobilité/mouvement, amendement/dangerosité…). Si l’uniformité des conditions de détention n’a jamais été qu’un « idéal-type » porté par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et si « la société carcérale est foncièrement inégalitaire » (p. 738), Jean-Marie Delarue estime cependant que les politiques pénales, longtemps guidées par cet idéal d’uniformité, connaissent aujourd’hui une tendance inverse à travers la diversification des régimes de détention au nom de « l’individualisation de la peine ». Cette tendance se traduit spatialement à travers la multiplication de nouveaux types de « quartiers » (« arrivants », « sortants », « courtes peines », « peines aménagées », « pour détenus violents », etc.) qui se superposent à la traditionnelle discrimination selon le sexe et l’âge. La prison contemporaine continue donc d’affiner cet « art des répartitions » propre, selon Michel Foucault, aux dispositifs disciplinaires qui émergent à la fin du XVIIIe siècle.
Si l’ouvrage remplit le contrat fixé par l’auteur, il soulève aussi quelques interrogations pour le lecteur, notamment pour le chercheur en sciences sociales. En effet, le statut de l’ouvrage pose question, étant donnée la manière dont l’auteur se définit. Jean-Marie Delarue le présente en introduction comme une « ethnographie de la prison » et décrit son approche comme une « observation participante », se référant à Bronislaw Malinowski et ses Argonautes du Pacifique occidental (1922). Dans quelle mesure la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est-elle conciliable avec cette ambition ethnographique ? L’enquête de terrain en anthropologie suppose un « savoir-faire » qui conduit notamment à expliciter pour le lecteur la « posture » du chercheur (Olivier de Sardan, 1995), ce que l’auteur n’entreprend pas réellement ici. Si le lecteur comprend que le contrôle général des lieux de privation de liberté repose sur une équipe de contrôleurs qui tous n’opèrent pas en même temps, il ne sait jamais qui sont ces contrôleurs et, plus important, quels rapports ils entretiennent avec l’administration qu’ils ont la charge de contrôler (pour une analyse du contrôle général des lieux de privation de liberté, le lecteur pourra se référer à un article de Nicolas Fischer publié en 2016). Ce positionnement interroge d’autant plus que, dans la suite de l’introduction, l’auteur reconnaît que « le contrôle général ne saurait prétendre à une qualité scientifique » (p. 32). Pourquoi dès lors avoir choisi de revendiquer ce positionnement d’ethnographe ? Qu’apporte-t-il de plus au témoignage de premier plan d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
On pourra enfin regretter que le livre soit exclusivement centré sur la prison alors que la mission du Contrôleur général s’étend à bien d’autres lieux de privation de liberté : établissements de santé (locaux de garde à vue, dépôts des tribunaux, locaux de rétention douanière…). L’ouvrage ne s’autorise que quelques incursions en dehors de la détention proprement dite en évoquant à quelques reprises la semi-liberté. La fonction de Contrôleur général – qui plus est pour celui qui l’a inaugurée – aurait fourni une position idéale pour discuter des contours de cet objet juridique particulier qu’est la privation de liberté en faisant dialoguer les différentes situations dans lesquelles elle survient.
More