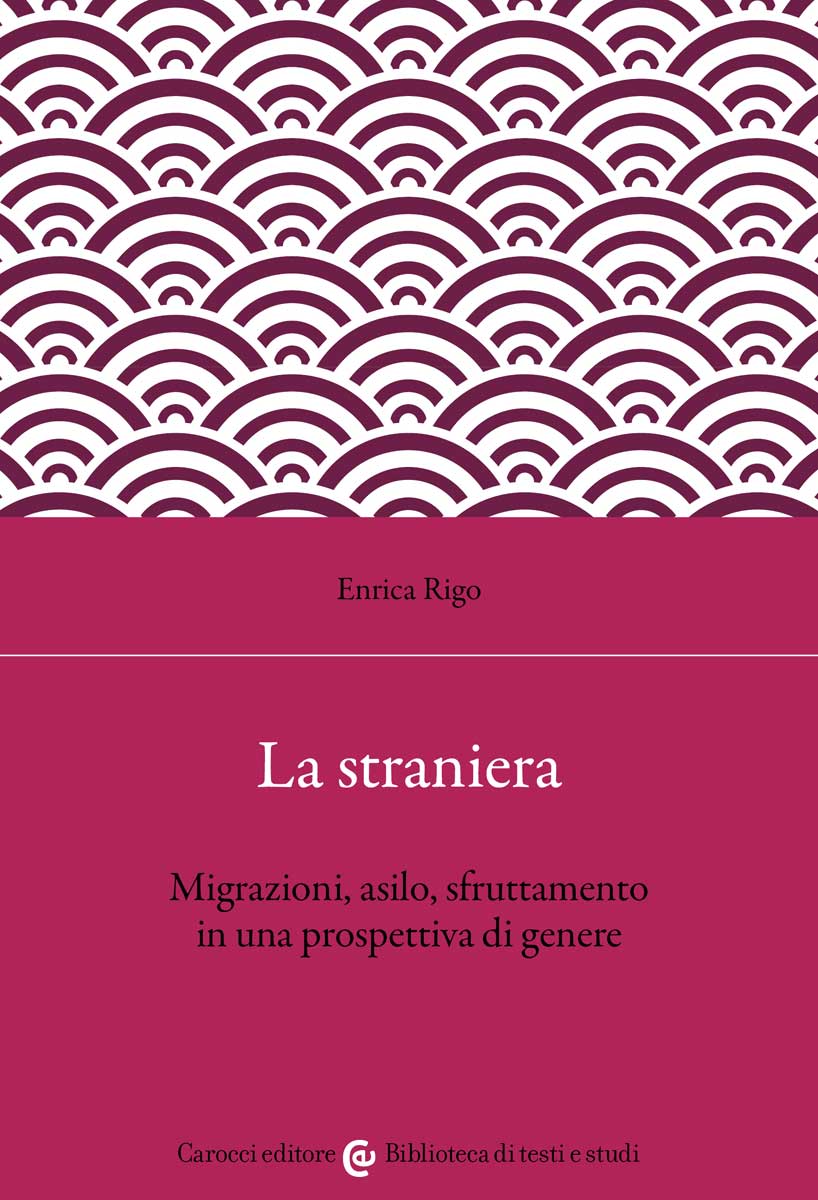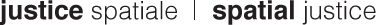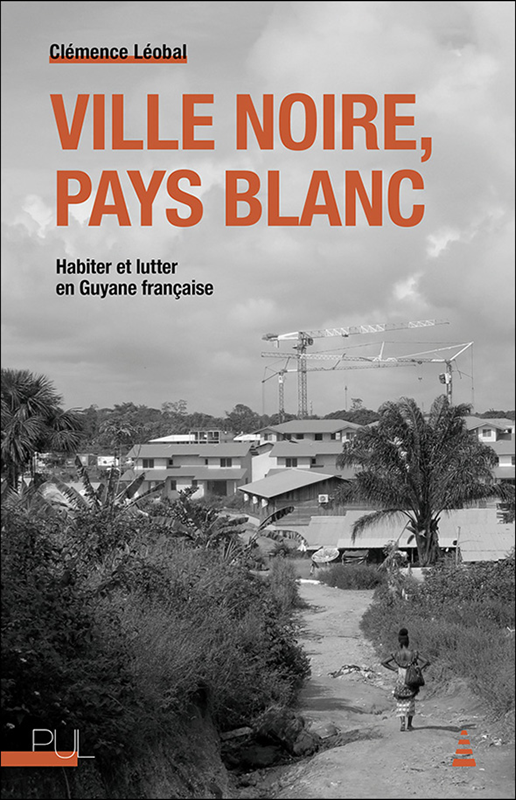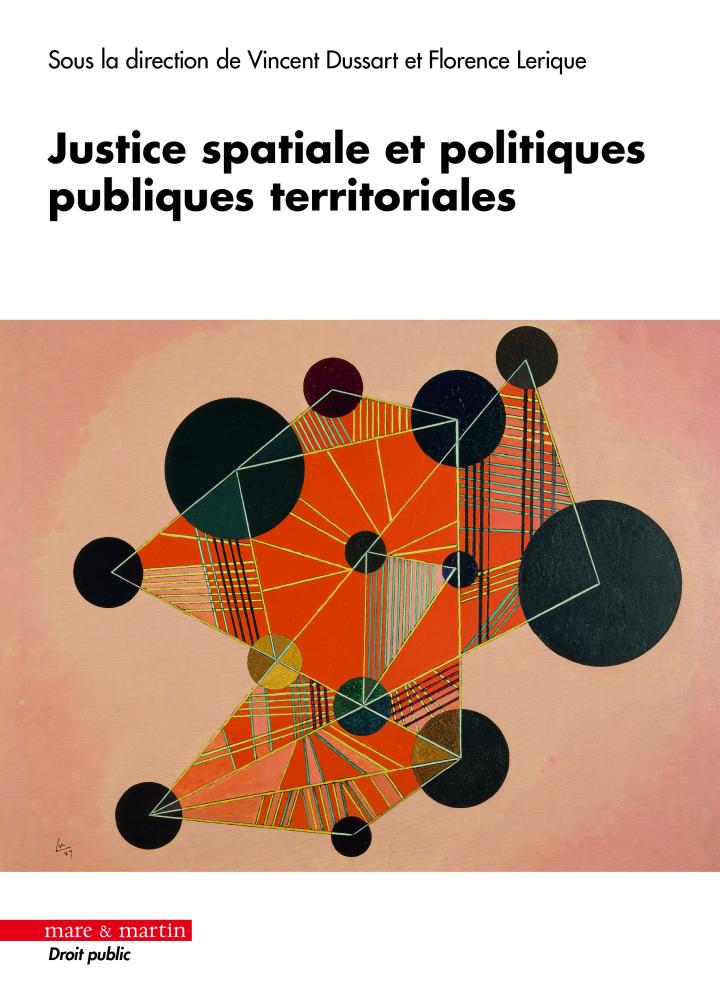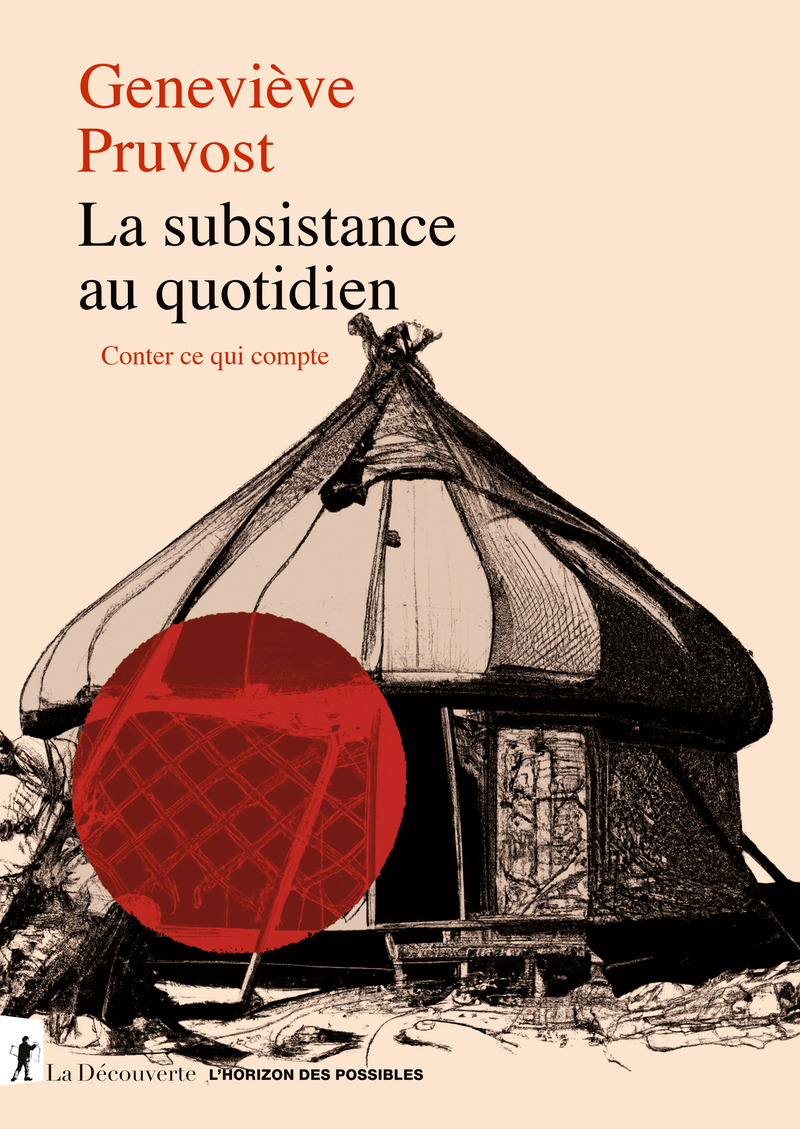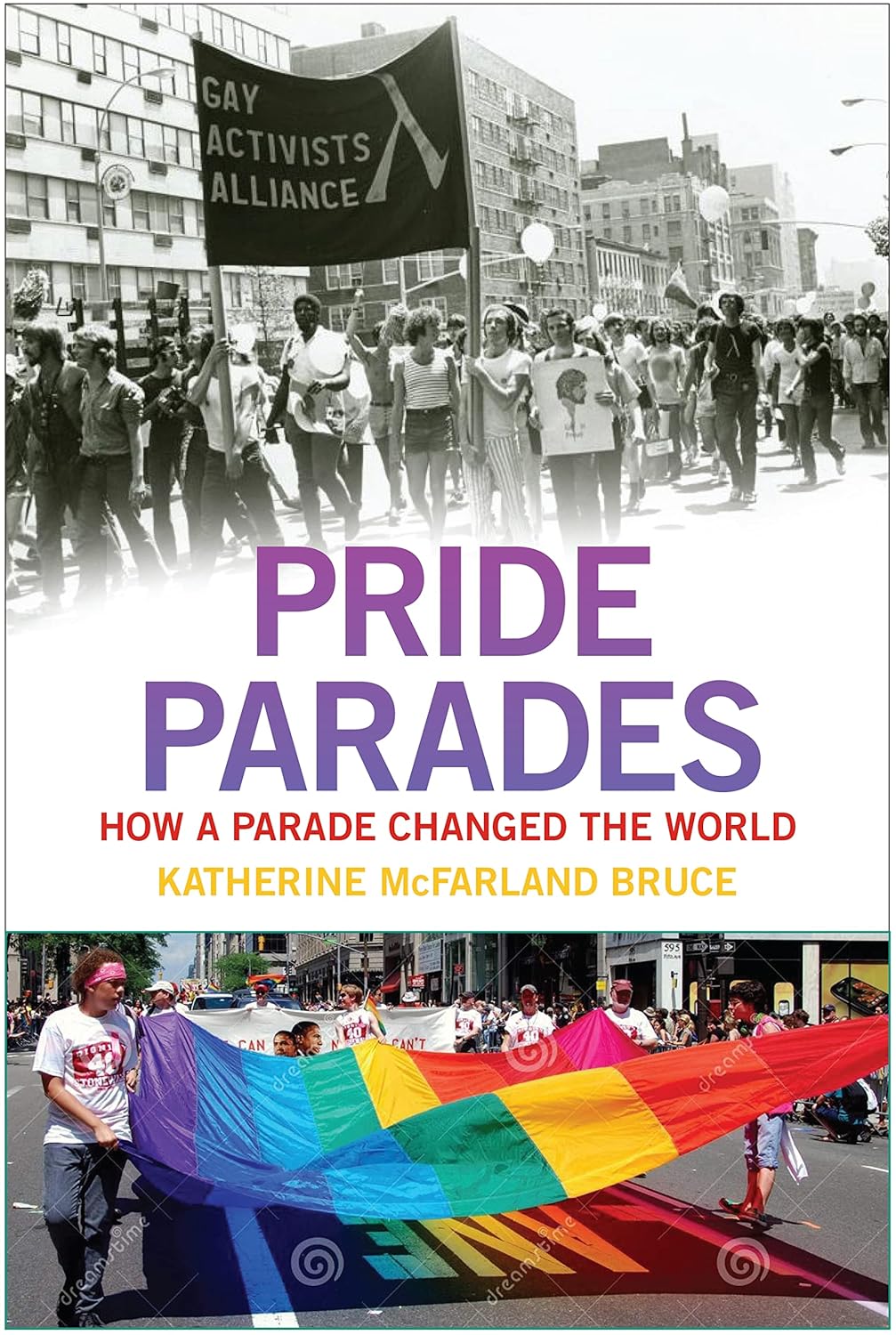Avec ce livre, Katherine McFarland Bruce projette de raconter une histoire des marches des fiertés aux États-Unis en insistant sur les processus par lesquelles ce type d’action s’est consolidé, voire imposé, dans le répertoire des modes d’action des mobilisations des minorités de genres et sexuelles jusqu’à aujourd’hui. Pour réaliser cette étude, l’autrice s’est appuyée sur une méthodologie mixte qui articule des observations menées lors de six marches des fiertés dans différentes villes des États-Unis et des entretiens avec des participant·e·s de ces évènements. Ces cinquante entretiens sont complétés d’ailleurs par des sondages qui ont été effectués par des assistant·e·s de recherche de l’autrice. Certaines personnes sondées lors des marches ont en outre pu être ensuite recontactées par l’autrice. Afin d’appuyer la dimension historique de sa recherche, cette dernière a rencontré onze participant·e·s de la première marche de New York, en 1970, et s’est aussi intéressée aux reportages, produits entre juin 1969 et août 1975, d’un périodique gay, actuellement toujours publié, The Advocate.
Les ressorts sociaux historiques de la fierté queer
Dans le premier chapitre du livre, l’autrice s’intéresse aux origines des marches des fiertés aux États-Unis et, plus précisément, à leur genèse dans le cadre d’un événement particulier, les émeutes de Stonewall. Ces émeutes sont régulièrement présentées, tant par les groupes mobilisés que par des chercheurs et chercheuses, comme l’acte fondateur du mouvement des minorités de genres et sexuelles, point de départ de leur inexorable marche des minorités de genres et sexuelles vers l’émancipation (Fassin, 1998), aux États-Unis mais pas seulement. Afin de déconstruire ce que l’on peut considérer comme un mythe militant, sans pour autant rompre avec l’engouement qui existe autour d’elles, l’autrice s’engage dans un nécessaire rappel des mobilisations qui précèdent les premières marches, ainsi que de leurs caractéristiques. Ce rappel et celui, plus succinct, du cadrage de la cause et du répertoire d’action employé permettent de souligner les changements radicaux qui ont lieu après Stonewall en ce qui concerne la participation des minorités de genres et sexuelles dans la sphère publique, sans invisibiliser les mobilisations passées comme cela a pu être le cas dans des recherches antérieures.
Dès les années 1950, aux États-Unis, comme dans d’autres pays, par exemple en Europe (Rupp, 2011 ; 2014), les minorités de genres et sexuelles, essentiellement des homosexuels masculins, s’organisent politiquement sur la base d’une identité sexuelle collective distincte de l’hétérosexualité (Quéré, 2022 ; Prearo, 2014). Ces groupes sont alors pensés comme des espaces de rencontre. Le partage, la mise en commun des expériences minoritaires communes, est considéré comme un levier indispensable de la politisation collective des minorités sexuelles. Se forge dans ces organisations une conscience commune, politisée et positive de l’homosexualité. Les travaux sur les mobilisations des minorités de genres et sexuelles décrivent systématiquement les pratiques contestataires de ces organisations, Mattachine Society, pour les homosexuels masculins, et Daughters of Bilitis pour les lesbiennes, comme s’inscrivant dans une stratégie assimilationniste. Les activités militantes de ces associations tendaient à minimiser les différences entre homosexuel·le·s et hétérosexuel·le·s afin de mettre en avant leurs similitudes et de prouver que les homosexuel·le·s étaient des citoyen·ne·s responsables. Katherine McFarland Bruce partage ces analyses, qu’elle rappelle d’ailleurs en s’appuyant sur un exemple de mobilisation de l’un de ces groupes. Lors de la fête nationale, le 4 juillet, entre 1965 et 1969, un groupe de militant·e·s homosexuel·le·s de Philadelphie se réunissait pour une marche solennelle et silencieuse devant le Capitole de l’État. Ce défilé, l’Annual Reminder, était l’occasion pour ces militant·e·s de réclamer un traitement égalitaire des minorités de genres et sexuelles en contestant les comportements discriminatoires, de l’État et de ses institutions. La participation à ces défilés était conditionnée au respect d’un code vestimentaire strict, les hommes portaient des chemises avec des cravates, tandis que les femmes, elles, étaient vêtues de robes qui descendaient au-dessous du genou. Les représentations données à voir lors de ces défilés sont analysées par l’autrice, et d’autres avant elle, comme le signe de l’acceptation, de l’accommodement de ce groupe des normes sociales dominantes qui constituent l’homosexualité en stigmate. S’il est aisé d’y voir un accommodement, cette lecture ne satisfait toutefois pas d’autres auteurs et autrices dont l’historien Mark Meeker (2001), selon qui il est important d’inscrire ces registres d’actions dans le contexte social et politique dans lequel ces organisations émergent, afin de considérer ses effets sur ces dernières. Avec ce niveau de lecture, on peut au contraire voir dans ces stratégies une performance indispensable pour se protéger des sanctions politiques et continuer la nécessaire politisation collective que ces organisations permettaient. Le masque de la respectabilité cachait en réalité des activités qui contestaient l’ordre social tel qu’il était établi.
Si la politisation des minorités sexuelles et de genres s’effectuait en partie dans ces organisations, d’autres espaces de rencontres ont aussi permis l’affirmation d’une identité, d’une culture homosexuelle distincte. Le récit des émeutes de Stonewall, et des marches commémoratives qui suivirent, est certes très connu, mais l’articulation de ce récit avec la culture érotisée qui s’est développée dans les bars gay de l’époque est, elle, relativement ignorée. Pour l’historien Georges Chauncey (1998) cité par Katherine McFarland Bruce à plusieurs reprises, les bars new-yorkais abritaient une culture homosexuelle originale, fortement sexualisée et érotisée. Les ressorts de cette culture, et de manière générale la constitution d’un sentiment de groupe chez les minorités sexuelles et de genres fréquentant ces lieux sont les conséquences directes de la surveillance accrue à laquelle étaient soumises ces minorités à cette époque. Chancey a montré que cette surveillance a progressivement conduit à la réduction du nombre d’établissements acceptant de servir les homosexuels à l’échelle de la ville, ainsi qu’à la spécialisation de certains dans ce public. Alors que les homosexuel·le·s fréquentaient des établissements mixtes du point de vue de la sexualité des client·e·s, dans lesquels iels étaient d’ailleurs soumis·e·s au contrôle social d’un tenancier craintif des sanctions, iels fréquentent maintenant des établissements exclusivement gay au sein desquels leurs comportements et l’expression de leur orientation sexuelle ne sont l’objet d’aucun contrôle social. Les émeutes de Stonewall s’inscrivent donc dans ce contexte particulier, autour de cette identité et culture homosexuelle singulière sur laquelle l’autrice insiste peu, voire pas du tout, alors même que son importance est constatée et avérée (March, 2017). Le défi lancé aux autorités publiques par les homosexuel·les de Stonewall ne peut s’expliquer sans considérer ainsi les effets socialisateurs de la configuration commerciale locale. C’est cette culture, cette identité homosexuelle originale, qui s’est formée dans les bars, et qui se distingue de celle des groupes homophiles de l’époque, qui animent et qu’engagent les émeutiers lors de ces jours de 1969.
Les émeutes de Stonewall, l’inauguration d’un nouveau cycle de mobilisations aux États-Unis ?
L’autrice, à l’instar d’autres chercheurs et chercheuses avant elle, considère que les émeutes de Stonewall inaugurent un nouveau cycle de militantisme pour les minorités de genres et sexuelles aux États-Unis. Ce dernier est marqué par l’entrée dans la sphère publique de nouveaux groupes militants, tels que le Gay Libération Front (GLH) à New York. Ceux-ci ont interprété les émeutes de Stonewall comme le signe d’un désir d’actions plus radicales, qui iraient plus loin que les revendications des groupes homophiles dont les victoires, certes réjouissantes, étaient encore trop peu nombreuses et avaient lieu beaucoup trop lentement. Les cadrages de la cause effectués par ces groupes militants sont directement liés aux dispositions issues de leurs socialisations. Ces militant·e·s sont marqué·e·s, d’une part, par cette culture homosexuelle des bars et, d’autre part, iels sont aussi imprégné·e·s de l’idéologie de la nouvelle gauche américaine. Celle-ci se distingue des autres formations politiques par son attachement à l’épanouissement personnel et par l’abandon d’un horizon déterminé uniquement par la lutte des classes et la révolution. Ces militant·e·s n’entendaient alors céder à aucune forme de normalisation, et revendiquer au contraire l’homosexualité dans toute sa dimension sexuelle en faisant le déploiement théâtral de l’érotisme et du désir homosexuels. Plutôt que de lutter pour atténuer la marginalisation de l’homosexualité, celle-ci était vivement revendiquée et interprétée comme la situation à partir de laquelle inventer et proposer un nouvel ordre social. L’égalité avec les hétérosexuel·le·s n’était pas revendiquée, les groupes mobilisés considérant au contraire que les hétérosexuel·le·s étaient elles et eux-mêmes enfermé·e·s dans un carcan juridique et moral qui les empêchaient d’exprimer le plein potentiel de leur désir. Ces groupes s’organisaient donc contre les différents cadres qui produisent l’homosexualité en stigmate, mais qui régissent l’expression des désirs sexuels, quels qu’ils soient, en des formes convenables. Dans cette logique, si les désirs et les comportements sexuels homoérotiques sont la source de la stigmatisation et de l’exclusion, ceux-là doivent se muer en armes, être exacerbés afin de saper l’ordre social. Cet ordre qui produit la condition des minorités de genres et sexuelles et qui les a progressivement enfermées dans un placard ne se combat alors plus par l’emprunt de représentations sociales normatives, mais par la fière démonstration du désir homosexuel. Un des slogans contre la guerre du Vietnam donne un exemple concret de ce retournement symbolique. Les militants homosexuels du GLH avaient écrit sur leurs t-shirts « Suck cock to beat the draft », soit en français : « Pour vous faire réformer, sucez des bites ». Le comportement sexuel « déviant » est ainsi un instrument pour ruiner la conscription (Marche, 2017).
Cette nouvelle dynamique militante, dont l’autrice décrit bien les ressorts dans les deux premiers chapitres du livre, prend corps, dès 1970, lors des marches commémoratives des émeutes de Stonewall. Les marches cristallisent les volontés de contestation d’un ordre social et politique qui condamne les minorités de genres et sexuelles. Si ces marches se distinguent des actions contestataires des organisations homophiles, celles-ci sont aussi différentes des formes de protestation traditionnelle, ce qui les rend d’ailleurs, selon l’autrice, difficilement appréhendables pour les chercheurs et chercheuses en sociologie des mobilisations, car elles ne correspondent pas aux grilles d’analyses classiques de ce champ disciplinaire. À l’inverse des mobilisations habituellement analysées, les marches n’appellent pas à des changements législatifs et politiques particuliers. L’État n’est pas la cible unique ni la cible prioritaire. Les expériences minoritaires sont affectées par d’autres structures de régulations sociales sur lesquelles les prises de l’État sont plus faibles, et sur lesquelles des avancées législatives n’auraient aucun effet, tant l’homosexualité y est enracinée comme une déviance. Ces changements de cible s’incarnent d’ailleurs dans les stratégies d’occupation de l’espace public qui sont mises en place. Les défilés ne passent pas devant des bâtiments institutionnels. Ces choix, qui se distinguent de ceux effectués par les militant·e·s homophiles qui se réunissaient devant le Capitole de l’État de Pennsylvanie, marquent matériellement cette nouvelle stratégie. Les marches se distinguent également par la manière dont elles sont organisées, gérées, dirigées. Les manifestations politiques plus traditionnelles sont des espaces fortement hiérarchisés pour Katherine McFarland Bruce. Les mots d’ordre sont établis et diffusés selon une logique descendante, ils sont le fait de groupes restreints dont l’autorité sur la marche est totale. Les organisateur·rice·s des marches des fiertés fournissent un cadre dans lequel celles-ci se réalisent et qui est investi par des groupes divers qui s’organisent et se structurent selon leur propre mot d’ordre. Ces événements sont donc marqués d’une plus forte diversité dans les mots d’ordre du fait d’un cadre qui est construit de manière à laisser s’exprimer la diversité des expériences minoritaires et des revendications associées. Pour les organisateur·rice·s de ces premières marches, l’accent est mis sur l’accès collectif à l’événement et à la sphère publique. Ces organisateur·rice·s, qui disposaient d’ailleurs d’expériences militantes antérieures et qui avaient conscience que la participation à des manifestations repose sur des dispositions à l’engagement inégalement réparties, ont ainsi élaboré un mode d’action innovant devant permettre une large participation des minorités de genres et sexuelles. La forme que prennent les marches après Stonewall s’appuie donc sur l’articulation d’une problématisation nouvelle des expériences minoritaires et sur la stratégie de maximiser la participation à ces actions. Si les défilés organisés à New York, à Los Angeles, et à Chicago avaient en commun d’incarner ce nouveau cycle de mobilisation marqué par la célébration sans compromis du désir et de la sexualité homosexuelle, des différences persistent entre eux. Des différences dont les ressorts se situent dans les positions sociales des organisateur·rice·s, ainsi que dans leurs trajectoires militantes. L’autrice explique en effet que la marche de New York est dirigée par des personnes socialisé·e·s à l’engagement et qui s’inspirent de leurs expériences passées. À Los Angeles, en revanche, la marche est investie principalement par des artistes qui ne bénéficiaient pas des mêmes expériences, et qui ont donc accentué la dimension festive de la marche.
La marche des fiertés, consolidation, circulation
Après avoir présenté les ressorts sociohistoriques des marches des fiertés aux États-Unis, l’autrice s’intéresse, dans le chapitre II, à leur structuration en un modèle de mobilisation, ainsi qu’à leur circulation dans d’autres contextes géographiques. Le succès des premières marches a confirmé l’ambition de leurs organisateur·rice·s de les inscrire dans la durée. Les marches commémoratives de 1970 font sortir cette culture fortement sexualisée et érotisée des bars où elle s’était développée et où elle avait été contenue. L’ampleur prise par les marches ainsi que leur investissement par d’autres minorités de genres et sexuelles, extérieure à cette culture homosexuelle des bars, vont susciter de nombreux débats sur l’orientation que devraient prendre les futures éditions. Alors qu’elles étaient pensées comme un moyen de présenter l’unité des minorités de genres et sexuelles, dans les comités d’organisation de celles-ci se cristallisaient des divisions profondes entre les différentes identités homosexuel·le·s. Katherine McFarland Bruce identifie trois sujets de débats qui ont animé les premiers comités d’organisation et qui continuent d’ailleurs, dans une certaine mesure, d’animer ceux des marches contemporaines. Les organisateur·rice·s se sont opposé·e·s en ce qui concerne le caractère sexualisé, érotisé des marches. L’expression libre de la sexualité, dans sa dimension physique, est au cœur de la socialisation des participant·e·s des premières marches, mais cette socialisation s’oppose à celles des autres parties prenantes qui promeuvent, quant à elles, des représentations dites plus « respectables », à l’instar de celles qui étaient mises en avant par les organisations homophiles. Performer la respectabilité est alors présenté comme une stratégie, essentiellement afin d’obtenir de nouveaux droits. Selon l’autrice, les partisan·ne·s de ces représentations peuvent être regroupé·e·s dans une catégorie qu’elle nomme « militant·e·s pour les droits des homosexuel·le·s ». Leur but n’est pas d’ébranler les fondements des représentations sociales des homosexuel·le·s, c’est-à-dire l’ordre social, mais de convaincre de l’inoffensivité d’une minorité dont on met avant l’humanité universelle. Ces partisan·ne·s promeuvent une intégration positive des minorités genres et sexuelles dans l’ordre social tel qu’il est établi, dont il est demandé des évolutions discrètes, permises d’ailleurs par l’alliance avec certaines institutions de cet ordre social, l’État et les Églises. On le comprend ici, ces débats de représentations sont le reflet d’oppositions plus profondes qui concernent le rapport à l’ordre social. Pour les partisan·ne·s de représentations sexualisées et érotisées, ce qui est donné à voir lors des marches est inscrit dans un rapport critique par rapport à l’ordre social. La dissidence sexuelle est revendiquée, et c’est à partir de celle-ci qu’un autre ordre social est proposé. Pour l’autrice, s’opposent alors une visibilité éducative et qui s’attache à faire évoluer les représentations des minorités de genres et sexuelles dans les esprits et une visibilité critique sans aucune compromission et sans aucune alliance avec les institutions de l’ordre social existant. Ces groupes, dont le poids était inégal selon les contextes, ont réussi à faire valoir différemment leurs intérêts à partir de jeux d’alliance complexes et ont pu parfois affecter de manière significative certaines marches. C’est le cas de celle de Los Angeles, en 1972, lors de laquelle un nombre important de propriétaires de bars firent pression pour que les certains comportements soient proscrits pendant le défilé, et retirèrent leurs soutiens financiers, face au refus des orgnisateur·ice·s, ce qui en altéra l’ampleur. Si ces luttes intestines ont affecté de manière négative certaines marches, la plupart du temps, selon l’autrice, celles-ci se sont soldées par des marches plus dynamiques qui ont réussi à attirer de nombreux·ses participant·e·s. Un autre débat qui persiste encore aujourd’hui concerne le caractère festif des marches. Les membres socialisé·e·s à l’action collective, et pour qui les marches ne s’inscrivent pas dans les représentations intériorisées de ce qu’est une action contestatrice, craignent que la dimension festive de la marche dilue et invisibilise les messages litigieux formulés à cette occasion. Cette crainte porte sur la manière dont les personnes qui assisteraient à ces événements, c’est-à-dire le public, percevraient les marches et se représenteraient les expériences des minorités de genres et sexuelles. En d’autres mots, celles et ceux qui critiquent le caractère festif des marches ont peur que le public ne se représente les minorités de genres et sexuelles qu’à travers la liesse et ne voient pas les difficultés qui pèsent sur le quotidien des minorités sexuelles. Parmi les participant·e·s critiques sur ce point se trouvent notamment de nombreuses femmes lesbiennes. La position des femmes lesbiennes dans l’espace social est le fait de rapports de pouvoirs imbriqués qui portent sur la sexualité, mais aussi sur l’identité de genre, ce qui produit des expériences minoritaires différentes. Celles-ci sont également marquées de socialisations différenciées, qui se réalisent dans des structures distinctes, et qui conduisent à des revendications propres aux femmes lesbiennes. En raison de leurs expériences minoritaires singulières, les femmes lesbiennes poussaient pour que les marches des fiertés adoptent un ton et des messages sérieux, en même temps qu’elles intégraient leurs revendications d’égalité salariale et de lutte contre le sexisme à leur lutte. Pour Katherine McFarland Bruce, les femmes lesbiennes ont aussi amené dans les comités d’organisation des débats concernant la place des bars et autres établissements commerciaux dans les défilés. Selon elle, la participation de ces établissements est contraire aux principes des marches, car ils font partie de la structure de pouvoir dont les minorités de genres et sexuelles doivent se libérer. Ces établissements dégagent des bénéfices sur le besoin des minorités de genres et sexuelles de se rencontrer et de se sentir libres. S’ils offrent un espace de soulagement aux discriminations quotidiennes, ils participent néanmoins à privatiser et à restreindre l’expression libérée de l’orientation sexuelle à ces seuls lieux. De plus, cette commercialisation, cette privatisation de l’orientation sexuelle, ne se fait pas sans discriminations, discriminations que subissent les femmes lesbiennes dont on refuse l’accès à ces établissements essentiellement masculins, mais aussi à d’autres hommes homosexuels qui ne répondent pas aux normes corporelles qui organisent les interactions sociales de ces lieux. Les débats sur la représentation, le ton et la gravité de la marche ont donc émergé avec la croissance de celle-ci. Ils en ont affecté certaines éditions, mais, pour l’autrice, un modèle définitif a malgré tout émergé de ces débats, et la marche des fiertés s’est imposée comme la célébration annuelle d’une minorité unie dans la diversité. L’établissement de ce format a lieu dans un moment d’éclatement des mobilisations en faveur des minorités de genres et sexuelles. Si le champ de ces mobilisations est marqué d’une certaine effervescence à la fin des années 1970, certain·e·s chercheurs et chercheuses montrent aussi que cette effervescence est le fait d’une délégation progressive des initiatives politiques à des associations nationales qui se spécialisent dans certains domaines comme l’éducation, la santé, le droit (March, 2017). Dans le même temps, nombre d’établissements commerciaux destinés aux minorités de genres et sexuelles se créent un peu partout aux États-Unis, et répondent quant à eux à une demande d’ordre sexuel. D’un côté, l’institutionnalisation de ces associations nationales qui accèdent à nombre de leurs revendications conduit à l’abandon, par celle-ci, de la sexualité au profit du politique. Et de l’autre côté dans les bars, et les établissements commerciaux, les minorités de genres et sexuelles déchargées de responsabilités politiques favorisent la sexualité au détriment de la politique. Cet éclatement symétrique, comparable à celui observé avant les émeutes de Stonewall, se remarque particulièrement lors des marches des fiertés. De plus en plus, elles constituent le point d’orgue de semaines de mobilisations. La semaine qui précède la marche est l’occasion d’organiser différentes rencontres, des ateliers militants, des manifestations ciblées plus directement contre l’État et contre d’autres organisations. Ces événements permettent l’expression de toutes les minorités de genres et sexuelles, et de faire de la marche un moment de célébration libérée des conflits présentés plus haut.
Les variations contextuelles de la fierté ?
Depuis les premières marches de Los Angeles et New York, d’autres défilés se sont développés dans de nombreuses autres villes des États-Unis. Dans le chapitre III, l’autrice révèle que, quel que soit le contexte géographique, les organisateur·ice·s de ces marches sont confronté·e·s, comme leurs prédécesseurs, à des conflits similaires au sujet des stratégies de représentations à adopter. Dans le chapitre IV, elle montre néanmoins que ces questions se posent diversement selon les contextes géographiques. Les différences qu’elle observe entre les marches auxquelles elle a assisté l’amènent à s’interroger sur les effets des contextes locaux dans les formes prises par les défilés des fiertés. Ces disparités sont interprétées comme les conséquences de contraintes spécifiques qui pèseraient sur les minorités de genres et sexuelles dans certains contextes. Pour le dire autrement, si ces dernières sont confrontées à un ordre social qui définit l’hétérosexualité comme modèle unique d’interaction sexuelle entre les hommes et les femmes, cet ordre social s’exprime de manières différentes selon les contextes. Dès lors, les sexualités non hétérosexuelles prennent des significations sociales elles-mêmes distinctes. Les ressorts de ces variations ne sont pas clairement identifiés par l’autrice. En prenant l’exemple des marches de Fargo (Dakota), de Salt Lake City (Utah) et, dans une moindre mesure, de la marche d’Atlanta (Géorgie), elle explique que, dans ces États, les minorités de genres et sexuelles sont confrontées à la prégnance forte des églises et de certaines congrégations dont les discours condamnent fermement les minorités de genres et sexuelles. Conscient·e·s des particularités locales, les participant·e·s ont adapté les messages de la marche, ainsi que la manière de les transmettre. Pour cela, iels ont adopté des stratégies qui correspondent aux représentations de genres traditionnelles, et cela afin de mettre en avant leurs ressemblances aux populations hétérosexuelles. De plus, iels se sont appuyé·e·s aussi sur le soutien de communautés religieuses locales qui ont défilé lors des marches. À l’opposé de ces exemples, Katherine McFarland Bruce prend celui des villes de Los Angeles, de New York et de San Francisco, qu’elle décrit comme des contextes sociaux plus favorables aux minorités de genres et sexuelles, ce qui permet lors des marches des fiertés de rendre visibles des expressions fortement sexualisées, érotisées et transgressives. Les contextes sociaux locaux influencent donc les messages, ainsi que la manière dont ceux-ci sont communiqués, mais ils n’expliquent pas à eux seuls ces changements. L’autrice insiste en effet sur les variations contextuelles au niveau des ressources communautaires des lieux commerciaux, ou associatifs, qui sont autant d’espaces qui permettent la rencontre des minorités de genres et sexuelles locales, ainsi que leur politisation. Elle l’a montré à différentes reprises, ces ressources communautaires sont aussi indispensables pour supporter les coûts de ces marches. Afin de compenser la faiblesse des ressources communautaires locales, leurs organisateur·ice·s peuvent également se tourner vers des sponsors privés. Il faut là également interroger les effets sur les marches de ces sponsors privés et les conditions qui sont les leurs pour leur participation financière à l’événement.
Dans les chapitres IV et V, l’autrice place finalement les marches observées dans un continuum en fonction de leurs aspects plus ou moins contestataire, festif et transgressif. L’attention portée par l’autrice aux effets des contextes locaux s’avère particulièrement pertinente pour les géographes. Pour autant, certaines interrogations persistent. Les marches de Fargo, de Salt Lake City et d’Atlanta ne sont pas interrogées pour ce qu’elles sont en elles-mêmes, elles le sont avec les autres marches observées. Les études comparatives sont intéressantes, mais l’analyse de l’autrice trouve sa limite lorsque les marches dans ces contextes sont présentées d’une manière normative.
Cette lecture tend à reproduire une identité homosexuelle essentialisée au détriment d’une analyse des formes diverses, originales et locales d’expression de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Ce que Katherine McFarland Bruce observe à Fargo, à Salt Lake City et à Atlanta est interprété comme des expressions contraintes de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, et non comme des expressions choisies. Elle tend d’ailleurs à considérer que si les participant·e·s à ces marches s’étaient retrouvé·e·s dans un contexte plus favorable, les expressions de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre auraient été différentes, il faut entendre, ici, plus transgressives. Si la marche de Fargo telle qu’elle est décrite laisse voir un événement plus ordinaire comparé aux défilés grandioses de New York et de Los Angeles, elle est en elle-même, en s’inscrivant dans un contexte plus difficile, politiquement transgressive. Des pratiques perçues comme banales dans un contexte donné peuvent être, dans un autre, considérées comme fortement transgressives. L’analyse de l’autrice tend à accorder une place démesurée à l’espace, lequel est présenté comme agissant de manière autonome sur le social. Les expressions de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre qui sont observées dans un contexte gagneraient à être analysées pour ce qu’elles sont, et n’ont pas à être évaluées à l’aune d’autres expressions observées dans d’autres contextes. Une telle démarche éviterait d’ailleurs de fixer la liberté sexuelle dans le centre des grandes villes et l’hostilité ainsi que le rejet dans les espaces périphériques et ruraux. Les expressions sexuelles et de genres fortement transgressives apparaissent restreintes, dans l’ouvrage, aux espaces métropolitains, au sein desquels les ressources sont supposées être habilitantes et autonomisantes, or l’accès à celles-ci reste inégalement réparti en fonction des appartenances de classes, de races et de genres des populations métropolitaines. L’autrice montre d’ailleurs, dans le chapitre V, avec l’exemple des Black Gay Pride, ou de la Trans March, que les minorités de genres et sexuelles sont affectées par d’autres rapports de pouvoir qui traversent cette communauté au sein même de ces espaces communautaires-ressources. Elle n’intègre malheureusement pas ces défilés à son analyse, ces exemples sont développés de manière trop rapide, ce qui ne permet pas de comprendre les ressorts concrets de leur émergence, ni même les effets que ces marches ont, ou n’ont pas, sur les marches traditionnelles qu’elle étudie.
Conclusion
Le livre de Katherine McFarland Bruce est un précieux outil qui permet aux lecteurs et lectrices de s’initier à un mode d’action devenu incontournable des mobilisations en faveur des minorités de genres et sexuelles. Malgré l’intérêt de l’ouvrage, certaines interrogations persistent notamment quant à la façon dont le modèle de la marche des fiertés s’est diffusé aux États-Unis. La circulation de ce modèle peut-elle par exemple s’expliquer par celle des minorités de genres et sexuelles elles-mêmes ? Ces minorités socialisées à ce mode d’action seraient-elles tentées de reproduire, dans de nouveaux espaces habités, des mobilisations connues dans le passé ? Enfin, le livre est peut-être aussi une occasion manquée d’interroger la place occupée par les défilés des fiertés dans les grandes villes. De nombreux auteurs ont en effet interrogé l’usage politique des marches des fiertés à des fins de gentrification par exemple. Les marches des fiertés sont, avec d’autres équipements culturels, au cœur des stratégies de certains pouvoirs publics locaux qui souhaitent attirer des populations en recherche de services où consommer, et incarner leur tolérance. Cette cooptation politique et sociale pose dès lors de nouveaux défis pour les organisateur·rice·s des marches qui font face à de nouvelles pressions pour minimiser les représentations qui pourraient faire fuir les populations hétérosexuelles venues consommer les marches des fiertés.
Bibliographie
Chauncey George, 1998, « Gay New York », Actes de la recherche en sciences sociales, 125(1), p. 9‑14.
Fassin Éric, 1998, « Politiques de l’histoire : Gay New York et l’historiographie homosexuelle aux États-Unis », Actes de la recherche en sciences sociales, 125(1), p. 3‑8 (https://doi.org/10.3406/arss.1998.3269).
March Guillaume, 2017, La militance LGBT aux États-Unis. Sexualité et subjectivité, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Meeker Martin, 2001, « Behind the mask of respectability: Reconsidering the Mattachine Society and male homophile practice, 1950s and 1960s », Journal of the History of Sexuality, 10(1), p. 78‑116 (https://www.jstor.org/stable/3704790, consulté le 20/05/2024).
Prearo Massimo, 2014, Le moment politique de l’homosexualité. Mouvements, identités et communautés en France, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Quéré Mathias, 2022, « Quand nos désirs font désordres », une histoire du mouvement homosexuel français de 1974 à 1986, thèse de doctorat, Toulouse 2 (https://www.theses.fr/2022TOU20028, consulté le 20/05/2024).
Rupp Leila J., 2011, « The Persistence of Transnational Organizing: The Case of the Homophile Movement. The American Historical Review », 116(4), 1014‑1039. (https://www.jstor.org/stable/23307877, consulté le 20/05/2024).
Rupp Leila J., 2014, « The European Origins of Transnational Organizing: The International Committee for Sexual Equality », in Phillip M. Ayoub, David Paternotte (éd.), LGBT Activism and the Making of Europe, Palgrave Macmillan UK, p. 29‑49 (https://doi.org/10.1057/9781137391766_2).
More