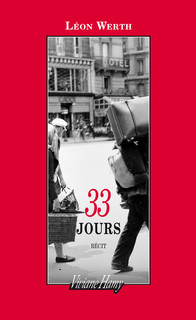
Léon Werth
33 jours
Editions Viviane Hamy, Paris | commenté par : Philippe Gervais-Lambony
Ce livre, ancien déjà, récent pourtant et d’actualité plus que jamais peut-être, a connu une histoire compliquée. Ecrit par Léon Werth (1878-1955) en 1939, à chaud après une errance de trente-trois jours dans une France en plein exode que le livre raconte sous la forme d’un journal. Werth en a remis le manuscrit à son ami Antoine de Saint-Exupéry lorsque celui-ci, à peine démobilisé, est venu lui rendre visite à Saint-Amour dans le Jura où il s’était réfugié. Werth a rencontré Saint-Exupéry en 1931. Ce dernier admire son œuvre d’écrivain et naît de leur rencontre une amitié jamais démentie. Werth, issu d’une famille juive du jura, est un écrivain reconnu, essayiste engagé à gauche, proche du parti communiste mais aussi critique du stalinisme. Ancien combattant de la première guerre mondiale, il est anti-colonialiste dès les années 1920, anti-nazi ensuite. Profondément marqué par son expérience de la guerre il est aussi pacifiste et anti-militariste, libertaire et anti-clérical.
C’est à Saint-Amour, après des discussions avec Werth, que Saint-Exupéry fait le choix de l’exil aux Etats-Unis : c’est là qu’il juge pouvoir être le plus utile. Utile à travailler à convaincre les Etats-Unis d’entrer dans la guerre. Il fut donc convenu entre les deux hommes que Saint Exupéry emporterait le manuscrit de 33 jours et le ferait publier aux Etats-Unis chez son éditeur (Brentano’s). Werth lui demande aussi de rédiger une préface. Mais la publication ne se fait pas, et le manuscrit est égaré par l’éditeur. Il n’est retrouvé qu’au début des années 1990 et sera donc publié pour la première fois aux éditions Viviane Hamy en 1992 et pour la seconde fois chez le même éditeur en 2015 avec cette fois la préface de Saint-Exupéry. Celui-ci l’a en effet bien rédigée, sous le titre de Lettre à un ami. Mais sollicité par les milieux intellectuels new-yorkais et son éditeur, Saint-Exupéry a publié dès 1942 une autre version de ce texte sous le titre de Lettre à un otage. L’otage c’est l’ami, c’est Werth, mais à travers lui l’ensemble des Français restés en France. Au même moment Saint-Exupéry rédige Le petit Prince, il le dédie à Léon Werth : « le meilleur ami que j’ai au monde ».
Tous ces textes ont un point commun : ils traitent de situations d’exil. Exil de Saint-Exupéry qui quitte la France via le Portugal ; exil de Werth qui ne reconnaît plus la France qu’il parcoure ; exil du Petit Prince qui a quitté sa planète et sa rose. Que devient-on quand on est égaré, tel un « enfant prodigue sans maison » (p. V) ? Quand on « commence le vrai voyage qui est hors de soi-même » (p. V) ? Hors de soi-même car l’attache est perdue, il n’y a pas de retour explique Saint-Exupéry dans sa préface. Quand on est exilé, « comment se reconstruire » et « refaire en soi la lourde trame de souvenirs » (p. V) ? C’est cette tentative de reconstruction que racontent les deux auteurs, ce qui suppose de retrouver l’espace perdu, celui que l’on a quitté ou celui que l’on ne reconnaît pas parce que plus rien ne le « polarise » (p. VIII). C’est pour cela que le livre est d’une grande actualité en cette année 2015 : année d’exil dans une France méconnaissable, où les mots réfugiés et migrants sonnent avec tant de force, où l’on parle tant de guerre et où il me semble que beaucoup connaissent le sentiment qu’évoquent Saint-Ex et Werth et qu’ils vivent face à ce qu’ils qualifient d’ « écroulement » (p. 76). La guerre, c’est la perte du lieu, c’est donc l’exil… Albert Camus le redira un peu plus tard dans La Peste dont il dit qu’il est un livre sur la guerre et l’exil.
Le 11 juin 1939, donc, à 9 heures du matin, Léon Werth et son épouse embarquent à bord de leur voiture pour quitter Paris et se rendre dans le village de Saint-Amour dont est originaire Werth et où se trouve sa maison familiale : « notre point fixe entre Jura, Bresse et Basse-Bourgogne » (p. 12). Ils prévoient, comme selon leur habitude, d’atteindre Saint-Amour après 9 heures de voyage. Ils n’y arriveront que 33 jours plus tard, et c’est ce voyage que raconte le livre.
Paris se vide au même moment de sa population qui fuit devant l’avancée de l’armée allemande. Sur les routes les parisiens rencontrent ceux qui fuient aussi du Nord et de l’Est de la France, mais aussi les ruraux du sud du Bassin Parisien qui évacuent leurs villages. Paysans, citadins, voitures et charrettes, méli-mélo, tous s’entassent sur des routes secondaires sur lesquelles ils sont dirigés par une gendarmerie totalement dépassée par les événements. Où vont-ils ? Vers la Loire d’abord, car la rumeur dit que ce sera le nouveau front qui arrêtera l’avancée allemande. Mais au fur à mesure que le temps passe, que l’on avance de quelques kilomètres par jour seulement, que les moteurs chauffent, que l’essence vient à manquer, les « migrants » rencontrent aussi des soldats français qui errent tout autant qu’eux. C’est un sauve-qui-peut général. Et puis, finalement, ils rencontrent les soldats allemands qui remontent vers Paris, sont témoins de quelques escarmouches, mais surtout de l’absence totale de résistance et de l’absence totale d’organisation. Les rumeurs courent de violences et d’exactions, d’actes de bravoure parfois, de défaite en tous cas. La France est envahie et chacun comprend enfin qu’il n’y aura pas de second front, que c’en est fini.
Ce grand désordre soulève bien des questions géographiques parce qu’est narré ici l’histoire d’une expérience spatiale. D’abord, le récit montre comment l’espace dans lequel on est soudain perdu devient étranger au voyageur : « je me sens plus exilé encore. Je n’arrive pas à composer ce ciel et ces bouquets d’arbres » (p. 125). Toutes les notions habituelles sur les distances-temps sont brouillées, on ne sait ni où l’on se trouve ni pour combien de temps. Il faut donc ré-apprendre à se déplacer, à un rythme différent. Fondamentalement, il faut reconstruire les lignes de force de son espace, pour cela il faut des pôles : « une maison de France qui demeure vivante dans le souvenir. (…) Un ami dont on ne sait rien, sinon qu’il est » (p. VIII). Et Werth répond exactement à Saint-Exupéry, ou réciproquement, car il fait lui aussi, à sa manière, l’expérience du désert : « rien ne me lie à ce paysage informe et plat, qui semble disposé au hasard et où le hasard seul m’a conduit » (p. 82). Il songe alors aux lieux où il a laissé « des morceaux de ma vie. Ainsi la maison du cousin Nicot, qui domine la Saône. Comme tout s’y compose bien : le fleuve, la vieille grille, le jardin vénérable, l’accueil et l’hospitalité, le Chardonnay de dix ans, plein comme une noisette, le paravent de 1840, qui me met aussitôt en état de conte de fées. Maison de Saint-Amour, maison du Villars, j’ai pensé à vous comme on pense à un fruit et que l’eau vous vient à la bouche » (p. 82).
C’est l’égarement, la perte complète de repères. Que deviennent ces humains en migration, arrachées à toutes leurs habitudes ? Diverses choses : collaborateurs ou résistants, fuyards égoïste ou camarades solidaires, muets et atones ou bavards, ils se frottent en tous cas les uns aux autres et souvent se révèlent. Leur espace perdu dans un temps qui est comme suspendu, leur être même s’égare, sans plus de point d’accroche, ou se construit. Après des moments de mobilité (très lente, quelques kilomètres par jour), nos voyageurs, qui deviennent des exilés dans leur propre pays, se trouvent bloqués dans des fermes : « emmurés, nous sommes emmurés » (p. 131). De « nomades errants » ils deviennent « nomades stationnant » (p. 147). La première de ces fermes est propriété de riches parisiens qui offrent du champagne aux soldats allemands : « nous sommes dans un pays que nous ne savions pas exister : une France qui accepte la victoire allemande ou s’en réjouit, une France qui ne se sent liée à aucune coutume ou qualité française » (p. 71). La seconde est l’occasion d’une rencontre avec une famille de paysans qui sait au contraire conserver son sang-froid et le respect de soi, qui redonne des repères à la dignité humaine. Est aussi racontée la rencontre l’autre car l’exil est aussi une expérience de l’autre : soldats allemands, leurs corps, qui se lavent torse nus, qui se montrent, respirent la joie du vainqueur et répètent naïvement les paroles de la propagande (expliquant que le véritable ennemi est l’Angleterre qui a provoquée la guerre) qui les trompe eux-aussi. Le journal de Werth est celui d’une succession de rencontres qui presque toutes disent l’incompréhension d’une situation, d’une France devenue autre : « la France a toujours assimilé des nourritures étrangères. Cette assimilation, c’est toute son histoire depuis le XVIème siècle au moins. Mais, depuis 1930, tantôt par admiration, tantôt par épouvante, une partie de la France est en état d’hypnose devant l’Europe brutalisée » (p. 77). Il y a beaucoup de patriotisme chez Werth, mais aucun nationalisme. La France « a cessé de se penser elle-même » (p. 77) constate-t-il simplement, faisant ainsi écho au mots de Saint-Exupéry dans Terres des Hommes dont il transporte avec lui un exemplaire dédicacé. Et finalement la conclusion du livre de Werth pourrait être la dernière phrase de la préface de Saint-Exupéry qui ne voit pas d’issue qui ne serait fondée d’abord sur la relation humaine pour ne pas se perdre (aux deux sens du terme) : « le désert n’est pas là où l’on croit. Le Sahara est plus vivant qu’une capitale, et la ville la plus grouillante se fait déserte si les pôles essentiels de la vie sont désaimantés » (p. IX).

