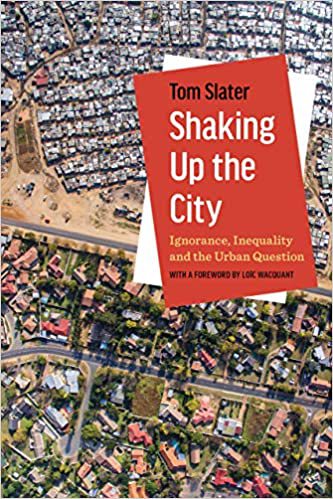
Tom Slater
Shaking up the city: ignorance, inequality, and the urban question
University of California Press, 2021, 258 p. | commenté par : Hadrien Herrault
Après avoir publié de nombreux articles scientifiques de référence sur les transformations contemporaines des politiques urbaines, Tom Slater revient dans ce livre sur la ligne directrice de son travail. Il propose un ouvrage didactique comprenant sept chapitres sur des objets centraux de la recherche urbaine contemporaine : « The Resilience of Neoliberal Urbanism », « Gentrification beyond False Choice Urbanism », « Displacement, Rent Control, and Housing Justice », « Neighborhood Effects as Tautological Urbanism », « The Production and Activation of Territorial Stigma » et « Ghetto Blasting ». L’auteur les étudie avec un cadre théorique ambitieux. Il utilise le concept d’agnotologie de Robert N. Proctor sur la production sociale de l’ignorance. L’objectif de Slater est d’étudier les stratégies d’institutions (think tanks, fondations philanthropiques, centres de recherche, etc.) pour prioriser certains savoirs urbains dans l’agenda politique et en occulter d’autres (p. 21). Il croise le concept d’agnotologie avec celui de pouvoir symbolique de Pierre Bourdieu pour analyser le « pouvoir de constituer le donné par l’énonciation, de faire voir et de faire croire, de confirmer ou de transformer la vision du monde et, par-là, l’action sur le monde, donc le monde » (Bourdieu, 1977, p. 410). Cette double approche conduit Slater à plaider, tout au long du livre, pour une recherche davantage centrée sur la mise au jour des rapports de pouvoir dans la production urbaine, recherche qui permettrait de questionner et de penser les politiques publiques (la « politique publique orientée par la recherche » [« research-driven policy »] par opposition à la « recherche orientée par la politique publique » [« policy-driven research »] [p. 4]).
L’hétéronomie des recherches urbaines
Le premier chapitre est une critique du manque d’autonomie des recherches urbaines contemporaines. Ce dernier s’explique, selon Slater, par l’importance de la recherche par projet, qui entraîne l’augmentation de la place accordée aux financeurs extérieurs à l’université et l’imposition de leurs catégories de pensée (catégories qu’il déconstruit dans les chapitres suivants). L’auteur dénonce ce qu’il nomme « l’hétéronomie de la recherche » : « À première vue, cela peut sembler un obscur jargon académique, mais c’est en réalité assez simple : [l’hétéronomie de la recherche] fait référence au fait que des chercheurs soient restreints dans leurs possibilités de poser leurs propres questions sur l’urbanisation. À la place, ils posent des questions et utilisent des catégories inventées, intensifiées et imposées par diverses institutions qui ont des intérêts à influencer ce qui est hors et dans les priorités de l’agenda urbain » (p. 4)[1]. Les études urbaines anglophones articulent des approches théoriques et méthodologiques variées, bien souvent critiques. Toutefois, l’hétéronomie serait, selon lui, en progression et menacerait ce positionnement critique. Au Royaume-Uni, où travaille l’auteur, la pression croissante sur les universitaires pour obtenir des financements extérieurs entraîne un agenda de recherche dicté par les priorités de l’État et des municipalités. En conséquence, si les décideur·se·s ont tendance à présenter les politiques publiques comme fondées sur des « preuves » scientifiques (« evidence-based decision making »), il s’agit davantage de preuves produites pour justifier des décisions politiques définies en amont du travail de recherche (« decision-based evidence making » ; p. 4).
Le chapitre consacré à la thèse des « effets de quartier » (« neighborhood effects ») est révélateur de la tendance à l’hétéronomie des recherches urbaines. Selon Slater, les études quantitatives analysant dans quelle mesure le lieu d’habitation d’un individu structure ses possibilités d’accès à l’emploi, à la santé ou à la culture sont discutables. Il commence sa démonstration en réalisant la genèse de cette théorie qui propose une analyse causale entre concentration spatiale des classes populaires et pauvreté. La simplicité de cette théorie a participé à son hégémonie dans la recherche et dans la pratique, sous la forme du mot d’ordre de mixité sociale. Son succès s’explique aussi, selon l’auteur, par une vision centrée sur les comportements individuels. Les travaux mobilisant la théorie des effets de quartier se focalisent sur les quartiers pauvres et leurs habitant·e·s, perçus comme créateurs de dysfonctionnements sociaux. Ces individus auraient une supposée culture de la pauvreté et diffuseraient des modèles de comportements « négatifs », appelés « negative role models » dans ces travaux (p. 124). Pour Slater, cette théorie s’oppose aux analyses marxistes sur l’urbanisation du capital proposées notamment par David Harvey. Les chercheur·se·s mobilisant la théorie des effets de quartier délaissent toute analyse structurelle des inégalités en ne posant jamais une question fondamentale : « Pourquoi les gens vivent-ils là où ils vivent dans les villes ? Si le lieu de résidence d’un individu affecte ses chances dans la vie aussi profondément que le pensent les partisans des effets de quartier, il semble crucial de comprendre pourquoi cet individu y vit en premier lieu. Se pose une question connexe : pourquoi y a-t-il tant de différences entre les quartiers les plus riches et les quartiers les plus pauvres ? » (p. 118)[2] Ces chercheur·se·s oublient les logiques capitalistes expliquant les concentrations spatiales de pauvreté. Iels occultent les facteurs structurels, comme la nature excluante du marché du logement et le désinvestissement public dans les quartiers pauvres, pour expliquer les répartitions inégalitaires des groupes de population dans la ville (p. 124). Ainsi, la théorie des effets de quartier est problématique, selon l’auteur, car la concentration de pauvreté est érigée elle-même en problème, et non comme l’expression des inégalités et des discriminations.
Avec cet exemple et un autre de soi-disant « villes résilientes », Slater questionne les usages des savoirs produits par des chercheur·se·s en études urbaines. En étant mobilisée par des décideur·se·s, public·que·s ou privé·e·s, l’idée que « l’endroit où vous vivez affecte vos opportunités » (« where you live affects your life chances ») a largement façonné les politiques du logement d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord (p. 117). Il prend comme exemple l’expérience fédérale nommée « Moving to Opportunity » aux États-Unis, mise en place entre 1994 et 1998. Suivie par de nombreux.ses chercheur·se·s reprenant les présupposés des effets de quartier, avec d’ailleurs des résultats pour le moins « modestes » selon Slater (p. 118), cette expérience a consisté à attribuer, au hasard, des aides au logement à des familles pauvres de quartiers populaires pour les inciter à s’installer dans des quartiers plus aisés. Slater montre ainsi comment des chercheur·se·s disposent d’un pouvoir symbolique puissant. Iels participent à valider des catégories d’action publique comme scientifiques, ici celle de mixité, faisant autorité et, ce faisant, occultent d’autres solutions, plus structurelles, pour lutter contre les inégalités.
Stigmatisation territoriale et sink estate
Dans un des chapitres les plus éclairants de l’ouvrage (« The Production and Activation of Territorial Stigma »), comme en témoigne Loïc Wacquant dans son avant-propos élogieux, Slater détaille le lien entre production de savoirs, rapports de pouvoir et stigmatisation territoriale à travers le terme de « sink estate ». Ce dernier désigne des ensembles de logements sociaux (connus sous le nom de « council housing ») construits par les municipalités, principalement après la Seconde Guerre mondiale, et dont les habitant·e·s auraient des comportements moralement condamnables. Le qualificatif « sink estate » a largement été mobilisé pour diffuser des discours péjoratifs sur les council housing, notamment les grands ensembles dont l’architecture serait la source de problèmes sociaux, et sur les classes populaires qui seraient elles-mêmes responsables de la pauvreté dans laquelle elles vivent (p. 149-150). Slater retrace la genèse sociale et cognitive de cette expression à connotation péjorative. Il évoque le rôle prédominant du champ journalistique (tant des médias de gauche que de droite), mais également celui, moins connu, de think tanks, notamment de Policy Exchange, qui est le préféré de l’ancien Premier ministre conservateur David Cameron. Policy Exchange présente ses recherches comme étant « indépendantes », s’appuyant sur des « preuves » et se déclare apolitique en expliquant qu’il partage des idées avec des partis politiques de gauche comme de droite (p. 152). En réalité, il n’est pas sans influence dans la stigmatisation des logements sociaux et de leurs habitant·e·s et a été un grand producteur de discours contre l’existence même des logements sociaux à travers de nombreux rapports, affirmant que ces logements rendraient leurs habitant·e·s « malheureux·ses », « pauvres », « chômeur·se·s » et « dépendant·e·s des aides sociales » (p. 154). Ils seraient même la cause des émeutes de 2011 (p. 158). Ce discours est mis en parallèle avec celui du think tank Create Streets qui dénonce les grands ensembles qui engendreraient des comportements antisociaux. Selon Slater, ces think tanks ont largement contribué à rendre légitime la proposition inaboutie de David Cameron, en 2016, de démolir les « 100 worst sink estates » (p. 159).
Si ces think tanks utilisent le terme de « sink estate » dans le cadre de rapports présentés comme fondés sur des « preuves », Slater montre qu’il s’agit avant tout d’une catégorie d’« accusation » (p. 161) qui stigmatise des quartiers et leurs habitant·e·s :
« Les think tanks ont réinterprété une grave crise d’accessibilité au logement en une crise de l’offre de logements causée par une trop grande ingérence de l’État dans le marché, qui, entre autres, aurait piégé les gens dans des résidences de logements sociaux inadaptées et ne pouvant être améliorées. À travers le prisme analytique de l’agnotologie, on assiste à une inversion complète : les causes structurelles et politiques de la crise du logement, c’est-à-dire la déréglementation, la privatisation et les attaques contre l’État-providence sont présentées comme des remèdes souhaitables et nécessaires à cette crise du logement afin d’anéantir un appareil d’État envahissant. À travers le prisme conceptuel du pouvoir symbolique, on peut observer comment la stigmatisation déjà intense des résidences de logements sociaux est renforcée par les auteurs des think tanks puis par les élites politiques. Le cadrage autour du sink estate oriente l’attention de la société vers l’éclatement de la famille, le chômage, la dépendance à l’aide sociale, le comportement antisocial et l’irresponsabilité personnelle, et l’éloigne de la communauté, de la solidarité, du logement et du foyer. » (p. 161-162)[3]
L’enquête de Slater évoque à ce stade celle de la sociologue Sylvie Tissot (2007) sur l’imposition du problème public des « quartiers » en France. En mobilisant une approche bourdieusienne, l’autrice retrace la création d’alliances, répondant à des intérêts distincts, entre réformateur·rice·s, chercheur·se·s (notamment celles et ceux participant à la revue Esprit) et statisticien·ne·s de l’INSEE. Structurée par un cadrage théorique et statistique centré sur la « relégation », l’« exclusion » et le « cumul de handicaps », cette alliance a permis de légitimer des propositions de démolition de logements sociaux comme celles analysées par Slater au Royaume-Uni. Dans le chapitre « Ghetto Blasting », il continue son travail didactique sur la stigmatisation territoriale et déconstruit la catégorisation politique et médiatique de « quartiers ghettos » au Royaume-Uni, au Danemark et en Belgique. Tout en montrant comment cette catégorisation renforce des stigmates racistes entraînant discriminations et inégalités, il explique en quoi elle relève avant tout d’un discours « mythologique » et en rien d’une approche analytique « robuste » (p. 164).
Portée et usages des savoirs critiques
Dans la conclusion de l’ouvrage, Slater revient sur des débats traversant les études urbaines et portant sur les outils de lutte comme sur la faible place accordée à la promotion des approches décoloniales valorisant un « pluriversalisme épistémique » (« epistemic pluriversalism » ; p. 193) (en s’appuyant sur le travail de Julie Cupples [2020]). Selon lui, ces approches peuvent proposer des analyses radicalement différentes, notamment sur l’aliénation, la dépossession et le rapport à la propriété (p. 193). Les études urbaines critiques s’inspirent de cadres de pensée venant de mouvements sociaux, comme ceux pour le Droit à la ville, mais délaissent trop souvent des approches décoloniales bien qu’elles soient, selon Slater, compatibles avec les théories marxistes (p. 194). C’est pourtant, d’après lui, à partir de ces approches qu’il serait possible de diversifier l’analyse des inégalités urbaines et la manière d’y faire face : « Le point ici n’est pas que certains modes de pensée critique soient dépassés, ni que certains penseurs eurocentriques ou occidentaux ne méritent pas d’être mis en dialogue ou cités, mais que de nouvelles représentations d’émancipation et de désaliénation sont possibles si l’on considère plusieurs visions du monde, ce que les philosophes décoloniaux appellent le pluriversalisme épistémique » (p. 193)[4].
La volonté de Slater de favoriser un pluriversalisme épistémique et la research-driven policy laisse en revanche en suspens la question de la place des savoirs critiques dans les contestations et les alternatives à l’urbanisme néolibéral. Le livre déconstruit brillamment les catégories de pensée dominantes dans les pratiques urbanistiques contemporaines. L’auteur n’interroge néanmoins pas l’incorporation et les usages des savoirs critiques dans la construction de nouvelles pratiques urbanistiques. De manière évidente, la production de savoirs critiques n’entraîne pas mécaniquement une transformation des pratiques, mais elle est toujours une question politique (Madden, 2015). Dans quelles mesures les théories urbaines critiques peuvent-elles alors s’inscrire dans la lutte symbolique pour le monopole de la vision légitime en urbanisme ? Comment peuvent-elles participer à la contestation des catégories d’action publique dominantes en dehors du champ académique ?
Slater s’intéresse brièvement aux contestations et aux luttes comme dans le chapitre « Gentrification beyond False Choice Urbanism », où il revient sur les oppositions d’institutions publiques, d’associations et de groupes d’habitant·e·s à la gentrification. Son travail pourrait être prolongé en étudiant les savoirs, les théories, les chiffres mobilisés par ces oppositions, avec le cadre théorique de Bourdieu, comme l’a fait Slater, pour concevoir et légitimer leurs actions. Bourdieu accordait une place importante aux oppositions dans le travail de légitimation d’une catégorie de pensée ou d’action publique. Il proposait de décaler le regard sur l’étude des inégalités dans la possibilité de faire connaître et reconnaître une catégorie dans la pratique, sur les écarts de succès des agents et des institutions quand ils tentent d’imposer leur vision comme légitime. Bourdieu (2015) concevait un champ comme un espace structuré par des rapports de forces, ici liés à l’urbanisme néolibéral. Il le concevait également comme un espace marqué par des contestations, des constructions et de l’histoire. Des institutions et des agent·e·s, aux positions dominées, luttent pour tenter de conquérir le monopole de la vision légitime de l’urbanisme. Pour ce faire, ils mettent en place ce que Bourdieu appelait « des stratégies de subversion ». Il s’agirait alors d’observer dans quelle mesure les décideur·se·s et les concepteur·rice·s, dominant·e·s dans les champs dans lesquels iels sont engagé·e·s, rencontrent des revendications et des contestations mobilisant des savoirs critiques. Il pourrait dès lors être utile de réaliser des enquêtes pour comprendre l’usage de ces savoirs dans la construction de modèles urbains alternatifs au néolibéralisme.
Bibliographie
Bourdieu Pierre, « Sur le pouvoir symbolique », Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 32, no 3, 1977, p. 405‑411.
Bourdieu Pierre, Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France (1981-1983), Paris, Raisons d’agir et Le Seuil, 2015.
Cupples Julie, 2020, « Conclusion: Urban Research and the Pluriverse: Analytical and Political Lessons from Scholarship in Varied Margins », in Cupples Julie, Slater Tom, Producing and contesting urban marginality: Interdisciplinary and comparative dialogues, Lanham, Rowman & Littlefield, p. 205-226.
Madden David, « There Is a Politics of Urban Knowledge Because Urban Knowledge Is Political: A Rejoinder to « Debating Urban Studies in 23 Steps » », City, vol. 19, no 2‑3, 2015, p. 297‑302.
Tissot Sylvie, L’État et les quartiers : genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Le Seuil, 2007.
[1] « At first glance this may seem like abstruse academic jargon, but it is really rather simple: it refers to the condition of scholars being constrained in asking their own questions about urbanization, instead asking questions and using categories invented, escalated, and imposed by various institutions that have vested interests in influencing what is off and on the urban agenda. »
[2] « Why do people live where they do in cities? If where any given individual lives affects their life chances as deeply as neighborhood effects proponents believe, it seems crucial to understand why that individual is living there in the first place. A related question is: Why is there so much difference between the richest and poorest neighborhoods? »
[3] « Think tanks have reframed a serious crisis of housing affordability as a crisis of housing supply caused by too much state interference in the market, which, inter alia, has trapped people in failed social housing estates that can never be improved. Viewed through the analytic lens of agnotology, we can see a complete inversion going on: the structural and political causes of the housing crisis —that is, deregulation, privatization, and attacks on the welfare state —are put forward as desirable and necessary remedies for the crisis that will squash an intrusive state apparatus. Viewed through the conceptual lens of symbolic power, we can see how the already intense stigma attached to social housing estates is vamped up by think tank writers and then by political elites. The framing of the sink estate filters societal attention toward family breakdown, worklessness, welfare dependency, antisocial behavior, and personal irresponsibility, and away from community, solidarity, shelter, and home. »
[4] « The point here is not that certain modes of critical thought are outdated, nor that certain Eurocentric or Western thinkers are not worth engaging with or citing, but that new pictures of emancipation and disalienation are possible if we consider multiple worldviews, in what is known among decolonial philosophers as epistemic pluriversalism. »

