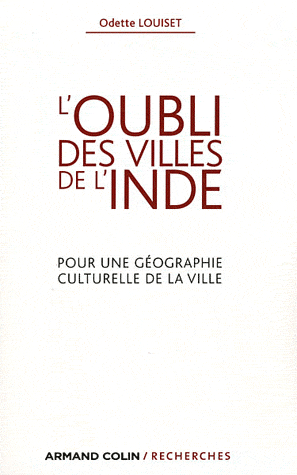L’oubli ne représente-t-il pas souvent une injustice ? Même si le livre d’Odette Louiset L’oubli des villes de l’Inde ne contient pas le terme, on peut le lire à la lumière de ce concept.
« L’oubli des villes de l’Inde, c’est l’occultation de l’indianité de la ville » (p.4 de couverture). En voulant tout ramener à un « modèle » de ville fondé sur des types occidentaux, sur des pratiques académiques trop fondées sur l’analyse des formes, la quantification des activités et des populations, et sur une cartographie mal adaptée aux spécificités indiennes, on tend à considérer comme exceptionnel, comme condamnable, comme non viable, tous les espaces urbains, du bidonville (slum) au vieux centre commercial (bazar), en passant par les marges périurbaines : autant de « résidus » au sens statistique, d’espaces « mal intégrés », « informels ». Les conséquences politiques et humaines en sont désastreuses : il suffit de penser à la destruction souvent sans préavis des bidonvilles, dont des chercheurs français comme Véronique Dupont ont révélé les terribles impacts sociaux.
L’ouvrage n’est pas facile à lire. Il s’agit d’un texte pour la HDR (amputé, contraintes éditoriales obligent, du contenu d’Introduction à la ville, publié chez le même auteur). Il souffre de quelques redites. Surtout, dans sa volonté de déconstruire, il prend le risque de dérouter le lecteur sans lui livrer au final de bilan bien clair sur ce que sont urbanité et indianité. Pourtant l’enjeu est là, pour Odette Louiset : faire la part de l’universel et du particulier, et savoir ce qui dans les villes de l’Inde est la part de l’urbanité et la part de l’indianité. Le lecteur comprend que l’urbanité correspond largement à la définition qu’en donne Jacques Lévy (densité et diversité), tandis que l’indianité tient en particulier à la forte inscription spatiale des castes et plus généralement des confessions (hindoues, musulmanes…), ainsi qu’à une histoire sud-asiatique spécifique.
L’urbanité, plaide l’auteur, ne doit pas être confondue avec l’urbanisation, à savoir une vision trop « géométrique » fondée sur le calcul, la statistique, le zonage, le recensement des activités. L’urbanité, que révèle une approche de « géographie culturelle », fait fi des modèles spatiaux couramment utilisés par les chercheurs comme par les aménageurs (occidentaux mais aussi indiens). Ceux-ci se réfèrent tous à un pseudo universalisme – en fait très « européen » – alors qu’il importe de ne pas confondre le concept et le simple « modèle » (au sens d’idéal) : la ville occidentale est peut-être un modèle (contestable) mais assurément pas le concept de « la ville ».
Le lecteur de JSSJ pourra considérer que l’oubli des villes de l’Inde engendre trois types d’injustice spatiale.
Le premier type est d’ordre historiciste. L’oubli des villes de la civilisation de l’Indus par de nombreux historiens, soucieux de décrire la civilisation aryenne comme exclusivement rurale et qui nient tout héritage de la première sur la seconde, est devenu en Inde une question politique brûlante. Bien traité dans l’ouvrage, l’occultation des villes précoloniales, parfois considérées comme des villes trop imparfaites, ou bien (argumentation de Gandhi) comme ne correspondant pas à l’Inde authentique, a eu elle aussi des répercutions politiques une fois l’Indépendance acquise.
La seconde injustice est davantage sociale : c’est celle dont souffrent les millions de personnes qui vivent en bidonville ou dans des quartiers non prévus par le schéma directeur (master plan) censé régir la croissance urbaine. L’oubli de ces quartiers, invisibles aux yeux de beaucoup d’aménageurs et même de politiciens (malgré le suffrage universel), rend légitime ou du moins légale leur destruction, souvent sans indemnisation pour les familles déplacées.
La troisième injustice est à l’origine de la précédente, et le livre en rend fort bien compte. Elle est d’ordre plus scientifique et intellectuel : puisque le concept de ville n’a pas connu suffisamment de déconstruction postmoderne et postcoloniale, l’indianité s’en trouve comme exclue. Non seulement la recherche en études urbaines tout comme les modèles d’aménagement ne peuvent s’adapter à la réalité de l’Inde, mais encore, à l’inverse, l’Inde se trouve empêchée de féconder les études urbaines pour les gauchir, les « provincialiser » (comme dirait D. Chakrabarty) et les faire sortir d’un pseudo universel qui n’est rien d’autre qu’un particulier occidentalisé.
Le livre peut à mon sens être lu ainsi : résoudre la troisième injustice, intellectuelle, permettrait de résoudre la seconde, sociale. Pour cela, explique O. Louiset, il faut savoir manier l’arme du comparatisme. Non pas de simples comparaisons, qui mobilisent « des catégories prêtes à l’emploi », mais un comparatisme qui consiste « à remonter le plus en amont possible pour élaborer l’outil qui sera utilisé pour placer les objets en perspective », relativisant « le caractère culturel de la norme scientifique » (pp.253-4). La « valeur éthique » de ce comparatisme que l’auteur emprunte à Marcel Détienne permettra seule « un regard critique sur ses propres normes » (p.257) et la reconnaissance des différences.
Il faut donc entrer dans la ville par ses marges, comme l’a fait Michel Agier (un ethnologue et non un géographe, habitué donc à « travailler les concepts en les dégageant du modèle », p.256) : par les bidonvilles notamment, peuplés avant tout d’intouchables et de tribaux (il semble à ce propos que l’auteur surestime la proportion de très basses castes dans les slums indiens). On doit dénoncer l’urban planning comme un « illusionnisme politique » (p.198). Il faut quitter une conception géométrique de l’espace et aborder les notions de « voisinage » plutôt que de quartier, considérer celles de « carrefour », d’ « entre-deux », insister sur « l’absence de polarisation par un espace central » (p.269), ou analyser un espace « public » qui se trouve en fait plus souvent « commun » (cas d’une procession hindoue minutieusement décrite à Bangalore).
Tout en combattant l’essentialisme culturel grâce à une érudition d’indianiste soucieuse de rétablir l’historicité et les approches pluridisciplinaires, O. Louiset livre de belles pages sur les castes et les communautés, dont la ville est loin d’avoir fait disparaître les inscriptions spatiales alors même qu’elle peut apparaître éloignée des principes brahmaniques d’organisation de l’espace. L’auteur montre le rôle de l’idéologie ruraliste gandhienne qui ne voyait que la « ville d’importation » (232), analyse longuement l’indianité de Chandigarh pourtant conçue par Le Corbusier, et s’attarde sur Hyderabad, agglomération de 6 millions d’habitants dont elle démonte les différentes lectures (ville duale hindo-musulmane, ville duale coloniale, ville de l’informatique…). Elle a pour finir d’excellents paragraphes sur les conceptions, à toutes les échelles, de l’espace hindou, de l’espace musulman, ou de celle dominante pour le Raj britannique…
Le titre de l’ouvrage (allusion à celui d’un livre de R.P. Droit sur un oubli comparable de la philosophie indienne) est cependant contestable. Oubli des villes de l’Inde ? Mais ce pays est-il la seule victime ? Certes, « l’oubli des villes de l’Inde, comme de bien d’autres, résulte de la projection d’une idée de la ville sur d’autres conceptions, sur d’autres pratiques au point de ne plus les voir » (p.5, c’est moi qui souligne). Mais l’auteur a tendance à ériger l’Inde comme le seul contre-exemple : même si ce pays comptait 377 millions de citadins en 2011, même s’il peut être considéré comme le lieu d’origine des études postcoloniales et « subalternes », le titre de l’ouvrage apparaît comme réducteur. Lagos ou Nairobi ne doivent-ils pas eux aussi être considérés plus en termes de « voisinages » (neighbourhoods) que de quartiers ? O. Louiset fait elle-même des références au Cameroun, à la Chine, et discute assez longuement des villes du Sud… La caste en Inde et l’ethnie en Afrique sont-elles si différentes que la spécificité indienne interdise toute généralisation aux villes du Sud ? Allons plus loin : selon le principe de « qui cherche trouve », un regard postcolonial porté sur les villes du Nord pourrait trouver semblables décentrages et labilités (certes moins dominants, sans doute), et ce, point seulement dans les quartiers d’immigrés. Le constat final ne serait donc pas tant l’oubli des villes de l’Inde, que l’oubli des villes du Sud… ou mieux encore l’oubli de la « géographie culturelle », l’oubli d’une certaine urbanité postmoderne.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur le devenir de cette indianité : n’est-elle pas en proie à des processus internes qui la font, par bribes, se rapprocher de cette occidentalité démasquée par l’auteur ? Premier indice, la ville imaginée par les fameuses « classes moyennes » indiennes (en fait une élite sociale) qui, elles, adhèrent souvent aux modèles de la planification urbaine standardisée, recherchant un « entre soi » qui interdit notamment la proximité de bidonvilles : ne représentent-elles pas une indianité nouvelle qui se heurte à celle décrite jusque là par O. Louiset ? Ou bien ne sont-elles qu’un élément de celle-ci, dans une Inde « émergente » en train d’inventer de nouveaux modèles contrastés ? Second indice, malheureusement moins exceptionnel qu’il peut paraître : la ségrégation renforcée (subie autant que recherchée) à base religieuse dans les villes touchées par de récentes émeutes interconfessionnelles – Bombay, Ahmedabad… Là, la limite, la frontière, voire même le mur, entre « quartiers » spatialement délimités, tendent à détruire les « voisinages » en devenant des protections face à un Autre qu’on considère comme ennemi potentiel et qu’il faut donc fuir en s’installant dans des espaces homogènes religieusement. Ces deux exemples tendent à montrer que l’entre-deux, le carrefour, le voisinage sont les éléments très menacés d’une indianité qui évolue vers des sous-espaces urbains socialement ou religieusement homogènes à une échelle de plus en plus vaste.
Un dernier mot. En refermant le livre, le lecteur de JSSJ aura pu y trouver, indirectement soulignée, l’importance du rôle du comparatisme, et plus simplement de la comparaison, dans l’analyse des justices et injustices. Déclarer qu’il y a injustice, n’est-ce pas toujours, implicitement ou pas, comparer ? Soit l’on compare deux espaces entre eux, l’un pouvant alors apparaître plus avantagé que l’autre. Soit l’on compare un espace à un modèle (ou à un concept, peu importe ici), celui-ci pouvant être un modèle scientifique comme un code juridique – et l’espace pourra alors apparaître en situation d’injustice par rapport à la législation, ou aux droits de l’homme, ou à l’éthique, etc. Indirectement, l’ouvrage d’Odette Louiset nous conduit donc à discuter du rôle de la comparaison dans la définition des injustices. L’oubli des villes de l’Inde est une injustice pour l’indianité parce qu’on se refuse trop souvent à comparer le modèle indien de la ville à celui prévalant en Occident. C’est aussi une injustice pour les Indiens eux-mêmes – du moins ceux des espaces « marginaux » – parce qu’on se refuse à comparer leur urbanité à celle des espaces ou pays plus « développés ».
More