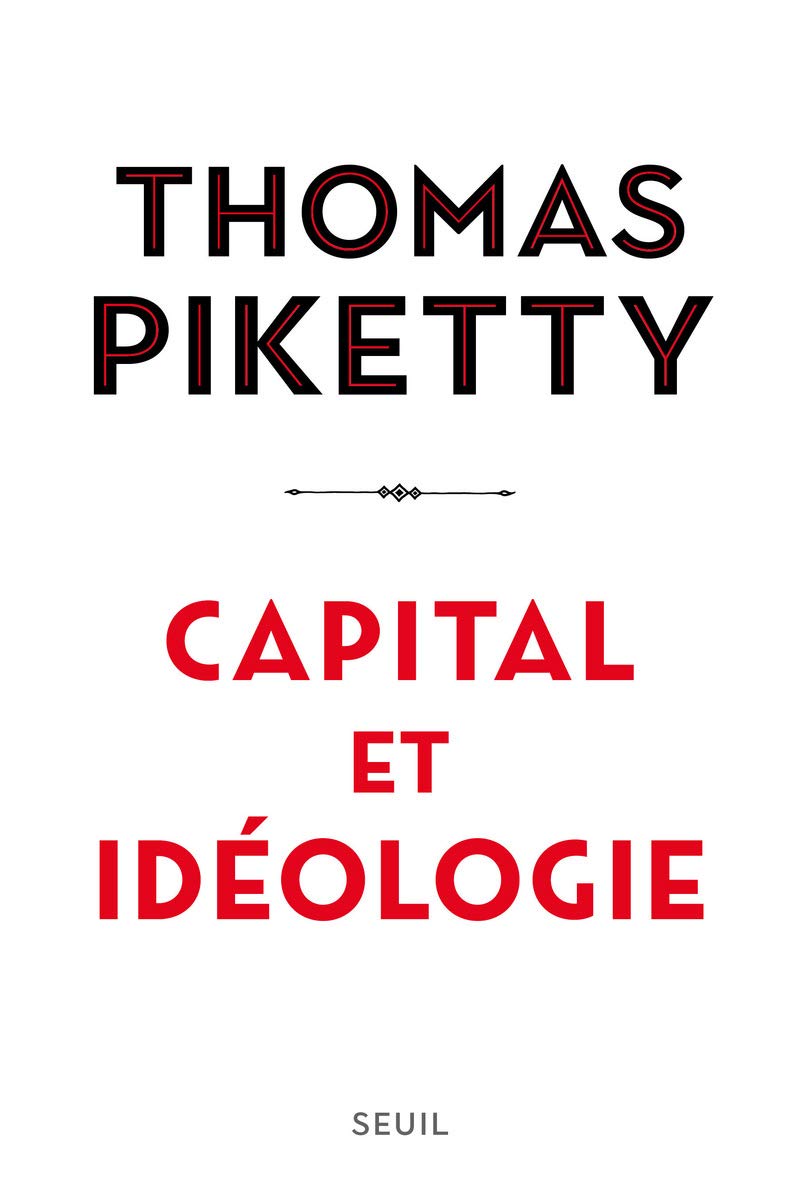Les mobilisations des travailleurs immigrés précaires émergent comme question sociale et comme sujet médiatique depuis le début des années 2000. La grève des sans-papiers qui, en 2008, revendiquent leur statut de travailleurs (Barron et al., 2011) est mise en avant dans un court-métrage de soutien réalisé en 2010 par un collectif de cinéastes pour les sans-papiers, « On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici ! ». Le mouvement de grève des femmes de chambres des hôtels Accor, en 2002, avait déjà fait émerger dans l’actualité les grèves des travailleuses immigrées du nettoyage. Cette mobilisation avait fait l’objet d’un documentaire, réalisé par Ivora Cusak, « Remue-ménage dans la sous-traitance », qui dénonce tout particulièrement les cadences intenables imposées aux travailleuses du nettoyage, sujet que le récit de l’immersion de la journaliste Florence Aubenas (2010) parmi les précaires du nettoyage, Le Quai de Ouistreham, a mis en lumière quelques années plus tard. Le film dont je rends compte ici, « Les petites mains invisibles », documentaire militant réalisé en 2019 par Dam Morrison, Pierre Bernon, et Eliane Le Floch, édité par le média en ligne d’extrême gauche Révolution permanente, qui fait le récit de la mobilisation victorieuse d’employés d’une société de nettoyage sous-traitante pour la SCNF, s’inscrit donc dans une dynamique de mise en visibilité des luttes des travailleurs et travailleuses du nettoyage.
« Les petites mains invisibles » s’ancre dans un contexte social de précarisation des travailleurs. Le film porte le regard sur une entreprise de sous-traitance, dans le secteur du nettoyage, qui emploie en grande majorité des travailleurs à temps partiel, immigrés, parfois sans-papiers. Le documentaire s’ouvre sur la mention de la loi travail, signée en septembre 2017, et sur les nouveaux « outils de casse des conditions de travail » qu’elle offre aux entreprises. Le mouvement de grève victorieux dont il rend compte est présenté comme exemplaire, et le caractère atypique et novateur de cette mobilisation d’hommes et de femmes précaires est mis en exergue. En novembre 2017, une centaine de femmes et d’hommes salariés du nettoyage des gares du réseau de Transilien Paris Nord se mettent en grève pour protester contre les nouvelles conditions de travail que veut leur imposer la société H. Reinier ONET, sous-traitante de la SNCF qui reprend le contrat de nettoyage des gares du réseau Paris Nord précédemment assuré par la société SMP. Les nouveaux contrats d’ONET (acronyme d’Office nouveau du nettoyage) imposent aux salariés une clause de mobilité, qui les amènerait à changer de gare sans préavis, alors qu’elles et ils sont déjà pour la plupart à temps partiel et doivent faire de longs trajets pour se rendre au travail (Le Bars, 2014). Les travailleurs et travailleuses mobilisés dénoncent également des suppressions de postes et revendiquent une augmentation des primes. Mi-décembre 2017, les grévistes obtiennent satisfaction sur la plupart de leurs revendications et la grève se termine.
Le film suit un fil chronologique pour raconter, du début à la fin, des prémices en novembre 2017 jusqu’à la fête de la victoire le 16 décembre 2017, les 45 jours de grève de ces salariés chargés du nettoyage des 75 gares du réseau de Transilien Paris Nord. Le récit, organisé en six chapitres, est introduit par une interview rétrospective d’une des femmes grévistes emblématiques du mouvement, Fernande (chapitre 1). Interrogée sur son lieu de travail, le quai de la gare de Bessancourt dans le Val d’Oise, elle décrit ses conditions de travail, les cadences difficiles à suivre – elle doit nettoyer trois gares chaque jour –, et revient sur les moments forts du mouvement de grève. Le film retrace ensuite les différentes étapes de la grève : les premières assemblées générales et l’organisation des piquets de grève (« Détermination et auto-organisation »), la jonction avec les syndicats de cheminots (« Tous cheminots ») et la mise en place d’une caisse de grève, les mesures de rétorsion de la SNCF et de la société ONET qui tentent de casser la grève en assignant les grévistes en justice et en ayant recours à des intérimaires pour nettoyer les gares sous protection policière (« Répression »), les actions visant à développer la solidarité locale, à gagner des soutiens politiques et à donner une visibilité médiatique du mouvement (« Élargir pour gagner »), et la fête de la victoire au théâtre de la Belle Étoile, à Saint-Denis (« Bien plus qu’une victoire »).
Le documentaire donne à voir les divers acteurs de la mobilisation, salariés du nettoyage grévistes, syndicalistes du rail qui ont appuyé le mouvement et contribué à son organisation, et soutiens. Sans voix off mais avec un recours à la projection de textes retraçant les principales étapes du mouvement, le film alterne interviews, individuelles et collectives, dont les extraits sont distribués par séquences de quelques minutes, et séquences vidéo retraçant les moments forts de l’action. Il s’appuie aussi sur des photographies, portraits des grévistes et illustrations des nombreuses manifestations de soutien, et sur des vidéos, extraites de journaux télévisés ou produites par des soutiens à la mobilisation comme la blogueuse et dessinatrice féministe Emma. On peut supposer que toutes les interviews, qui adoptent un point de vue rétrospectif, ont été menées après la mobilisation. Les interviews individuelles mettent surtout en avant deux femmes, Fernande Bague et Oumou Gueye, déléguée syndicale Sud Rail. Elles font figure d’emblèmes du mouvement, leurs prises de parole médiatiques et leurs interventions lors des différentes étapes de la mobilisation sont aussi présentes tout au long du film. Deux hommes sont interviewés ensemble, Mamadou Fofana, également délégué syndical Sud Rail, et Moussa Baradji. Ces témoignages sont complétés par des captations d’entretiens de groupe, notamment avec un groupe de femmes africaines grévistes. Les interviews figurent aussi, en guise de narrateurs du mouvement, deux jeunes cheminots militants de Sud Rail, soutiens des grévistes qui ont joué un rôle important dans cette mobilisation, Laura Dipace et Anasse Kazib, syndicaliste médiatique et militant du NPA qui a fait l’objet de portraits dans Libération et les Inrockuptibles, et est intervenu dans l’émission de RMC les Grandes Gueules, de novembre 2018 à mars 2020.
Les formes matérielles prises par la mobilisation sont restituées avec précision. On peut observer l’invention et la réadaptation progressive d’un répertoire d’action militant des syndicats du rail, dont les grévistes n’étaient pas familiers avant le début du mouvement, mais qu’elles et ils s’approprient progressivement, en lien avec des alliés issus du syndicat de cheminots Sud Rail. Les modalités de la grève se mettent en place petit à petit en reprenant un répertoire d’action classique, fondé sur des assemblées générales, des occupations de gares, et la participation aux manifestations interprofessionnelles dans un contexte de mouvement social à la SNCF. Les salariés mobilisés font ainsi l’apprentissage du « travail de la grève », à l’instar de ce qui a pu être observé lors du mouvement des sans-papiers de 2008 (Barron et al., 2011) ; ils découvrent notamment l’importance de la caisse de grève (qui atteint 80 000 euros à la fin de la grève), considérée avec méfiance au début du mouvement car perçue comme une forme de charité.
L’élargissement du mouvement, par le biais d’un appel à la solidarité locale auprès, notamment, des usagers des trains de la SNCF, se joue à plusieurs échelles. La mobilisation repose sur un ancrage local fort : les grévistes occupent trois gares du réseau Paris-Nord, Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, Sarcelles et Ermont dans le Val-d’Oise. Les lieux de la mobilisation sont mis en avant à travers la récurrence des scènes qui se déroulent dans les gares, singulièrement à la gare de Saint-Denis, point central de la mobilisation, et sur le parvis de la gare qui est érigé en lieu de rencontre entre les grévistes, leurs soutiens, et les usagers de la SNCF dont une partie est progressivement sensibilisée à ce mouvement de grève. Des actions se tiennent parfois loin des gares occupées, lors des manifestations interprofessionnelles et à l’occasion d’un rassemblement devant le siège d’ONET. La gare de Saint-Denis est le point de départ d’un élargissement du mouvement, pensé et construit par les alliés syndicalistes pour faire apparaître la grève « au milieu de la ville ». Après un repas solidaire sur le parvis de la gare, complété par une lettre à la population de Saint-Denis, le mouvement s’amplifie au moyen d’un rassemblement de soutien sur le parvis de la gare, convoqué à la suite d’une action coup de poing menée par la SNCF et ONET qui ont fait appel à des intérimaires pour nettoyer, sous protection policière, la gare de Saint-Denis. Cela débouche sur la mise en place d’un comité de soutien composé de militants syndicaux, politiques (dont le député France insoumise de Seine Saint-Denis, Éric Coquerel, et des militants du NPA), associatifs, ainsi que de membres de collectifs locaux tels Femmes en lutte 93 et de sympathisants, notamment des étudiants. La mise en visibilité de la mobilisation culmine avec une manifestation dans le centre-ville de Saint-Denis, ponctuée de chants, de banderoles et de slogans. Une médiatisation construite donc, qui s’appuie aussi sur une mise en visibilité du mouvement dans le monde artistique et sur une campagne de selfies à travers le monde, illustrée dans le documentaire par des photographies de personnes portant des panneaux indiquant leur soutien au mouvement, envoyées depuis l’Argentine, la bande de Gaza ou encore l’Allemagne. La fête de la victoire qui clôt le documentaire et la manifestation dans les rues de Saint-Denis montrent aussi l’incorporation de références des mobilisations de gauche et du mouvement féministe dans un mouvement au départ catégoriel, mené par des acteurs dont la culture politique est éloignée de ces références ; on entend ainsi l’Hymne des femmes, chant emblématique du mouvement féministe des années 1970, ou Bandiera rossa, chanson révolutionnaire italienne, ainsi que le slogan « el pueblo unido jamás será vencido », venu du Chili de Salvador Allende. Cela ouvre sur la question des formes et des enjeux de la mise en visibilité des travailleurs et travailleuses du nettoyage et de leur lutte au fil du documentaire.
Qui sont ces « petites mains invisibles », et quel regard ce documentaire militant porte-t-il sur ces hommes et femmes précaires, immigrés, employés d’une entreprise de sous-traitance ? La question peut être abordée en termes intersectionnels, puisque les caractéristiques de ces grévistes invisiblisés croisent classe, race et genre. Ce sont tout d’abord des travailleurs précaires, à temps partiel, touchant de très petits salaires, souvent en contrat à durée déterminée : une main-d’œuvre remplaçable, dans laquelle on trouve quelques sans-papiers, précaires parmi les précaires dans un monde du travail qui valorise hypocritement leur flexibilité. Tous les grévistes qui prennent la parole dans le documentaire sont noirs et immigrés pour la quasi-totalité d’Afrique de l’Ouest ; la plupart semblent avoir entre quarante et soixante ans. D’après les bribes de récits de vie que l’on entend, notamment celui de Fernande en ouverture du documentaire, on saisit que beaucoup d’entre eux vivent en France en situation régulière, et y travaillent dans le secteur du nettoyage depuis longtemps : assez logiquement, les plus vulnérables n’apparaissent pas nettement dans le film. Les stéréotypes que les employeurs associent à ces travailleurs et travailleuses perçus comme dociles et peu capables de s’informer de leurs droits (certains d’entre eux, surtout des femmes, ne savent ni lire ni écrire le français), encore moins de se mobiliser, et leur façon d’exploiter leurs faiblesses, sont dénoncés par les grévistes. Une partie de ces grévistes sont des femmes ; elles sont d’ailleurs bien plus visibles que les hommes dans le documentaire. L’analyse de la liste des grévistes qui figure à la fin du documentaire montre pourtant que les hommes sont majoritaires dans ce mouvement, à hauteur de 60 % environ. Cette mise en avant des femmes grévistes peut tout d’abord être liée au fait que le nettoyage est un secteur d’emploi souvent perçu comme féminin. Elle s’inscrit aussi dans une forme de visibilisation des femmes migrantes par leur participation à la grève (Meynaud, 2011), et donne à voir la position paradoxale de ces femmes qui, malgré l’invisibilité à laquelle elles sont assignées, participent de longue date à diverses formes de mobilisation (Miranda et al., 2011). Les femmes rencontrées par Joanne Le Bars (2014) lors d’une occupation d’immeuble menée à Paris en 2009, qui travaillent dans le secteur du nettoyage (l’une d’entre elles travaille d’ailleurs justement dans les gares du nord-ouest de la région parisienne), jouent ainsi un rôle important dans le mouvement de grève des sans-papiers. Au-delà de la grève sectorielle, le fait que la participation de femmes immigrées travailleuses précaires à la lutte contribue à leur émancipation (Miranda et al., 2011) affleure dans le documentaire lorsque certaines grévistes expliquent comment le mouvement leur a fait gagner en assurance. La double charge de travail de ces femmes, qui en rentrant après avoir nettoyé les gares doivent encore faire le ménage et s’occuper de leur famille, est aussi évoquée. Plus largement, la question de la visibilité des travailleurs immigrés, et tout particulièrement des femmes, dans les secteurs comme le nettoyage qui ont connu depuis vingt ans un processus accéléré de mise en sous-traitance (Meynaud, 2011), passe très souvent par la lutte. Le documentaire « Remue-ménage dans la sous-traitance », réalisé en 2010 par Ivora Cusak, met en évidence cette dynamique.
Cet autre documentaire consacré aux « petites mains » du nettoyage, réalisé sur près de dix ans, se conforme plus aux canons du documentaire sociologique. Il s’ouvre sur des interviews de femmes de chambre qui racontent leur trajectoire migratoire et professionnelle. Toutes trois sont noires, l’une est venue de Martinique à l’adolescence, les deux autres sont arrivées en France, à l’âge adulte, du Sénégal et de Mauritanie. Le film relate ensuite la grève des femmes de chambres contre les conditions de travail imposées par la société Arcade, sous-traitante du groupe hôtelier Accor chargée du nettoyage des hôtels ; il raconte, également de manière chronologique et sans voix off, un mouvement en deux temps. Le premier moment est une grève des femmes de chambre, qui commence au début de l’année 2002. Elles dénoncent leurs conditions de travail, et notamment les cadences intenables qui leur imposent de nettoyer une chambre en 17 minutes, ce qui est matériellement impossible – elles font donc des heures supplémentaires non payées. Les grévistes sont toutes des femmes (de chambre), immigrées, pour la plupart noires et venues d’Afrique de l’Ouest. Ce long conflit, qui dure plus d’un an, se termine en février 2003 par une victoire : le groupe Arcade accède aux revendications des grévistes sur les cadences et les contrats et leur accorde une prime de 4 000 euros chacune. Le second mouvement, qui démarre un an plus tard, en 2004, est motivé par le licenciement, dénoncé comme abusif, d’une des figures de la grève, Mayant Faty, déléguée syndicale. En novembre 2005, après un an et demi de lutte, elle finit par signer un accord avec Arcade qui lui accorde une indemnité financière.
Outre les manifestations et les piquets de grève devant les hôtels, les grévistes et leurs soutiens inventent un répertoire d’actions transgressif visant à déranger le bon déroulement de la vie des hôtels : occupation des halls, jets de papiers déchirés dans les halls et les bureaux, pique-niques dans le hall de ces hôtels dont les femmes de ménage n’ont ni le temps de faire des pauses déjeuner ni local dédié, et où elles se cachent dans les toilettes pour avaler un sandwich, distributions de tracts aux clients des hôtels, qui sont aussi invités à signer et envoyer des cartes postales au PDG du groupe Accor, intrusion dans les locaux de la société Arcade… Ces actions sont largement appuyées, voire souvent initiées, par un comité de soutien constitué de militants aguerris, pour partie des syndicalistes de Sud et de la CGT et des militants de la CNT, parfois retraités, déterminés, que l’occupation des halls d’hôtels amuse visiblement beaucoup et qui n’hésitent pas à interpeller les clients, pour leur expliquer, en différentes langues, les raisons de la grève. Les réactions de la clientèle oscillent entre indifférence polie, empathie et agacement, tel ce client qui « voudrait juste manger tranquille » ; les employés des hôtels, qui se dédouanent systématiquement des abus commis par la société Arcade, semblent souvent irrités par les occupations et les jets de papiers et de confettis, et mal à l’aise devant la caméra.
De nombreux parallèles se font jour entre ces deux documentaires, qui relatent des mouvements de grève dont les conditions et les moyens d’action présentent des similarités. On retrouve deux histoires de grèves victorieuses, devant des situations d’exploitation manifeste, menées par les travailleurs et travailleuses immigrés originaires pour la plupart d’Afrique de l’Ouest, précarisés et exploités. Dans les deux cas, le poids de la médiatisation et le rôle des soutiens, notamment syndicaux, au mouvement, sont très importants. On observe un décalage entre les alliés syndicalistes, français de naissance en général, dont les familles sont parfois originaires du Maghreb ou d’Europe du Sud, qui connaissent les codes du jeu politique et maîtrisent les stratégies permettant de réussir la mobilisation, et les grévistes immigrés et noirs dont la détermination est le cœur du mouvement ; cette alliance inégale, que l’on retrouve dans les mouvements de sans-papiers (Barron et al., 2011) est le ferment d’une forme de convergence des luttes. Les entreprises mises en cause sont des sous-traitants de grands groupes qui se dédouanent des actions menées par ces entreprises auxquelles ils délèguent le nettoyage, et se retrouvent face à la revendication d’une internalisation du travail de nettoyage, tant au sein de la SNCF que d’Accor. Elles réagissent par la menace et les poursuites judiciaires, et font appel à des intérimaires pour mener à bien le travail de nettoyage et casser la grève. Les victoires acquises sont fragiles, car elles peuvent être remises en cause par la valse perpétuelle des sous-traitants. Surtout, les motivations de la grève sont présentées comme allant au-delà de revendications légitimes sur les salaires (très faibles) et les conditions de travail (très dégradées) : ces mouvements sont interprétés comme des mobilisations pour le respect et la dignité de travailleurs et travailleuses, et les deux documentaires soulignent l’exemplarité des luttes des femmes et hommes immigrés travailleurs précaires.
« Les petites mains invisibles » restitue donc, avec un enthousiasme contagieux, une grève victorieuse, et il n’y en a pas tant. Sans passer sous silence les tensions et moments de découragement qui ont pu agiter le mouvement au gré des revers subis, le parti pris militant du film valorise la solidarité et l’union qui mènent – parfois – à la victoire.
BIBLIOGRAPHIE
AUBENAS Florence, Le Quai de Ouistreham, Paris, L’Olivier, 2010, 276 p.
BARRON Pierre, BORY Anne, CHAUVIN Sébastien et al., On bosse ici, on reste ici ! La grève des sans-papiers : une aventure inédite, Paris, La Découverte, 2011, 312 p.
LE BARS Joanne, « Travailleuses sans-papiers à Paris. Retour sur la tentative de constitution d’un collectif de femmes », Hommes et migrations, n° 1308, 2014, p. 111-105.
MIRANDA Adelina, OUALI Nouria et KERGOAT Danièle, « Les mobilisations des migrantes : un processus d’émancipation invisible ? Introduction », Cahiers du Genre, dossier « Migrantes et mobilisées », vol. 51, no 2, 2011, p. 5-24.
MEYNAUD Hélène Yvonne, « Réclamer sa juste part : des mouvements de migrantes aux sans-papières en grève », Cahiers du Genre, vol. 51, no 2, 2011, p. 69-91.
FILMOGRAPHIE
Collectif des cinéastes pour les sans-papiers, « On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici ! », 2010, 3 minutes 38.
CUSACK Ivora « Remue-ménage dans la sous-traitance », produit par le collectif 360° et même plus, 2008, 70 minutes.
More